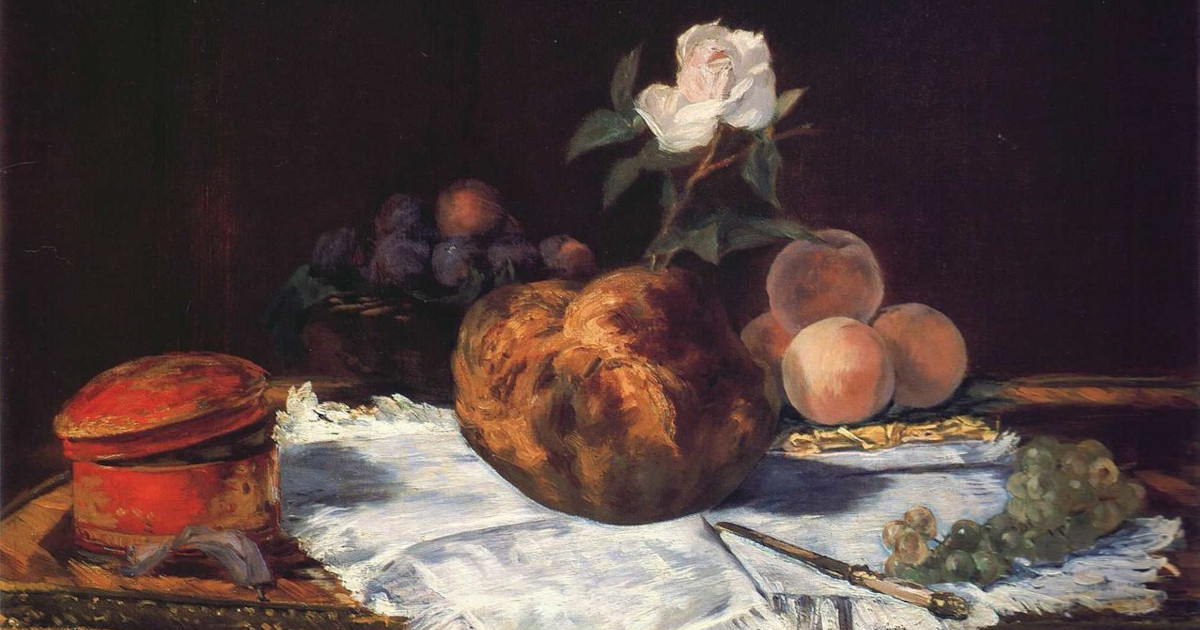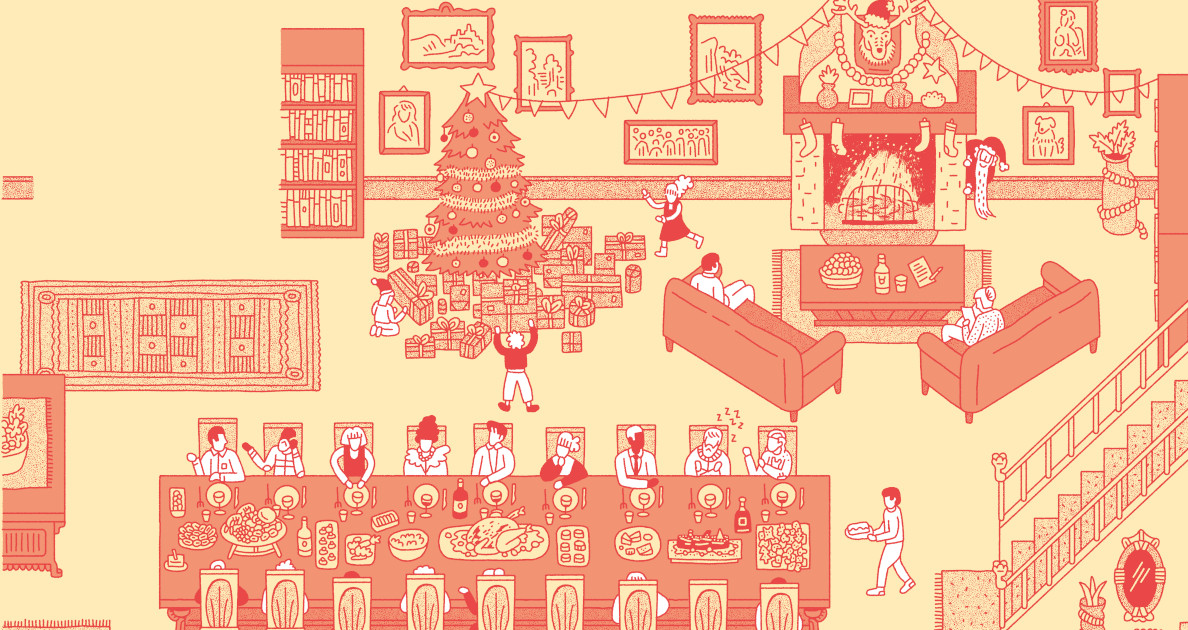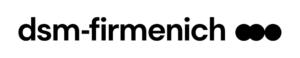« Toi qui entres ici, abandonne tout espoir d’entendre la vérité », pourrait-on dire au novice s’intéressant à la parfumerie. Il est vrai que les fables, secrets et mensonges sont légion dans le milieu. Le marketing contemporain, avec son obsession de « vendre du rêve », n’aide pas, mais il est loin d’être le seul à blâmer : la parfumerie a élevé le mystère en tradition, et la fable en art de vivre. Ses commentateurs acerbes ne manquent d’ailleurs pas d’en faire des gorges chaudes, les récents livres de Maïté Turonnet (Pot-pourri) et de Gabe Oppenheim (The Ghost Perfumer) nous l’ont rappelé cette année.
Si les vérités de l’industrie sont parfois révélées aux connaisseurs, l’essentiel de ses mythes est régulièrement consolidé pour le grand public. Secrets de Polichinelle, mensonges commerciaux, par omission, secrets d’atelier… Voici donc une petite typologie des discours trompeurs de la parfumerie, d’une part car il vaut mieux en rire, d’autre part car cette culture du mystère a occasionnellement ses raisons, et qu’il n’est pas vain de les explorer.
Secrets de Polichinelle
Il est des secrets connus de tous ou presque, dont seules quelques pratiques commerciales prolongent malgré tout l’existence. Parmi eux, le plus emblématique est peut-être celui qui entoure les reformulations : « non non, nos parfums sont restés inchangés depuis leur sortie, madame ! » entend-on régulièrement dans les allées des grandes enseignes. Il y a pourtant de moins en moins de gens pour y croire – même votre vieille tante vous glisse parfois que son parfum chéri ne sent plus comme avant. Les amateurs éclairés savent bien que les reformulations sont inévitables chez les grandes marques, nécessaires aussi (pour des raisons de conformations aux normes environnementales ou sanitaires, parfois pour des raisons économiques) et plus ou moins imperceptibles. En n’en parlant pas, on se donne certes une chance de vendre un flacon encore plus vite… ou pas du tout. Le manque de transparence face à un parfum qui a changé, ça épuise la confiance.
Matière à mensonges
Le parfum est cher, très cher. En fait, il n’a peut-être jamais été aussi onéreux qu’aujourd’hui. À celles et ceux qui s’en étonneront, les marques communiquent régulièrement sur la difficulté de produire les matières premières comme l’iris : « c’est que nous utilisons un magnifique iris qui met trois ans à sécher ! » Une vieille rengaine qui évite de parler de la quantité infinitésimale du précieux extrait dans la plupart des formules, et qui passe sous silence les nouveaux procédés de traitement des rhizomes d’iris qui permettent un séchage en trois jours seulement. Au-delà de ces difficultés, le prix des matières est au centre de beaucoup de stratégies de communication, ce qui se traduit par ce genre de discours : « Savez-vous seulement que le prix du litre d’huile essentielle d’oud atteint parfois les 30 000 euros ? ». Certes. Mais compte tenu du dosage, avec un litre de cette huile essentielle (plus souvent évoquée que réellement utilisée d’ailleurs), on peut remplir un grand nombre de flacons : des dizaines de milliers d’une fragrance dite « exclusive », dans la plupart des cas. Rares sont en fait les parfums contenant plus de deux euros de coûteuses matières premières (et ce n’est pas forcément un problème, le prix d’un Picasso ne se mesure pas non plus en tubes de peinture).
Lorsqu’on sait que l’emballage et le conditionnement standard d’une fragrance, avec son flacon, sa pompe et sa boîte imprimée, coûtent déjà plus de six euros pièce, que les distributeurs prennent facilement un tiers du prix de vente, et qu’une campagne de publicité peut coûter à elle seule plusieurs millions d’euros, on comprend bien que, dans le parfum, le luxe et l’argent ne sont pas où on nous le fait croire.
Mensonges commerciaux
Les pauvres clients que nous sommes ne sont pas les seuls à se voir présenter des vessies pour des lanternes. Le XIXe siècle avait déjà vu passer des matières premières à la qualité douteuse, comme ce musc qui se vendait plus cher que l’or, et était parfois coupé avec du sang ou du foie séché, permettant aux producteurs de réaliser quelques bénéfices additionnels. Certaines de ces pratiques ont cependant connu des prolongations contemporaines souvent passées sous silence. Posons le décor : avant les années 1980, l’approvisionnement en matières premières des marques était le plus souvent assuré par les parfumeurs eux-mêmes, connus pour leur intransigeance. Mais à mesure que la fabrication des fragrances fut confiée aux grandes maisons de composition, l’acquisition des matières premières revenait à des acheteurs moins exigeants, et plus prompts à négocier les prix. Entre 1975 et 1980, la qualité a donc commencé à baisser. L’étiquette de fraudeur a même entaché l’honneur des fournisseurs grassois : certains diluaient en effet les matières pour arriver au prix demandé par les acheteurs qui leur mettaient la pression. Pour désigner ces produits, on parle parfois d’essences « adultérées », coupées avec des produits moins chers (les sourceurs d’oud savent encore aujourd’hui par exemple qu’il n’est pas rare de se voir proposer une essence coupée à l’huile de santal et/ou de sésame).
C’est cette période sombre des années 1980 qui a notamment conduit à l’émergence de laboratoires comme celui de Monique Rémy (aujourd’hui LMR Naturals by IFF), ayant pour but de mettre sur le marché des produits certes plus chers, mais purs, proposés par des chimistes capables de sensibiliser une nouvelle clientèle à leur qualité.
Secrets de copistes
Dans les petites rues de Grasse et alentour, certains boutiquiers peu regardants n’hésitent pas à miser sur le prestige de la localité pour soutirer quelques pièces à leur clientèle. La stratégie : glisser à voix basse devant quelques estagnons prudemment avancés des phrases comme « c’est très confidentiel, mais c’est en fait ici qu’est fabriqué [insérez le nom du parfum du moment], nous n’avons pas les flacons bien sûr, mais si vous voulez le parfum, le voilà ». Voici comment, sur quelques mots susurrés, une échoppe vendant de pures imitations prend, pour le vacancier mal renseigné, des airs de boutique d’usine. Les formules des parfums n’étant pas protégées, il est vrai que ces copies ne sont pas à proprement parler « hors-la-loi ». Plus loin de l’aura du lieu, le subterfuge ne marchant pas, les fragrances copiées se rangent dans des reproductions de flacons et de packagings : la contrefaçon, ce cauchemar des grandes marques, s’étale sur le web, les marchés et aux abords des bouches de métro. Bien qu’illégale, elle semble cependant tolérée, et fait vivre des parfumeurs, des designers, des imprimeurs… Tristement, elle fait aussi partie du grand système de la parfumerie.
Mensonges tout naturels
« Mon parfum est à 90 % naturel » entend-on de plus en plus souvent, « et moi, 100 % naturel ! » renchérissent d’autres marques. Autre temps, autre concurrence ! Aux clients méfiants, on rappellera que pour produire une fragrance « naturelle à 90 % », il suffit que, pour un parfum dosé à 10 %, la solution alcoolique qui compose les 90 autres % du parfum (un mélange d’alcool et d’eau) soit d’origine naturelle – fabriquée à partir de betterave par exemple (ce qui est déjà le cas de la majorité des produits). L’estampille « 100 % naturel » recouvre quant à elle des réalités un peu trop complexes pour être bien décrite ici, elles ont d’ailleurs fait l’objet d’un article sur notre site. Qu’en retenir ? que dans bien des cas, un parfum « 100 % naturel » peut tout à fait être 100 % créé en laboratoire par le miracle de la chimie verte – ce qui, du reste, peut éviter d’épuiser l’eau et la terre, ne nous en plaignons donc pas.
Secrets des pyramides
« Alors, qu’y a-t-il dans ce parfum ? », ne manque pas de demander au petit personnel le client exigeant, avant de se voir réciter, comme une poésie à l’école, les arcanes de la « pyramide olfactive ». Notes de tête, puis de cœur et de fond, entrée-plat-dessert, introduction-développement-conclusion, papier-caillou-ciseaux : toutes les bonnes choses vont par trois, un principe bien français appliqué aux fragrances par le parfumeur Jean Carles, incontournable depuis. Pour voyager, on peut toujours lire la pyramide olfactive de Poème de Lancôme, connue pour sa mention du pavot bleu de l’Himalaya, de la fleur de litchi et du datura des sables, soit autant de plantes inutilisables en parfumerie, si ce n’est à des fins de douce rêverie. Alors, qu’y a-t-il vraiment dans mon flacon ? La pyramide olfactive parle-t-elle de contenu effectif, d’effets olfactifs ou d’inspirations ? Ça, c’est un secret, la règle est de ne jamais préciser, de bien tout mélanger.
Reste que la pyramide de Poème est unique, et mémorable (la création de Jacques Cavallier-Belletrud aussi, pour de meilleures raisons). Toutes les fragrances n’ont pas cette chance. Les longues soirées d’hiver, on peut se prêter à l’exercice inverse, enlever aux pyramides les noms et marques qui y sont attachés : si je vous dis « note de tête : bergamote, note de cœur : ambre gris et rose de Damas, note de fond : ciste labdanum », vous me dites ? En effet, cela pourrait être 50 % des parfums du marché de la niche, et c’est aussi Ambre nuit de Dior. Prises dans ce sens-là, les pyramides montrent vite leur part de mystère, voire d’absurdité. Amusez-vous à ce petit Jeopardy avec vos amis parfumistas, fous rires garantis. À ce niveau d’énigme, ce ne sont plus des pyramides, ce sont des Sphinx.
Techno-mensonges
« L’intelligence artificielle va révolutionner le parfum ! » clament les technophiles. Certains se prennent à rêver d’accords jamais sentis, de formules garantissant des succès planétaires. Le marketing fait miroiter son nouveau jouet. Il oublie aussi de donner la parole aux parfumeurs et développeurs, qui ne manquent pas de rappeler que les intelligences artificielles ne sont pas capables d’innover au-delà des « happy accidents » (dont seuls les parfumeurs bien humains peuvent identifier le caractère « happy »), car elles travaillent à partir de « big datas », de banques de formules existantes, que les algorithmes ressaisissent ensuite. L’IA est donc avant tout un outil de répétition rapide et de recombinaison de données existantes. Elle ne peut traiter qu’une situation qu’elle a déjà vue ou sur laquelle on lui a donné des règles : inutile d’espérer faire d’elle le prochain Alberto Morillas ou la prochaine Germaine Cellier. Qu’a-t-on tant aimé chez ces parfumeurs en effet, si ce n’est leur talent pour imaginer les senteurs neuves de mondes émergents, en s’affranchissant des règles existantes ?
Ce que l’IA risque par contre de révolutionner, au-delà du marketing, c’est surtout le marché de l’emploi dans la parfumerie, après que les parfumeurs auront nourri les machines de toutes leurs formules, entraîné les modèles et validé les résultats. Les entreprises les plus cyniques n’auront alors plus besoin que de quelques spécialistes à mi-temps pour faire fonctionner leur outil à actualiser les vieux tubes.
Self-made mensonges
La culture du secret de l’industrie du parfum et l’inlassable besoin de briller du marketing ont enfanté un monstre : l’arriviste clamant sur tous les toits « c’est moi qui l’ai fait » tout en étant incapable de rédiger une formule complète. Dernier scandale en date : Olivier Creed, à qui Gabe Oppenheim a consacré un ouvrage, The Ghost Perfumer, révélant que bon nombre des succès qu’il s’appropriait étaient dus au discret mais talentueux Pierre Bourdon. Cette histoire n’est hélas pas unique dans la parfumerie, tant s’en faut.
On considère que le premier à avoir fait usage de ces subterfuges est Paul Poiret, qui a imaginé le « parfum de couturier » en 1911 avec Les Parfums de Rosine. S’il se faisait photographier dans les laboratoires à proximité des alambics en prenant un air concerné, il confiait heureusement la création de ses parfums à des compositeurs de talent comme Maurice Schaller et Henri Alméras. Il se donnait néanmoins l’aura d’un créateur de fragrances, personnage qui gagnait alors en prestige.
Avant Olivier Creed, nombreux sont ceux qui se présentèrent comme « parfumeurs » bien qu’étant avant tout de talentueux chefs d’entreprise. Le plus célèbre était peut-être François Coty, à qui l’on attribue encore aujourd’hui la paternité unique de tous les succès de sa marque malgré le peu de preuves matérielles témoignant d’une activité de création solitaire. Coty collaborait étroitement avec les établissements Chiris, où il avait appris à travailler les matières premières, et où officiaient des parfumeurs de renom comme Vincent Roubert, qui finit par intégrer son entreprise en 1925 au poste de directeur technique. Si François Coty n’était sans doute pas le compositeur omnipotent que narre sa légende, sa vie de visionnaire du marketing et de directeur artistique génial a durablement marqué le siècle dernier. Or, dans ce XXe siècle valorisant les hommes maîtres et créateurs absolus de leurs empires, communicant le plus rarement possible sur la complexité de l’industrie, il était plus facile de séduire en se présentant tout simplement comme un « parfumeur », quitte à faire quelques petits arrangements avec la réalité. Si la tendance a faibli, chaque année amène encore son lot d’entrepreneurs gouailleurs tentant de se faire passer pour plus talentueux qu’il n’est – prudence donc, en attendant qu’il soit plus à la mode de dire à quel point une bonne direction artistique est ô combien rare ! Des sites (payants) comme Fragrances of the World remettent heureusement, autant que faire se peut, dans la mesure de l’accès à la vérité, les pendules à l’heure et créditent chacun à sa place, les parfumeurs de l’ombre comme les directeurs artistiques.
Mensonges par omission
Peut-on être parfumeur et se laisser tout de même prendre à ces exercices de simplification ? Il semblerait bien que oui. L’étude de l’histoire de l’industrie révèle presque immanquablement la chose suivante : derrière chaque créateur solitaire adulé se cachent de redoutables talents, souvent de sexe féminin, qui ont préféré rester dans l’ombre, ou à qui on n’a laissé que cette place. Même Edmond Roudnitska, nous explique Maïté Turonnet dans son livre, avait ses petits secrets : Moustache édité par Rochas en 1949 avait vraisemblablement été conçu par sa discrète épouse Thérèse (aujourd’hui célèbre grâce au merveilleux Parfum de Thérèse de Frédéric Malle), une ancienne ingénieure chimiste qu’il avait rencontrée chez De Laire, aujourd’hui Symrise. C’est d’ailleurs à la discrète Marie-Thérèse, la femme d’Edgar de Laire, neveu du fondateur de la maison, que l’on doit l’idée géniale d’assembler les molécules de synthèse avec des matières premières naturelles pour en faire des pré-parfums dès 1891.
Plus proche de nous, la stature de Jean-Paul Guerlain a fait oublier le rôle de la parfumeuse qui l’épaulait, Anne-Marie Saget, sans qui Parure (1975), Derby (1985) et Samsara (1989) n’auraient pas vu le jour (ce dernier ayant probablement été l’objet d’un concours interne à l’entreprise avant d’être finalisé par Jean-Paul Guerlain).
Une autre curiosité est à trouver dans ces fragrances attribuées à des parfumeurs qui n’en demandaient pas tant, comme Obsession de Calvin Klein (1985), souvent crédité à Jean Guichard dans les médias alors qu’il est l’œuvre de Bob Slattery, hélas mort peu après la sortie du parfum. Il est probable que la presse de l’époque qui cherchait à interroger le parfumeur, n’ayant accès qu’à son proche collaborateur, ait finalement omis de le nommer, la confusion des copiés-collés se chargeant du reste.
Reste ces fragrances au cheminement particulièrement obscure et romanesque comme Opium d’Yves Saint Laurent (1977), dont on se gardera pour l’heure de narrer la genèse tant les narrations contradictoires cohabitent. On peut tout de même noter que s’il est souvent crédité au seul Jean-Louis Sieuzac, ce parfum grandement inspiré de Youth Dew d’Estée Lauder est aussi passé entre les mains de Françoise Marin et Raymond Chaillan, sous la direction artistique attentive de Jean Amic qui dirigeait la maison Roure, aujourd’hui Givaudan.
Lorsqu’une marque a un projet de fragrance en effet, c’est à une maison de composition qu’elle le soumet le plus souvent et non à une personne en particulier. Les formules, bien que très confidentielles, peuvent donc être « ouvertes » à plusieurs des parfumeurs d’une maison et, ceux-ci ne travaillant de toute façon pas dans des cellules isolées, il arrive régulièrement qu’ils échangent sur leurs diverses créations, s’entraident, nourrissent une même formule de leurs accords indépendamment travaillés. Aujourd’hui, le caractère collectif de la création des parfums est heureusement de plus en plus pris en compte, ce dont témoigne la communication des maisons de composition comme IFF mais aussi de marques comme Lancôme, qui a récemment crédité Shyamala Maisondieu, Adriana Medina et Nadège Le Garlantezec de chez Givaudan pour la création d’Idôle. Ces noms reflètent-ils toujours la réalité du développement des fragrances, suffisent-ils à attester de la dimension collective de la création ? Rien n’est moins sûr, il reste souvent beaucoup de monde à ajouter (voire parfois à enlever) au générique !
Secrets d’atelier
Concevoir un parfum, c’est faire beaucoup de recherches. Nombreuses sont les marques qui répètent à l’envi que telle fragrance a demandé des années de travail, ou telle autre a nécessité des centaines d’essais. Il n’est cependant pas rare que la montagne accouche d’une souris, et que le précieux élixir ne brille que par son caractère passe-partout, ou pire, ressemble comme deux gouttes d’eau à une fragrance déjà connue. Les parfumeurs seraient-ils des cancres ? Nenni. Par contre, souvent sous pression, il leur est recommandé de faire bon usage de ces centaines de flacons qui encombrent leurs étagères. Une marque conciliante a soumis un brief un peu flou ? Il est peut-être temps de chercher un essai précédent qui pourrait lui suffire. Une maison peu aventureuse lorgne le succès d’un concurrent ? Sans doute est-il possible d’en proposer rapidement une copie suffisamment maquillée. Toute maison de composition qui se respecte passe de toute façon un temps substantiel à décortiquer les succès de ses rivaux et à apprendre à les reproduire puis s’en inspirer. Des succès qui, comme L’Eau parfumée au thé vert de Jean-Claude Ellena pour Bulgari, sont peut-être eux-mêmes d’anciens essais dormant sur une étagère après avoir été refusés par des directeurs artistiques manquant de lucidité.
Listes secrètes
Pour une marque de parfum, choisir la maison de composition avec laquelle elle va collaborer est crucial. Mais s’agit-il vraiment d’un libre choix ? Pas autant qu’on pourrait le croire, et lorsqu’une marque clame « pour ce projet, nous avons choisi le meilleur parfumeur », il y a parfois anguille sous roche. Pourquoi certaines marques travaillent inlassablement avec les créateurs d’une même maison de composition, même après quelques échecs commerciaux ? Pourquoi Tom Ford, après de nombreux succès signés Firmenich, confie aujourd’hui ses réalisations aux équipes de Givaudan ? Pourquoi les grandes marques ne travaillent jamais avec des indépendants ? La fidélité (ou le copinage) entre certes en jeu, mais aussi les « core lists ». Qu’est-ce à dire ?
Les grands groupes ne briefent pas toutes les maisons de composition pour une marque donnée, et encore moins tous les parfumeurs. Ils ne s’adressent qu’à ceux qui sont sur leurs « core lists ». Que faire pour intégrer cette élite ? L’excellence ne suffit pas. Il faut aussi… payer, d’une manière ou d’une autre. Notamment à travers des remises et autres arrangements commerciaux sans cesse renégociés. On comprend ainsi que les petits indépendants n’ont pas les épaules assez solides pour entrer dans ce jeu. Et si les offres faites aux gros clients ne sont pas suffisamment affriolantes, ceux-ci peuvent tout simplement exclure l’année suivante une maison de leur « core list ».
Origines secrètes
Ces dernières années, un mot a envahi le marketing : « storytelling ». Or, s’il y a un domaine dans lequel la parfumerie n’a pas de leçons à recevoir, c’est bien celui-ci. Rares sont en effet les maisons à ne jamais avoir embelli, quand ce n’est pas complètement inventé, l’histoire entourant la genèse d’une fragrance. Ainsi, la légende dit que Shalimar est né le jour où Jacques Guerlain ajouta une bonne louche d’éthylvanilline (une molécule artificielle alors nouvelle, plus intense que la vanilline) dans Jicky, le classique de la maison. La légende dit moins que Shalimar, paru en 1925, ressemblait comme deux gouttes d’eau à Émeraude de Coty, sorti quatre ans plus tôt.
Plus téméraire, dans son autobiographie de 1985 Estée: A Success Story, Estée Lauder raconte comment elle eut une révélation sur la qualité incomparable de son odorat et créa donc seule Youth Dew en 1953 en mélangeant des huiles odorantes (sans mentionner bien sûr Joséphine Catapano, la véritable parfumeuse). Ce goût du romanesque était aussi celui de Coco Chanel, connue pour son talent de conteuse face aux journalistes, quitte à faire quelques petites entorses au réel (le site de Chanel, comme un hommage, précise d’ailleurs étrangement que « le parfum Sycomore fut créé par Gabrielle Chanel en 1930 », oubliant Ernest Beaux et Jacques Polge au passage).
Rien de surprenant donc dans ce communiqué reçu il y a quelques semaines, nous apprenant que pour la création de Fenty Eau de parfum « Rihanna a personnellement sélectionné chaque ingrédient dans sa forme la plus pure et a travaillé avec le maître parfumeur LVMH de renommée mondiale, Jacques Cavallier ». Ainsi s’ouvre la réalité alternative dans laquelle Riri pondère l’Hédione et l’anthranilate de méthyle avant de confier ses inspirations à son quasi-assistant, Jacques Cavallier. Un roman de science-fiction qui vaut bien ceux qui l’ont précédé.
Secret-défense
Un des grands paradoxes de la parfumerie est de se présenter comme héritière de riches traditions, tout en refusant de se confronter à son histoire. Autant que faire se peut, on évite donc de parler des sympathies fascistes de François Coty, du trouble passé militaire d’Ernest Beaux, de l’engagement pronazi d’Eugène Schueller – fondateur du groupe L’Oréal – des liaisons scandaleuses de Coco Chanel avec l’occupant pendant la guerre, notamment décrites dans l’ouvrage de Hal Vaughan Dans le lit de l’ennemi: Coco Chanel sous l’Occupation.
Quand l’histoire de la littérature, de la musique ou de la peinture se construit sur les ambiguïtés de la vie des créatrices et créateurs, sur les tiraillements moraux sublimés par les œuvres, on voudrait nous faire croire que toutes les grandes figures de la parfumerie sont des prix Nobel de vertu. Une stratégie marketing sans doute momentanément efficace, qui hélas ne joue pas en faveur de l’enrichissement de la culture olfactive à long terme. Comment susciter un intérêt autre que passager et commercial pour la parfumerie si ses zélotes tiennent à vivre dans une réalité parallèle où les créateurs n’ont pas de tourments, pas d’aspérités, pas d’engagements, où ils ne sont que pure dévotion tels les saints de confiseur qui remplissent les vitrines des marchands de bondieuseries ? Comme toute culture, celle du parfum ne pourra grandir qu’en se penchant sur ses contradictions, sa part d’ombre qui est aussi sa part d’Histoire.
Mensonges d’influences
Le tableau ne serait pas complet sans évoquer les porte-paroles dociles de bien des discours ci-dessus : les influenceurs. On les reconnaît souvent à leur capacité à réciter sans trop réfléchir les dossiers de presse, en faisant défiler des produits qui se trouvent vite standardisés par les limites de vocabulaire de certains (it’s great, it smells fantastic). Ainsi les réseaux sont-ils envahis par une version contemporaine du Téléachat où Pierre Bellemare serait payé en flacons de parfum.
Comme leur nom l’indique, les influenceurs sont en quête d’un public influençable, d’autant plus qu’ils ne sont pas assujettis à la convention collective des journalistes qui stipule qu’« en aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l’éloge d’un produit, d’une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé. » Ceci permet aux moins honnêtes d’entre eux de toucher une rémunération tout en clamant leur impartialité (un vice qui n’est pas étranger au journalisme bien sûr, bien qu’il ne repose pas sur la même captation de l’attention sur les plateformes). Cependant, alors qu’ils sont aujourd’hui bien plus nombreux, beaucoup d’influenceurs passent des heures à préparer leurs interventions pour ne recevoir en retour qu’un flacon de parfum, pas toujours exceptionnel. Aussi, on ne sait plus trop si leurs mensonges doivent susciter l’agacement ou la pitié.
Mensonge romantique et vérité parfumée
Comme j’aime aller sentir les nouveautés en parfumerie, il se trouve une saynète que j’ai régulièrement vécue : en discutant avec les personnes chargées de la vente, on finit toujours par me « tester » : « vous travaillez dans le parfum, non ? – Non non. – Cependant vous connaissez bien le milieu ? – Oui, un peu, c’est vrai ». Cette réponse paraît leur permettre de cocher la case mentale « celui-ci est l’un des nôtres », et immédiatement les langues se délient : « oui, on nous dit de ne pas trop parler de ça », « oh, ce parfum, en fait, il paraît qu’il a été fait comme ça »… Des individus qui auparavant avaient des réparties robotiques s’illuminent, deviennent plus chaleureux, chose qui me semble infiniment plus désirable pour tout le monde, car qui aurait envie d’acheter un flacon à un distributeur automatique, même parlant ? L’industrie s’effondrerait-elle si soudainement ses techniques de vente devenaient un peu plus honnêtes et humaines ? C’est sur ces considérations un brin naïves que je rentre parfois chez moi, en oubliant les immenses enjeux commerciaux qui conditionnent tous ces discours frisant souvent l’absurde.
Pourtant, on pourrait imaginer quelques échappatoires pour la vérité dans le monde impitoyable de la parfumerie. Une partie de ses mensonges n’existe que pour des raisons de profit à court terme (sans garantie qu’une révélation ne coûtera pas bien plus cher par la suite), ou parce que « l’air du temps » semble commander l’usage de propos tape-à-l’œil, leurrant et simpliste, face à un public que l’on ne veut pas prendre le temps d’instruire sur l’histoire et l’industrie. Quand l’illusion prend fin cependant, ce même public est tout à fait capable de brûler ses anciennes idoles et les vouer aux gémonies, d’autres industries en ont fait les frais. Cela voudrait-il dire qu’il faut en finir avec la rêverie et le romantisme qui entoure encore le parfum ? Pas forcément. Aragon lui-même avait théorisé le « mentir-vrai », une forme d’écriture du réel qui, pour rendre compte de celui-ci, s’en écarte, le détourne, toujours cependant en refusant de le faire paraître pour ce qu’il n’est pas, et en évitant de considérer le lecteur comme une « cible » à « influencer ». Bien des parfumeuses et parfumeurs renouvellent leur discours sur le parfum, et réinventent la position de chacun face aux créations. Est-il cependant possible de déployer ces narrations subtiles sur les plateformes vivant de la rapine de notre « temps de cerveau disponible », aujourd’hui tant convoitées par les grosses machines industrielles ? Rien n’est moins sûr.
___
DOSSIER « TRANSFORMER LES DISCOURS DE LA PARFUMERIE »
Visuel principal : Le Secret, William-Adolphe Bouguereau, 1894 (détail). Source : Wikimedia