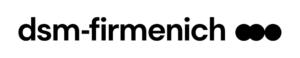Derrière une poignée de grands noms, l’industrie du parfum est pendant des années restée le creuset de stéréotypes bien ancrés et d’inégalités de genre. Retour sur un long chemin pavé (ou pas) de bonnes intentions, éclairé par plusieurs témoignages.

Femmes en parfumerie : la face cachée de l’industrie
par Jessica Mignot, Jeanne Doré
Categories : Culture olfactive, Histoire, Odor di femina
Pas de commentaires
--
Jessica Mignot
Rédactrice en chef web associée des sites Nez et Auparfum. Titulaire d'un diplôme en philosophie, elle s'intéresse à l'esthétique du parfum et de la cuisine, à l'éthique et à l'épistémologie. // Digital Deputy Chief Editor for Nez and Auparfum. She holds a master's degree in philosophy and is interested in the aesthetics of perfume and cooking, ethics and epistemology.
Voir tous ses articles --Jeanne Doré
La cofondatrice du magazine en ligne Auparfum et de Nez a deux passions : sentir et écrire. The cofounder of online magazine Auparfum and Nez is passionate about two things: smelling and writing.
Voir tous ses articles