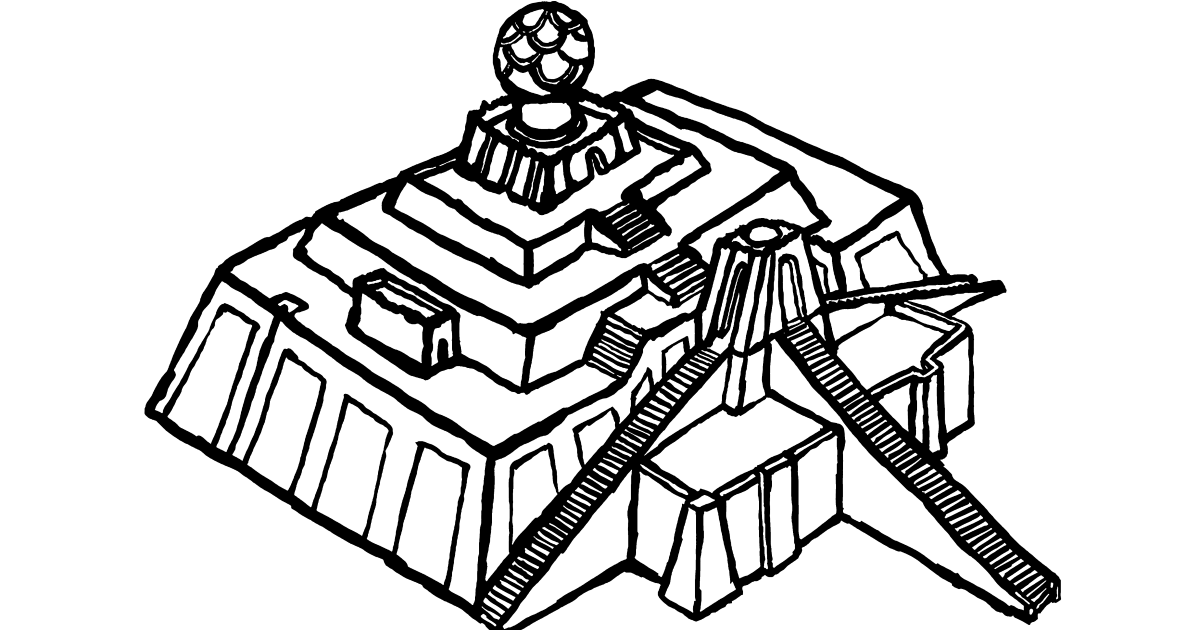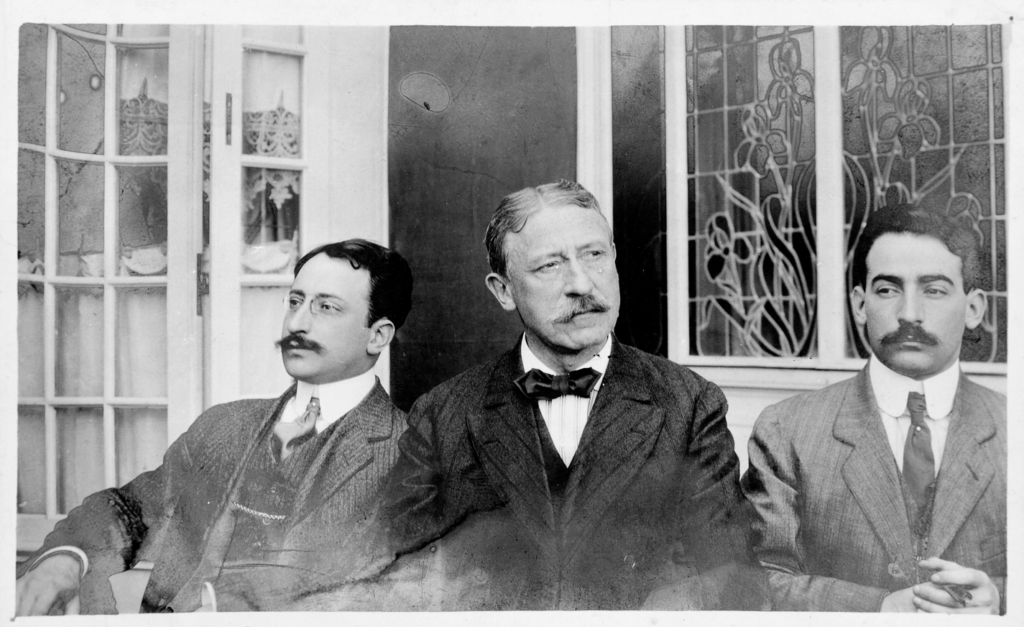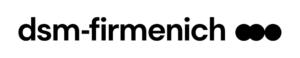Si la fête d’origine celtique connaît plus d’engouement outre Atlantique, elle est devenue, chez nous aussi, l’occasion de nous plonger dans une atmosphère automnale, à la lueur des bougies. Pour célébrer à notre manière cette tradition, nous vous proposons un conte d’Halloween olfactif, où l’on croise un chercheur et un parfumeur, entre odeur de la peur et sillage d’un fantôme…
Je rentre du travail, un peu fatiguée ; le bruit environnant, habituel, pèse sur mes épaules. Je pense vaguement à ma journée, à demain, aux courses à faire. Mais des rires me tirent de ma torpeur : quelques enfants déguisés courent entre les passants pressés de quitter les transports. Citrouilles géantes, fantômes immaculés et zombies souriants vont quémander avec malice leurs bonbons. C’est Halloween, c’est vrai : j’avais oublié. Le souvenir de ces soirées déguisées me réconforte et me rend plus légère, et me voilà déjà sur le pas de ma porte.
La nuit est déjà tombée lorsque je la franchis. Enfin chez moi ! Pour me mettre dans l’ambiance, j’allume une bougie : son odeur de fruit vert, à la fois végétal, lacté, lactonique et musqué, se répand dans toute la pièce. Ronde, comme un cocon à l’image du fruit qu’elle entend interpréter, la Citrouille de Diptyque diffuse amplement ses effluves confortables, crémeux, légèrement épicés, qui me mettent l’eau à la bouche.

Cela me donne envie de cuisiner une tarte pour ce soir. En coupant ma courge, cis-3-hexenol évoquant l’herbe coupée et diacetyl aux notes beurrées me montent au nez. Après l’avoir faite revenir à la poêle pour attendrir sa chair orangée, je l’arrange sur une pâte brisée. Une pincée de cannelle et de muscade, quelques morceaux de châtaigne, un peu de sel, et hop, au four !
Mais lorsque je reviens vers le plan de travail, c’est une autre odeur, nettement moins agréable, qui me surprend : quelques gouttes de sang, ferreux et rappelant la viande fraîche en raison de l’époxydécénal qui le compose, brillent sur le couteau. Mmmh… J’ai sûrement dû me couper ; mais, fait étrange, je ne trouve pas de trace sur mes mains… Un frisson me secoue, et l’on sonne à la porte au même moment : je sursaute. Une seconde plus tard, respirant un bon coup, je me retrouve nez à nez avec des petits monstres qui attendent leurs trésors sucrés. Une poignée dans chaque chapeau magique, et j’échappe ainsi au sort menaçant d’une sorcière transportant baguette et balai. La porte refermée, entre deux états, j’ai soudain la crainte de sentir mauvais, après toute ces émotions. Cette peur, qui tourne à la pathologie, porte même un nom : l’autodysosmophobie, à ne pas confondre avec la phantosmie, qui a été l’une des conséquences du Covid-19, et qui consiste à percevoir des odeurs – le plus souvent désagréables – sans qu’il n’y ait de source objective.
Je cherche à me ressaisir : direction l’armoire à parfums, et restons dans le thème ! Côté citrouille, Like This d’État libre d’Orange me plonge dans l’univers fantastique de Tilda Swinton imaginé par Mathilde Bijaoui de Mane : un crumble de potiron, réchauffé d’immortelles et d’épices, qui me rassure par son côté alimentaire et velouté. Juste à côté, le flacon souple de Fabulous me de Paco Rabanne reflète mon visage déformé sur sa surface métallisée : j’en vaporise sur mon poignet, et y retrouve la chair de la courge mêlée de rhubarbe, dans un cocon de vanille amandée.

Un éclat de métal frappe soudain le sol, me tirant de mes rêveries olfactives. Je me retourne rapidement : le couteau est à terre, tournoyant encore, répandant les gouttelettes pourpres sur le carrelage froid. Effrayée, le cœur battant, les muscles tendus, j’écoute avec attention, le souffle court. Le bruit régulier du four se superpose à ceux, plus aléatoires mais plus sourds, des sons extérieurs : sifflement du vent, pas hâtifs sur le feuillage du sol, portes que l’on ouvre ou que l’on ferme. Les odeurs familières de la pièce, bois ciré, courge dans le four, bougie qui se consume, me réconfortent peu à peu.
J’ai eu si peur que j’ai l’impression que si quelqu’un rentrait dans la pièce, il le saurait rien qu’à vue de nez, malgré le parfum que j’ai mis pour me rassurer. Mon téléphone sonne : improbable coïncidence, c’est Hirac Gurden, directeur de recherche en neurosciences au CNRS… Il tombe à pic, j’en profite pour le questionner sur l’odeur de la peur ; il semble intarissable sur le sujet : « Les études sur la peur s’ancrent dans le cadre des recherches sur les contagions émotionnelles, positives ou négatives, qui ont lieu depuis une grosse dizaine d’années. Pour que les résultats soient probants, on procède à diverses mises en situation, du visionnage d’un film d’horreur au saut en parachute, en posant des coussinets sous les aisselles des individus. Lorsqu’on fait sentir ces odeurs axillaires à des personnes qui n’en connaissent pas l’origine, celles-ci s’accordent en grande majorité à dire qu’il s’agit d’une odeur de peur – comme l’on sait désormais qu’il y a de même des odeurs de joie – et les mesures parallèles de paramètres corporels (tension artérielle, rythme cardiaque…) concordent avec cette affirmation. On ne sait pas précisément de quoi est composée l’odeur de peur : c’est un ensemble complexe, particulièrement chargé en stéroïdes, en androstérone, et en acides gras. Elle correspond à une réaction physiologique : lorsque j’ai peur, mon corps met tous ses systèmes cérébraux en marche pour que je puisse me défendre. Au niveau neuronal, c’est notamment l’amygdale, une structure qui est composée de neurones impliqués dans les émotions, qui est activée. Le cerveau envoie un signal d’activation déclenchant la décharge d’adrénaline dans le sang par les surrénales, ce qui permet de signaler très rapidement à tout le corps qu’il faut se préparer à fuir : le rythme cardiaque et la respiration s’accélèrent, les yeux se dilatent, les muscles se contractent, la température corporelle augmente…
Chez l’homme, il est difficile de savoir s’il y a des odeurs animales qui provoquent la peur de manière innée, comme c’est le cas pour la souris avec l’urine de renard. Mais l’odeur de brûlé fait partie de celles qui provoquent cette réaction physiologique. Compte tenu de l’importance vitale de cet axe entre le système olfactif et le corps, les personnes anosmiques, qui sont dépourvues de ces signaux, vivent dans un état de stress permanent, parce qu’elles savent que leur odorat ne peut pas les protéger des incendies, par exemple. C’est un handicap sensoriel majeur dans la vie quotidienne, qui concourt certainement au fort taux de dépression dont souffrent ces personnes.
Et l’on sait aussi que l’odorat va teinter émotionnellement notre perception du monde environnant : en présentant à un individu qui sent la sueur de stress un visage neutre (même s’il ne la perçoit pas de manière consciente), il l’interprète comme un visage apeuré. Ceci nous rappelle que les odeurs sont le moyen de communication le plus ancien, qui permettent de faire part d’un danger même avant qu’il ne soit visible, et même avant que l’on ne sache parler. »
À défaut d’être rassurée, me voilà donc informée : si je veux effrayer ceux que je rencontre, j’opterai dans mon armoire à parfums pour Bois d’ascèse de Naomi Goodsir ou Cuir de Mona di Orio, pour leurs notes fumées incandescentes. Ou peut-être pour les odeurs métalliques sanguines (mais pas que) de Sécrétions magnifiques d’État libre d’Orange, ou encore celles évoquant la chair animale et sa fourrure dans M/Mink de Byredo ?

Bon, il faut que je pense à autre chose ! Mon nez m’indique que ma tarte est prête à être dégustée, voilà une bonne nouvelle. Je m’installe sur le canapé, une fois n’est pas coutume, un plaid sur les genoux, à la lueur de la bougie dont la flamme vacille tranquillement. La pâte croustille puis fond dans ma bouche, la citrouille crémeuse s’y mêle, douce et épicée à la fois. Un délice ! Mon regard se pose machinalement sur le sol, où je remarque la présence d’un papier annoté. Délaissant ma fourchette, à moitié perdue dans mes pensées, je me penche un peu pour le lire :
« Dans les caveaux d’insondable tristesse
Où le Destin m’a déjà relégué ;
Où jamais n’entre un rayon rose et gai ;
Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse,
Je suis comme un peintre qu’un Dieu moqueur
Condamne à peindre, hélas ! sur les ténèbres ;
Où, cuisinier aux appétits funèbres,
Je fais bouillir et je mange mon cœur,
Par instants brille, et s’allonge, et s’étale
Un spectre fait de grâce et de splendeur.
À sa rêveuse allure orientale,
Quand il atteint sa totale grandeur,
Je reconnais ma belle visiteuse :
C’est Elle ! sombre et pourtant lumineuse. »
Je reconnais la première partie du poème Le Fantôme, de Baudelaire, visiblement déchirée des Fleurs du mal. Que fait-elle là ? Intriguée, j’explore la pièce du regard et… Oui, là, juste à l’endroit où était posé le papier, il semble y avoir une sorte de trappe qui se découpe dans le parquet lisse et brillant. C’est absurde, je ne l’avais jamais vue… J’essaye de l’ouvrir, elle cède et découvre des marches. Sûrement une cave : pourquoi les anciens propriétaires ne l’ont jamais mentionnée ? Prête à y découvrir des trésors oubliés, je m’y engage, tout feu tout flamme. Dans l’obscurité poussiéreuse, sourde et étouffante, j’aperçois une porte, décorée d’un écriteau : « Centre culturel d’Alban Mainville, Toulouse, 2021 : exposition “De la matière à l’esprit” ». Prenant mon courage à deux mains, de plus en plus intriguée, j’en tourne la poignée : une musique flotte dans l’air, se mêlant à la fragrance aldéhydée, blanche, mais aussi ronde et boisée qui emplit la pièce. Je frissonne, comme traversée par un souffle étranger. Pierre Bénard, parfumeur et fondateur de la société Osmoart, que j’ai rencontré récemment lors d’un colloque, se trouve dans la pièce. Il m’invite à sentir ses « olfactoriagmi » où sont déposées les matières premières de son parfum de fantôme, Yurei : immortelle à la symbolique forte, cèdre imputrescible utilisé pour les sarcophages, patchouli boisé, ciste résineux capable de renaître de ses cendres… Le parfumeur m’explique sa démarche, visiblement pas plus perturbé que ça par notre présence ici : « J’ai imaginé l’odeur d’un fantôme comme une allégorie du parfum : à la fois présent autour de vous, transparent et impalpable, c’est un messager qui fait la connexion entre morts et vivants. Le parfum – dans son sens originel de per fumum – est lui aussi sous-tendu par cette notion : on brûle de l’encens pour communiquer avec l’au-delà, on embaume les corps… Je rappelle cette idée avec l’oliban. J’ai aussi créé un accord encaustique, pour figurer une maison habitée, hantée. Un accord aldéhydé, créé uniquement à partir de molécules de synthèse, évoque un fer à repasser qui glisse sur le suaire, le drap du fantôme. J’ai aussi repris l’accord « hug me » que l’on doit à Sophia Grosjman, mais en remplaçant la Galaxolide par un autre musc de synthèse, le Phantolide, tout indiqué pour ce projet ! Cet accord, comme son surnom l’indique, enlace, fait ressentir une présence, comme une aura – et me permet aussi de citer mes mentors en parfumerie, de dire que celle-ci a une histoire. C’était l’un des objectifs de ce travail, et d’Osmoart en général : positionner le parfum comme création artistique et non plus seulement comme produit commercial, pour qu’il inspire un public plus varié, tout en faisant œuvre de pédagogie afin de transmettre des connaissances.
Et ce projet, nous l’avons porté à plusieurs : le nom du parfum, Yurei, vient de « Yūrei-zu », un genre de l’art japonais consistant en images peintes ou estampes de fantômes. Pour le représenter, outre une série d’étude photographique d’une concrète de rose damascena que j’ai exposée et qui dévoile la capture de l’âme de la fleur, de son essence, il y a la photographie de Nicolas Sénégas. Celui-ci a capturé les volutes de la contorsionniste Lise Pauton : un écho puissant aux premières estampes japonaises où le fantôme est représenté sans pied ni jambes, mais aussi à cette danse du corps obscur qu’est le buto. Dans ses mains, les fleurs de pavot font un clin d’œil aux Paradis artificiels de Baudelaire. J’ai également composé la musique que vous entendez, avec les voix de Miku Koyama pour sa lecture de la version japonaise du poème “Le Parfum” de Charles Baudelaire et celle du chanteur Wilfried Besse pour les paroles, accompagnée des images de Margot Lançon ».

Faisant un pas de côté, Pierre Bénard m’invite à ouvrir une autre porte, où l’inscription indique : « De la matière à l’esprit, Halo 2 : château du Domaine de Caladroy, Pyrénées Orientales, août 2022 ». Allons-y ! C’est un lieu plus délabré, propice à créer une atmosphère hantée. Des dame-jeanne anciennes, grosses bonbonnes de verre, exhalent les effluves des matières premières. Et le parfum de la dame blanche, figuré par le jasmin, habite les lieux. « Cette série est aussi une manière de dire que chacun possède son propre fantôme, et de créer des espaces qui puissent toucher tout le monde, initiés ou non, enfants et adultes, car il y a différentes approches entremêlées offrant différentes grilles de lecture. Nous aimerions prévoir un Halo 3 dans un autre lieu, pour une nouvelle variation », termine Pierre Bénard avant de me laisser repartir, toujours accompagnée par le parfum d’un esprit errant, qui me semble désormais plus familier.
Bercée par ces rêveries fantomatiques, je suis un chemin en pierres moussues, planté de bougies vertes à l’odeur vanillée qui m’évoque les bonbons que je dégustais à la même époque lorsque j’étais enfant – mes yeux glanent leur nom : Lord of Misrule, de Lush.

Lorsque j’ouvre les yeux, je suis allongée dans mon canapé. Je regarde l’horloge : il est bientôt 8 heures. J’aurais donc dormi tout ce temps ? Les parfums, les couleurs et les sons s’entrechoquent encore dans mon esprit, tandis que le jour des morts m’accueille dans tout son hommage festif aux âmes de ceux qui nous ont quitté : au Mexique, les autels se chargent encore d’offrandes à la mémoire de défunts. Pour ce nouveau jour, De Los Santos de Byredo sera tout indiqué : encens rituel, sauge purificatrice et fraîcheur résineuse y célèbrent la vie dans un voile musqué qui m’apaise et illuminent l’atmosphère. Lorsque je me dirige vers l’armoire à parfums, je remarque que la trappe de la veille a disparu : je retrouve pourtant bien le poème, juste à côté de l’assiette où ne restent que quelques miettes de la part de tarte, mais il est plié en petit origami et porte encore un instant, j’en suis sûre, l’odeur du fantôme sentie cette nuit, avant de disparaître à demi pour venir hanter ma mémoire, alors que le soleil perce chaleureusement entre les rideaux.

Visuel principal : Henry Fuseli, Le Rêve du berger, 1793