Cette publication est également disponible en :
![]() English
English
Dans le discours des marques, la parfumerie durable est régulièrement réduite à la parfumerie naturelle, jouant avec le fantasme que renvoie l’image de cueilleurs de roses dans l’aube naissante. L’industrie est pourtant confrontée à de nombreuses limites quant à cette imagerie. Le naturel peut-il être si facilement considéré comme la meilleure voie vers une production plus responsable ? Profil de la plante comme du producteur, lien entre les différents acteurs, valeur financière accordée au produit, rendement, processus de transformation et gestion des déchets sont autant de critères à prendre en compte lorsque l’on cherche à déterminer l’impact à la fois environnemental et social des matières premières naturelles.
L’impact environnemental : une industrie de monocultures ?
Prendre la mesure de cet impact environnemental n’est pas chose aisée, car les quelque 30% de naturels qui composent la palette sont divers. Fleurs, racines, fruits, bois, résines, épices ont chacun des caractéristiques botaniques et géographiques variables. Mettons de côté les matières animales, qui si elles font l’objet d’une problématique éthique, sont désormais très peu employées.
Première difficulté : l’industrie du parfum n’est pas seule responsable à pouvoir maîtriser des cultures dont elle n’est pas toujours directement à l’initiative. Les marques, qui vendent le produit fini, font généralement appel aux maisons de composition pour la création olfactive. Or celles-ci achètent souvent les matières premières naturelles à des producteurs qui fournissent également l’aromathérapie et l’aromatique alimentaire. C’est le cas pour l’essence d’agrumes, l’une des plus grosses productions mondiales[1]Les plus grosses productions d’huiles essentielles mondiales sont les agrumes et les menthes, suivis de l’eucalyptus, de la citronnelle, du clou de girofle, du lavandin et du cèdre. Source : … Continue reading: on utilise l’écorce de fruits employés par l’agro-alimentaire pour leur jus. Si la culture d’arbres fruitiers à grande échelle est polluante, la parfumerie, elle, ne fait qu’en utiliser les sous-produits.
Même lorsque les plantes sont plus directement destinées à l’industrie, la mise en place d’initiatives demande une organisation globale, qui n’est pas toujours le fait des maisons de compositions elles-mêmes. C’est le cas de la lavande et du lavandin, qui occupent 49 % des surfaces des Plantes à parfum, aromatiques et médicinales françaises[2]La culture des PPAM représente, en France en 2021, 67 513 ha et 6 527 producteurs. Les plantes à parfum sont les premières surfaces du secteur avec 37 897 ha en 2021 et 3 espèces prédominantes : … Continue reading. Grâce notamment au Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) qui représente l’ensemble de la chaîne – producteurs, distillateurs, coopératives et acheteurs directs – et est reconnue par le ministère de l’Agriculture, la filière peut mettre en place des plans d’action à valeur nationale pour que l’impact environnemental soit décisif. Le programme « Green & Lavandes »[3]Piloté par le Fonds de Dotation pour la Sauvegarde des Lavandes de Provence, qui permet de collecter des fonds pour aider les producteurs à faire face aux enjeux futurs. a récemment lancé une étude de l’ensemble de la chaîne, nécessaire pour éviter les fausses évidences. Contrairement à ce que laissent imaginer les champs mauves de Provence qui s’étendent à perte de vue, « il y a assez peu de monoculture de lavande. Lorsqu’elle existe, elle répond surtout à une réalité de terrain : sur ces zones, pas grand-chose d’autre ne pousse » précise Pierre-Philippe Garry, administrateur du CIHEF et directeur des opérations chez Bontoux, société productrice et fournisseur de naturels. Il s’agit d’une culture « qui favorise la biodiversité : elle amène de nombreux insectes, favorise la pollinisation, et permet également la production de miel de lavande, qui représente 10% de la production de miel français » ajoute Charlotte Bringer-Guerin, chargée d’affaires réglementaires & environnement du CIHEF. La part du bio y est importante[4]En France, plus de 50 % de la production de lavande et plus 10 % de celle de lavandin sont bio – une part en augmentation depuis plusieurs années, et nettement supérieure aux 12% que … Continue reading, mais « l’offre dépasse la demande, et toutes les productions bio ne trouvent pas forcément un acheteur qui souhaite y mettre le prix. Elles devront alors être vendues sans la mention, et leur prix baissé en conséquence. » déplore Pierre-Philippe Garry. En effet, le lavandin est destiné en grande partie aux produits détergents, qui trouvent peu d’intérêt marketing à revendiquer le bio. De plus, « un désherbage mécanique, nécessitant l’emploi de machines fonctionnant au gasoil, peut être parfois plus néfaste que les désherbants. Il faut étudier le cycle de vie complet du produit », explique-t-il.
Cependant, pour les plantes cultivées à l’échelle mondiale, une telle organisation n’est pas systématique. Dans l’ensemble, la monoculture n’est pas la norme, ce qui est un point positif pour l’environnement : « sur ce point, les pays perçus comme “en développement” sont finalement plus respectueux de la biodiversité : culturellement, les familles travaillent souvent de petites parcelles agricoles en modèle de polyculture » remarque Élisa Aragon, co-fondatrice et CEO de la société de production Nelixia, au Guatemala. Mais seules les initiatives particulières, isolées, semblent alors possibles a priori.
La problématique de l’éloignement : vers plus de transparence ?
Si la limitation des monocultures a un avantage écologique évident, l’éloignement et la multiplication des acteurs posent d’autres types de problèmes. Celui de la transparence a été la bête noire de l’industrie pendant des décennies : « Un gros travail a été fait afin d’identifier les différents maillons de la chaîne de production : les maisons de composition sont désormais plus en mesure de connaître les fermiers, collecteurs et distillateurs à l’origine des matières qu’ils achètent » souligne Dominique Roques, sourceur chez Firmenich. Les marques ont des impératifs environnementaux et sociaux croissants, répondant à la demande des consommateurs pour des produits plus éthiques. Mais les maisons de composition n’ont pas toujours les moyens de mettre en place des changements elles-mêmes : elles passent alors par l’intermédiaire de producteurs, qui ont une vision d’ensemble des acteurs. Ceux-ci gèrent le décalage entre les exigences marketing et la réalité de terrain : « Les industries européennes sont évidemment éloignées de la réalité locale. Une communication directe pour expliquer le temps requis pour tout changement et leur complexité est donc extrêmement importante » insiste Elisa Aragon. Leur rôle est essentiel pour accompagner les cueilleurs, récolteurs, gemmeurs à mettre en place des systèmes plus vertueux : « Nous prenons toujours en compte de nombreux facteurs, car la durabilité est multi-dimensionnelle. Il faut d’abord comprendre la situation socio-économique du producteur et les spécificités de la matière première : dépend-il de cette culture ? Quelle est sa situation socio-économique ? Quels sont les besoins de la plante en eau, en soleil, en intrants ? Quels sont les pesticides utilisés ? On pourra alors faire une analyse de risque permettant d’établir une réponse adaptée » poursuit-elle.
La transformation des modes de production implique donc un changement de la part de tous les acteurs, et pose également la question de la valeur que l’industrie accorde aux produits dont elle dépend.
Redéfinir la valeur : une nécessité oubliée ?
Si les sociétés de composition n’offrent pas toujours de garanties d’achat, c’est d’abord lié au fonctionnement même de l’industrie. Lorsqu’une marque décide de créer un parfum, elle met en compétition différentes sociétés, dont une seule gagnera le projet et pourra vendre son concentré : « le jeu de la concurrence fait que les maisons de compositions ont assez peu de visibilité sur les projets qui aboutiront à terme, et donc sur les produits qu’il faudra acheter », souligne Dominique Roques. C’est pourquoi les producteurs accompagnent les paysans à diversifier leurs acheteurs et leurs cultures, leur permettant de gagner en résilience. Mais Mathilde Voisin, marketing manager ingrédients de la société Mane, rappelle que ceux-ci ne sauraient porter le poids de l’industrie sur leurs épaules: « Nous avons en tant que société de composition notre rôle à jouer en achetant les matières premières tous les ans, et pas seulement quand nous en avons besoin. » Mane a ainsi mis en place une politique d’achats responsables en 2009 visant à engager ses fournisseurs dans une démarche durable : « Nous leur faisons remplir un questionnaire et leur proposons un accompagnement sur cette base, mais ce n’est pas une démarche autoritaire. Ce travail colossal est essentiel : on ne peut pas prétendre à de beaux produits sans avoir notre responsabilité. » Cela implique aussi de ne pas toujours répondre à la demande de certains clients, qui souhaiteraient pouvoir revendiquer de nouvelles essences dans leurs produits : « il nous faut leur expliquer que mettre en place une culture, cela nécessite un engagement de notre part. Nous devons garantir aux agriculteurs que nous travaillerons avec eux sur le long terme : c’est une facette de la durabilité que l’on oublie parfois », poursuit-elle.
Pour amorcer un véritable changement, encore faut-il que les exigences des marques soient perceptibles comme une plus-value financière pour les plus fragiles. Mais les acheteurs profitent parfois de traditions installées pour ne pas rémunérer les paysans à leur juste valeur : « L’industrie doit rendre un hommage beaucoup plus concret à l’aspect luxueux de ces ingrédients, puisqu’elle reconnaît leur rareté et leur beauté. Or nombre d’entre eux ne coûtent pas très cher, et une augmentation serait souvent tout à fait supportable pour les maisons de composition » rappelle Dominique Roques.
Afin de favoriser des changements de pratiques et récompenser les efforts, certains cherchent des solutions. Le label Bas Carbone créé par le ministère de l’Écologie permettrait ainsi de court-circuiter le défaut d’investissement des acheteurs : des entreprises peuvent financer des projets “bas-carbone” comme forme de compensation à leurs propres émissions. Il est en cours de mise en place au sein de la filière lavandicole par le CIHEF : « Ce principe permet de soutenir financièrement les producteurs qui font des efforts pour des pratiques plus vertueuses » estime Charlotte Bringer-Guerin. Mais la démarche a ses limites évidentes, et rappelle que changer les habitudes de manière globale demande un accord de tous les acteurs plutôt que des solutions de secours. Dominique Roques a cherché à pallier ce désordre en organisant une démarche de rassemblement et de dialogue nommée “Naturals Together” il y a quelques années, pour ouvrir un débat entre producteurs et acheteurs. Mais la notion de durabilité étant devenue un argument de vente pour les sociétés de composition, elles voudraient se l’approprier de manière exclusive. Or ce système concurrentiel semble peu compatible avec la démarche commune et coopérative qu’impliquerait un changement global, et place les paysans dans le flou.
La certification, rempart à l’opacité ?
La certification pourrait sembler idéale, face aux discours parfois fractionnés des maisons de compositions et aux exigences diverses des marques. Souvent déployée à l’échelle mondiale, elle permettrait de donner un ensemble de critères uniques, invariables et ainsi, plus objectifs. « Elles sont cependant nombreuses et ne sont pas toutes destinées au même public : Fair for Life [jaugeant le commerce équitable et les filières responsables], For Life [pour la responsabilité sociétale], et Fairwild [qui encadre la cueillette durable] sont plutôt destinées aux producteurs et acheteurs de matières premières. Ecovadis et Sedex sont développées pour les entreprises entre elles. D’autres, comme CDP et Dow Jones, sont quant à elles recherchées par les investisseurs », clarifie Valérie Lovisa, fondatrice d’Abtys, une agence de conseil dans le domaine de la RSE appliquée aux industries du parfum et de la cosmétique.
Pour les certifications Cosmos Natural ou Cosmos Organic (ou Cosmos Certified et Cosmos Approved pour les ingrédients), le secteur de la parfumerie reste peu représenté, « probablement parce que le naturel est complexe techniquement en parfumerie, mais aussi parce que l’imaginaire convoqué par le marketing n’est pas toujours en adéquation avec le bio » suggère Nicolas Bertrand, directeur de l’association Cosmébio et de l’organisme certificateur Cosmécert. Les exigences pour obtenir la certification ne s’arrêtent pas aux ingrédients comme on le pense souvent, mais à une amélioration de l’ensemble de la chaîne, jusqu’au packaging. Le certificat doit être renouvelé tous les ans, avec un audit sur site, « ou un document déclaratif décrivant précisément les procédés d’obtention d’obtention pour les matières premières Cosmos Approved ». Les entreprises certifiées peuvent rejoindre l’association Cosmebio, qui porte le label éponyme. Née en 2002, elle compte aujourd’hui plus de 500 sociétés adhérentes s’engageant à respecter son manifeste. Celui-ci appelle à un changement d’attitude global visant à réduire drastiquement notre consommation, sans quoi le bio ne saurait être suffisant.
Mais la certification, quelle qu’elle soit, n’est pas toujours idéale, car elle peut laisser de côté les plus petits, qui ne peuvent pas s’offrir les labels et pourraient disparaître par une invisibilité relative : « Elle est parfois problématique, car elle peut être punitive, et pousser les agriculteurs à cacher les problèmes, sur lesquels on ne peut alors plus agir. Or on ne peut pas exiger de tous les producteurs que leurs pratiques correspondent directement à nos exigences. Il faut plutôt viser l’accompagnement vers de meilleures pratiques. C’est ce que fait l’UEBT, avec son programme de vérification », explique Elisa Aragon. Essentielle sur la question du sourcing des naturels, l’Union For Ethical Biotrade est une association à but non lucratif qui voit le jour en 2007, dans le but de promouvoir un sourcing respectueux de la biodiversité et des acteurs. Elle est à l’origine d’une certification d’ingrédients depuis 2015, et d’une certification de systèmes d’ensemble depuis 2018. Mais elle a également créé ce système de vérification, plus flexible, qui vise plutôt à accompagner l’amélioration qu’à la sanctionner.
La certification des entreprises et des marques pourrait être une solution, dans la mesure où elles sont financièrement plus à même d’en payer le prix. B Corp, né en 2006 aux Etats-Unis, porte sur des composantes à la fois sociales, environnementales, de transparence et de responsabilité légale : « L’un des intérêts de B Corp est de créer une communauté de sociétés qui peuvent s’inspirer les unes des autres, et qui soient identifiables par les consommateurs pour leur impact positif. Cette certification a été pensée pour favoriser la collaboration, comme un cercle vertueux. Cela permet de redéfinir la notion de réussite dans le monde de l’entreprise, en faisant de l’impact environnemental et social positif une valeur essentielle – et ainsi d’impulser un changement global puissant », explique Valérie Lovisa. Pour y prétendre, les marques sont invitées à remplir gratuitement un premier questionnaire sur internet, intitulé le business impact assessment (BIA) : «Le libre accès au questionnaire permet à chaque entreprise de s’auto-évaluer, d’identifier ses forces et de définir des points d’amélioration sur lesquels elle pourra travailler ultérieurement », souligne-t-elle. Une fois le BIA soumis, B Lab demandera la justification de 10% des informations partagées. En vue d’obtenir la certification B Corp, chaque compagnie doit atteindre un minimum de 80 sur 200 points. De telles initiatives laissent entrevoir des dynamiques plus vertueuses à l’avenir, en faisant porter le coût de la certification aux plus puissants.
Nous pouvons également nous poser la question de la valeur d’un ingrédient certifié revendiqué dans un parfum sans proportion mentionnée, tous les autres étant laissés dans l’ombre. La pratique semble plutôt relever du greenwashing. L’industrie du parfum revient cependant de loin : « la communication est très longtemps passée par l’évocation. Or désormais les marques exigent la certification de toutes les matières naturelles : on est entré dans une démarche beaucoup plus radicale » nuance Dominique Roques. Mais les labels actuels ne prennent pas toujours en compte l’un des points essentiels de l’impact environnemental d’une matière première : sa transformation.
Les procédés d’extraction, parents pauvres du naturel ?
En effet, la vie d’une matière première ne s’arrête pas à son exploitation : « Processus d’extraction, faible rendement et quantité de déchets sont les principaux critères qui vont faire baisser la note Green Motion d’une matière première » rappelle Mathilde Voisin. L’empreinte carbone du transport des végétaux est limitée, car l’extraction doit en général être faite sur place, dans la mesure où les plantes perdent rapidement leurs composants olfactifs après cueillette – même si certaines matières premières, comme les résines, font exception. Ce sont donc majoritairement les concrètes ou essences obtenues qui voyagent, avec un poids radicalement inférieur à celui des plantes fraîches.
Parmi les quatre procédés d’extraction majoritairement employés, l’expression à froid, notamment utilisée pour les agrumes, est une méthode de pressage suivi d’une centrifugation permettant de séparer l’huile essentielle de l’eau. Elle présente ainsi le triple avantage d’être sans ajouts chimiques, peu énergivore, et d’utiliser les déchets de l’agro-alimentaire.
Le procédé considéré comme le plus polluant est celui de l’extraction au solvant volatil, c’est pourquoi les absolues, qui en sont issues, ne sont pas autorisées dans la certification Cosmos Bio. Il permet d’extraire le parfum de fleurs qui ne supportent pas les procédés chauffants. Or l’hexane, utilisé comme solvant, est un dérivé du pétrole, et reste polluant même s’il est réutilisé plusieurs fois dans le circuit d’extraction. Les sociétés font donc des recherches pour s’en passer. Une alternative a vu le jour avec l’extraction au CO² supercritique, c’est-à-dire compressé jusqu’à atteindre l’état de fluide. Il agit alors comme un solvant, entraînant les composés qu’il dissout, et redevient gazeux par dépressurisation. Mais le procédé nécessite une installation coûteuse qui ne peut être implantée partout. En combinant l’enfleurage à l’extraction au fluide supercritique, source de leurs E-Pure Jungle Essence, Mane a cherché à pallier ce problème. D’autres cherchent à se passer définitivement de solvant en développant de nouvelles méthodes, comme Firmenich et sa technologie Firgood. En exposant la plante à des fréquences électromagnétiques, on provoque le chauffage de l’eau contenue dans celle-ci, qui permet d’en extraire les principes odorants. La technique a été développée en laboratoire depuis 2015, et les trois premiers extraits obtenus en 2021 seront bientôt complétés d’autres[5]Voir De la plante à l’essence, 2021, Nez.
Les procédés d’hydrodistillation et de distillation à la vapeur d’eau permettent d’obtenir les huiles essentielles. Le processus est long, énergivore et gourmand en eau. Dès lors, si l’extraction au solvant est souvent considérée comme le mauvais élève, dans les faits, « il faut s’écarter du discours marketing simpliste. Faire des recherches pour des solvants biosourcés est évidemment une excellente idée, mais il faut comprendre que le processus de distillation, qui a une image plus verte, a proportionnellement un impact environnemental plus important, parce qu’il est le plus utilisé, et de loin » alerte Pierre-Philippe Garry. Améliorer ce procédé est ainsi l’un des impératifs de la filière lavandicole, mais également le souci des sociétés, comme LMR, filière d’IFF pour les naturels, qui a mis en place un procédé de distillation améliorée en modifiant les mécanismes des alambics pour l’une de ses matières phares, le patchouli[6]Le Patchouli en parfumerie, Nez+LMR Cahiers des naturels..
Les rendements dépendent de la plante, de sa concentration en molécules olfactives et de leur extractibilité. Par exemple : extrait au solvant volatil, le jasmin a un rendement de 0,125% (800 kg de fleur pour 1 kg de concrète), la tubéreuse de 0,06%. Lorsqu’il est distillé, le vétiver offre un rendement de 0,5% à 1%, le santal de 35%[7]Ces chiffres sont issus des ouvrages publiés par Nez (collection « Nez+LMR Cahiers des naturels », et de De la plante à l’essence – un tour du monde des matières à parfums, Nez.. Les concrètes, obtenues par extraction, doivent ensuite être lavées à l’éthanol afin d’obtenir une absolue propre à l’utilisation – et là encore le rendement est variable, passant par exemple de 26% pour la tubéreuse à 60% pour le jasmin. Et pour une même plante, selon le procédé d’extraction, le rendement – et le résultat olfactif – peut être radicalement différent : la rose damascena a un rendement six fois plus important par extraction qu’avec une distillation. Autant de variables à prendre en compte pour jauger l’impact environnemental d’un processus, qui constitue un enjeu décisif pour l’avenir de la parfumerie. Car lorsque l’obtention d’un produit implique l’emploi de processus polluants, le rejet systématique du synthétique en faveur du naturel ne tient pas : valoriser une matière première naturelle dans une composition, en passant sous silence son mode d’extraction, n’a ainsi pas vraiment de sens.
Les déchets végétaux enfin, désolvantisés le cas échéant, serviront « de biomasse, d’engrais agricole, ou encore de produit alimentaire, comme c’est le cas pour la vanille » synthétise Mathilde Voisin. Ils sont finalement assez peu problématiques, en comparaison avec d’autres industries, mais des recherches sont en cours pour les traiter de façon optimale. Ainsi, les drêches (résidus de plantes après extraction) de lavande et lavandin et les plants en fin de vie « serviront de paillage – la couverture des sols permettant de favoriser encore la biodiversité et de limiter le stress hydrique » explique Charlotte Bringer-Guerin. Les maisons de composition développent de plus en plus des produits upcyclés, comme chez Symrise, où la collection Garden Lab permet d‘enrichir la palette des parfumeurs : ainsi, les molécules odorantes sont récupérées des eaux de cuissons des légumes transformés en aliments pour bébé (asperge, artichaut, oignon, chou-fleur et poireau) grâce à un procédé hydro-alcoolique. Ils restent cependant anecdotiques dans les compositions, et l’impact des transformations, dans d’autres cas, ne plaide pas toujours en leur faveur : « on peut valoriser certains déchets, mais il faut garder à l’esprit que si l’on passe par un procédé de transformation, on crée parfois plus d’inconvénients que le déchet végétal n’en pose lui-même » conclut Mathilde Voisin.
Pour tenter de prendre en compte toutes les dimensions de l’impact à la fois environnemental et social des matières premières naturelles, parfois nettement supérieure à celui des synthétiques, les maisons de composition ont développé des outils de mesure qui seront abordés dans un prochain article de notre dossier. Mais la complexité de la question appelle à une prise de conscience générale qui ne peut passer que par un changement des pratiques de communication de l’industrie. La possibilité d’achats plus réfléchis de la part du consommateur reste en effet subordonnée à celle-ci.
—
Sommaire du dossier
- Une parfumerie durable est-elle possible ?, par Jeanne Doré
- Les matières premières naturelles : des plantes, des essences et des hommes, par Jessica Mignot
- Vers une synthèse plus vertueuse ?, par Anne-Sophie Hojlo
- Formuler responsable : différents outils pour un même idéal, par Sarah Bouasse
- Au cœur des labos : rationaliser sans rationner !, par Aurélie Dematons
- Quand les emballages s’habillent en vert, par Delphine de Swardt
- Tendres stocks : les cycles de vie du parfum, par Clément Paradis
Notes
| ↑1 | Les plus grosses productions d’huiles essentielles mondiales sont les agrumes et les menthes, suivis de l’eucalyptus, de la citronnelle, du clou de girofle, du lavandin et du cèdre. Source : Panorama 2020 des PPAM de FranceAgriMer |
|---|---|
| ↑2 | La culture des PPAM représente, en France en 2021, 67 513 ha et 6 527 producteurs. Les plantes à parfum sont les premières surfaces du secteur avec 37 897 ha en 2021 et 3 espèces prédominantes : le lavandin et la lavande (33 094 ha) ainsi que la sauge sclarée (3 400 ha) Source : PAC 2021. |
| ↑3 | Piloté par le Fonds de Dotation pour la Sauvegarde des Lavandes de Provence, qui permet de collecter des fonds pour aider les producteurs à faire face aux enjeux futurs. |
| ↑4 | En France, plus de 50 % de la production de lavande et plus 10 % de celle de lavandin sont bio – une part en augmentation depuis plusieurs années, et nettement supérieure aux 12% que représente le bio national, toutes cultures confondues. |
| ↑5 | Voir De la plante à l’essence, 2021, Nez |
| ↑6 | Le Patchouli en parfumerie, Nez+LMR Cahiers des naturels. |
| ↑7 | Ces chiffres sont issus des ouvrages publiés par Nez (collection « Nez+LMR Cahiers des naturels », et de De la plante à l’essence – un tour du monde des matières à parfums, Nez. |
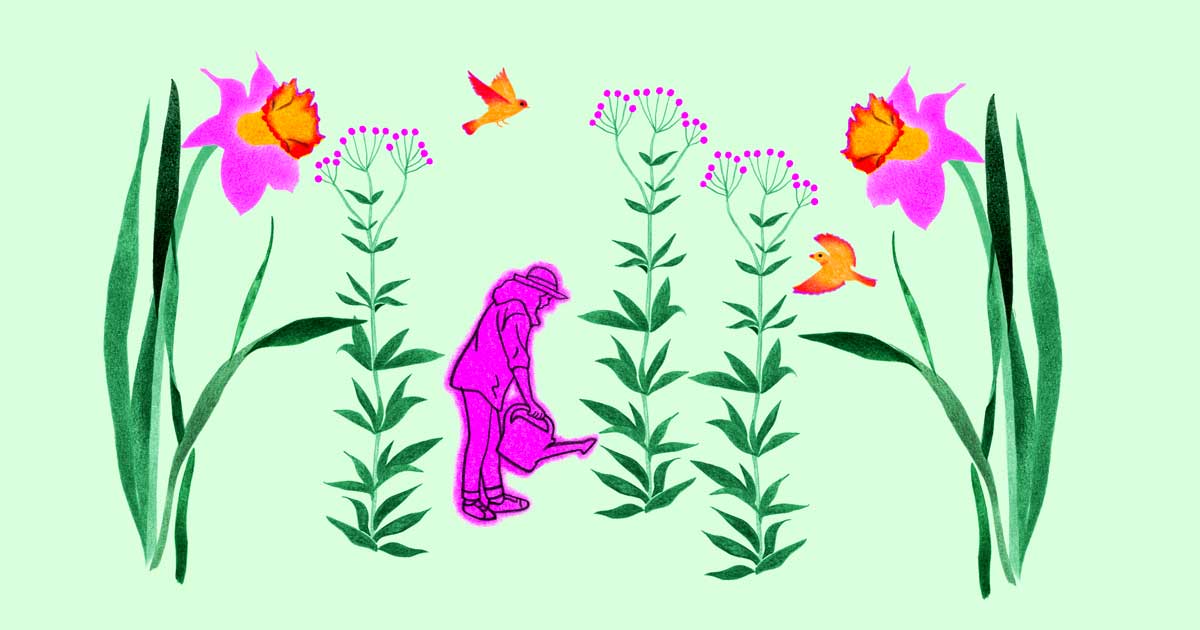



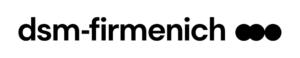

Et quand les fleurs ne sentiront plus rien ? En partage, je vous propose de découvrir ma série de dessins de fleurs en cours de réalisation : « Vanité », dont le rapport du GIEC est à l’origine : https://1011-art.blogspot.com/p/vanite.html
Fleurs fanées aurez-vous encore une âme dans 100 ans ?