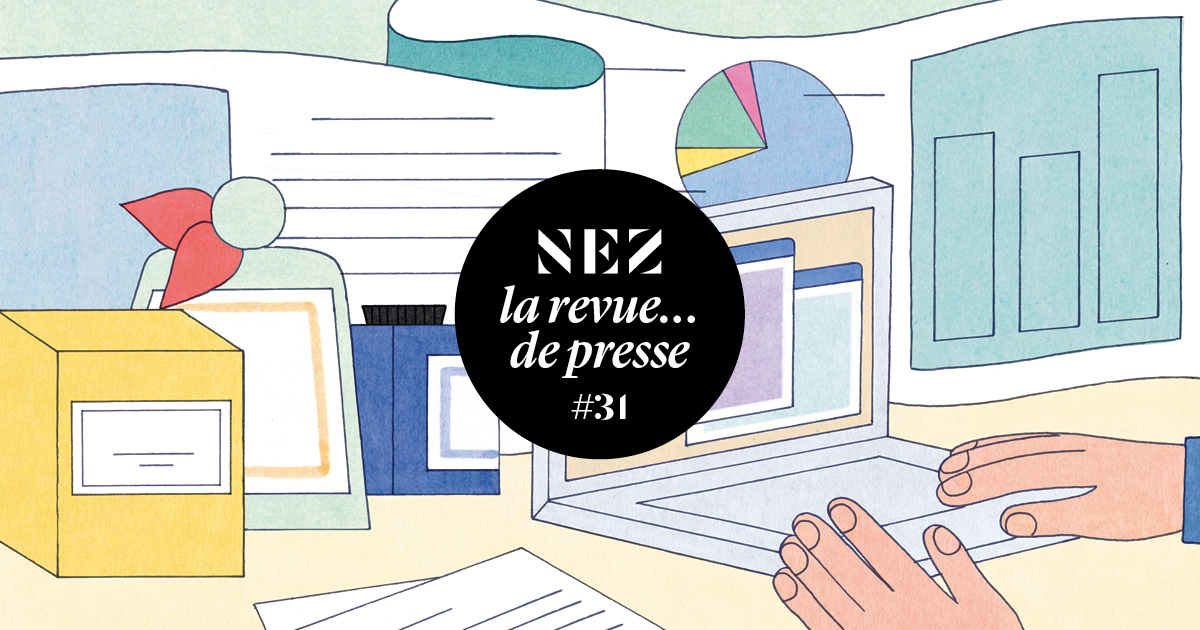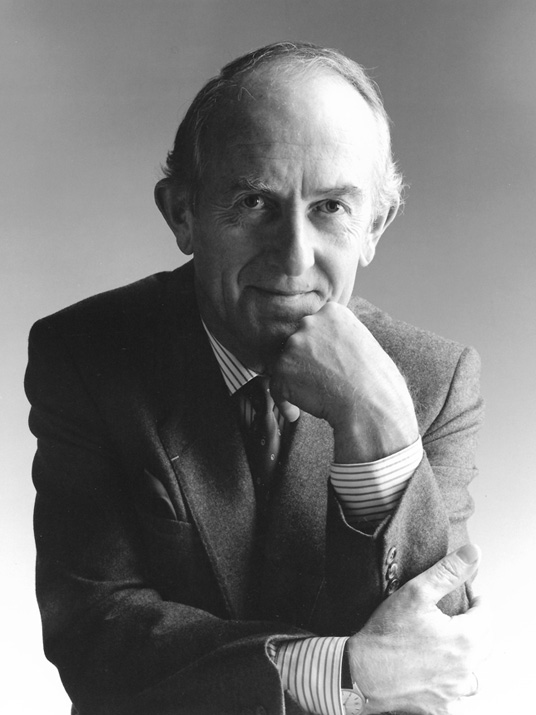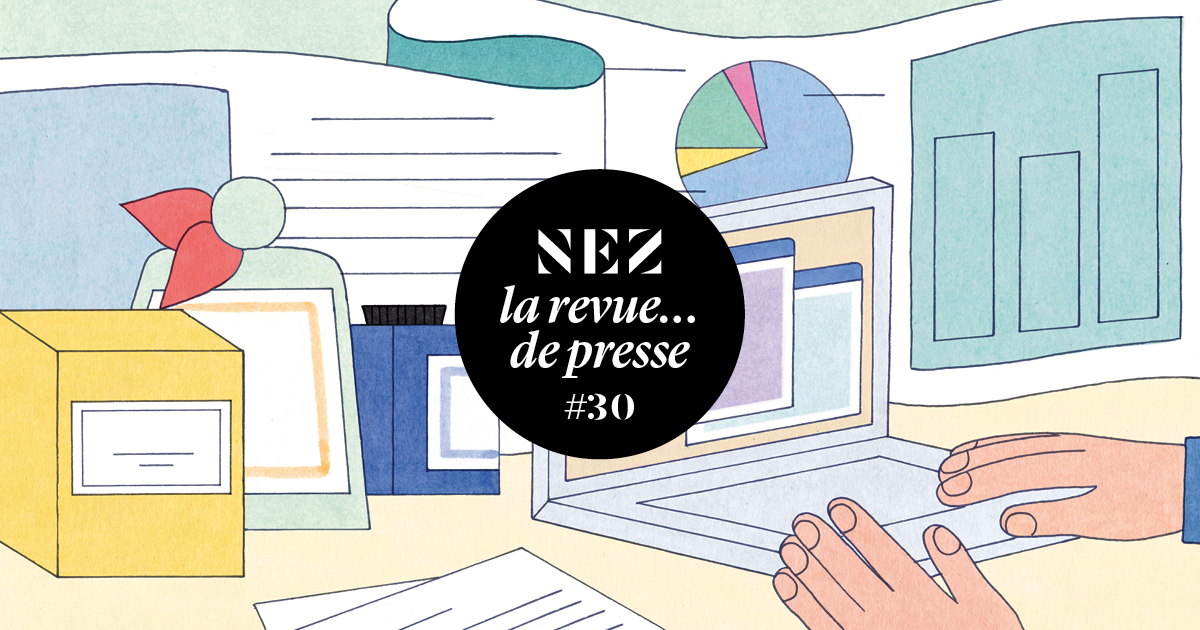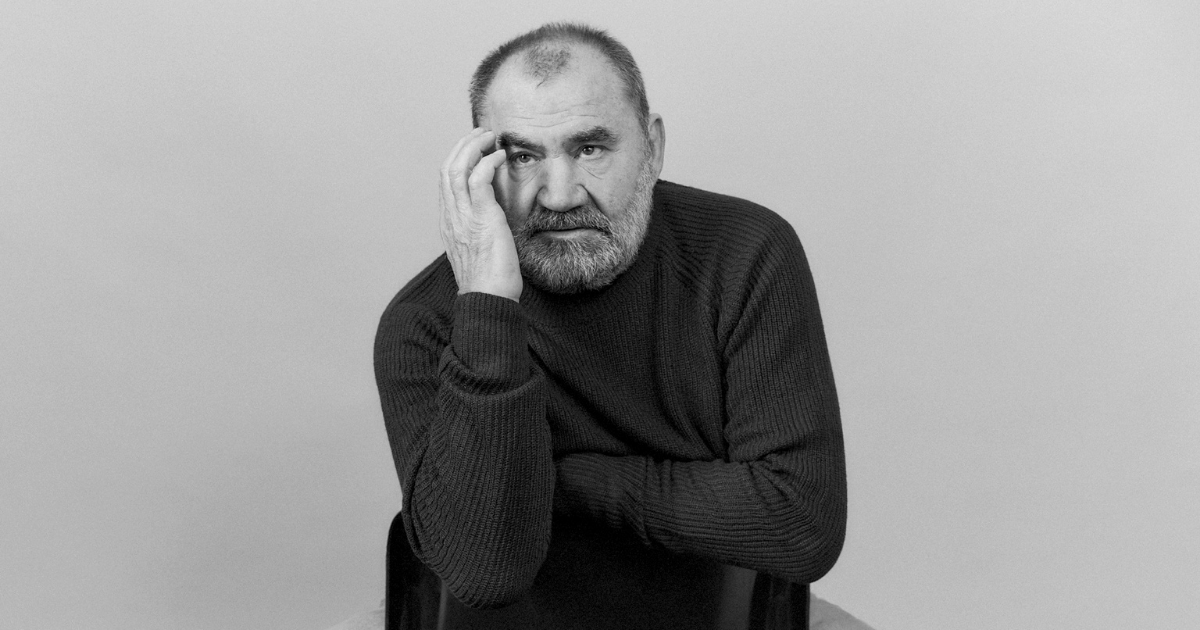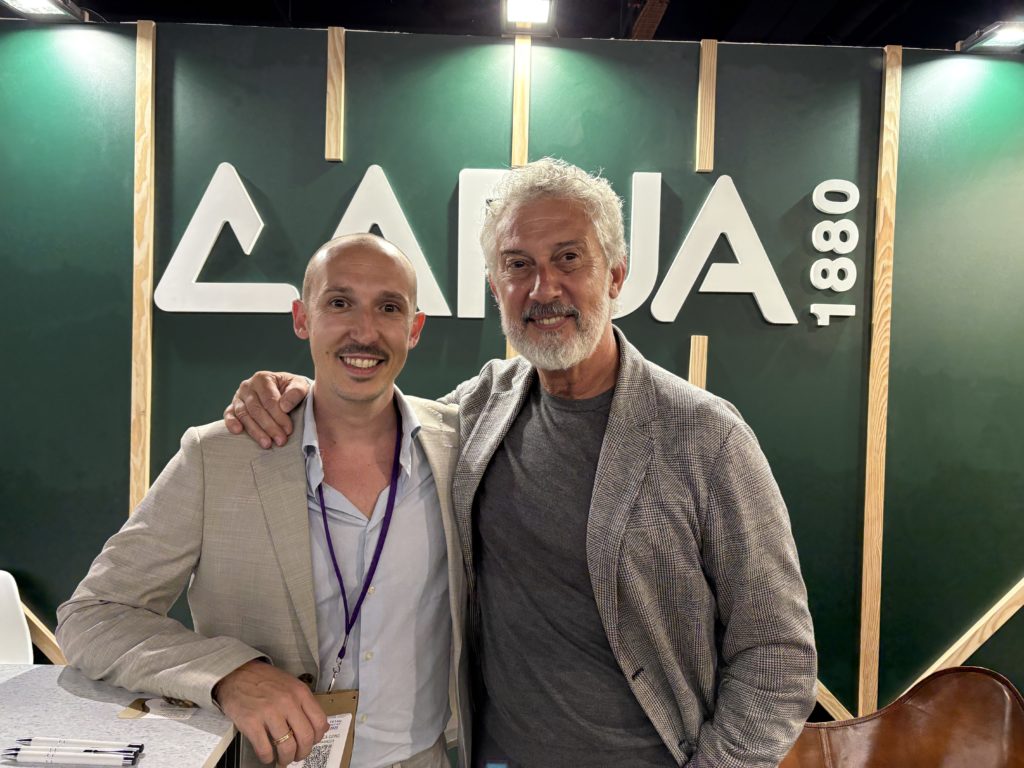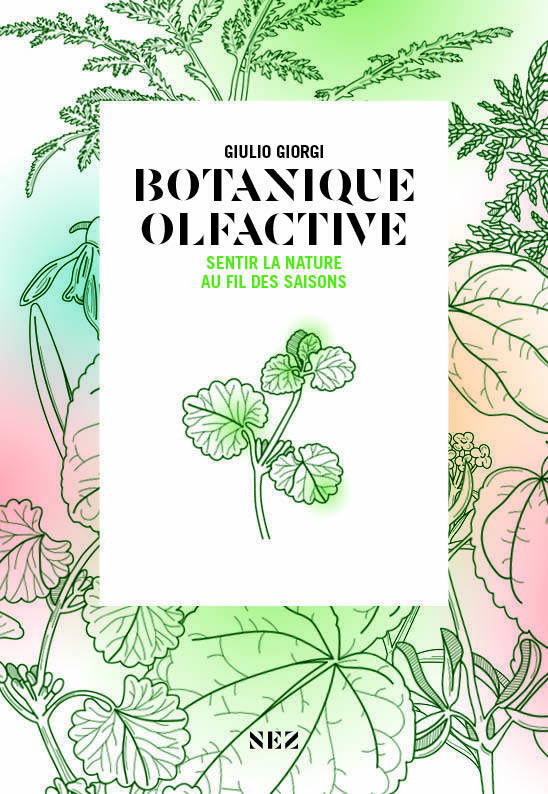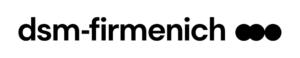Au menu de cette revue de presse, des nez électroniques pour lutter contre la drogue en prison, des réflexions sur l’intelligence artificielle en parfumerie, des œuvres olfactives inspirées par la diversité végétale du monde et des chercheurs curieux de mieux comprendre l’odorat des chats.
Outil d’enquête fortuit ou moyen de surveillance prémédité, l’olfactif est de plus en plus exploité par les forces de l’ordre, notamment dans le cadre de la prévention et de la répression de l’usage de stupéfiants. D’après le Hérault Tribune, il y a quelques semaines, des gendarmes de la brigade de Lagrasse, dans l’Aude, ont par exemple suivi une piste olfactive lors d’une patrouille à pied dans le village : probablement exacerbé par la chaleur estivale, le parfum caractéristique du cannabis les a ainsi mené jusqu’au balcon d’un particulier sur lequel s’épanouissaient neuf plants illicites. En Angleterre, une histoire quelque peu similaire a été rapportée par le Derbyshire Times : c’est encore une fois la forte odeur de cannabis émanant de la résidence d’un particulier qui mené la police du Derbyshire à intervenir. Comme quoi, il n’y a pas que les chiens policiers qui ont du flair !
Mais le futur de la lutte contre les stupéfiants pourrait ne pas se jouer seulement dans le nez humain, ni même animal. The Telegraph nous apprend en effet que les autorités du Royaume-Uni envisagent l’installation de nez électroniques dans les prisons, en particulier dans les cellules de personnes condamnées pour des infractions liées à la drogue. Le domicile d’individus en liberté conditionnelle pourrait également être équipé. Ces détecteurs, qui fonctionnent grâce à des cellules cérébrales synthétiques couplées à une intelligence artificielle, sont capables d’identifier des composés volatils caractéristiques de diverses drogues. Ils pourraient permettre de déterminer si un individu porte sur lui – ou a récemment consommé – un produit interdit. Un système similaire avait déjà été testé en 2014 par l’administration pénitentiaire israélienne pour lutter contre l’introduction clandestine de substances illicites dans les prisons grâce à des méthodes de fouille moins invasives.
Dans le champ de l’olfaction numérique, la start-up américaine Osmo vient d’ailleurs d’être nommée Pionnier Technologique 2025 lors du World Economic Forum. L’entreprise a notamment pour ambition de créer un appareil portatif capable de capter et d’analyser n’importe quelle odeur – en employant la technique de la chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC/MS) ainsi que l’intelligence artificielle – mais également de la reproduire et ainsi rendre possible la « téléportation d’odeurs ». Les applications pourraient être nombreuses, aussi bien dans le domaine de la parfumerie, déjà investi par l’entreprise, que dans celui du divertissement ou encore de la médecine : « Je veux introduire le parfum dans le monde du multimédia et dans celui de la santé » explique le CEO d’Osmo, Alex Wiltschko.
Dans un récent article pour le journal en ligne The Verge, la journaliste beauté Arabelle Sicardi explique justement « comment l’IA a infiltré le parfum », prenant notamment pour exemple la manière dont Osmo utilise l’intelligence artificielle pour proposer aux marques un service de formulation de parfums d’une rapidité inégalée. La journaliste rappelle cependant que cet usage n’est pas une nouveauté totale: « Les quatre conglomérats de parfums responsables de la majeure partie des senteurs du monde – DSM-Firmenich, Givaudan, IFF et Symrise – intègrent tous l’IA dans leurs processus de fabrication. » Plusieurs parfumeurs et parfumeuses témoignent dans l’article de leurs usages quotidiens de ces nouveaux outils pour « prendre en charge des aspects essentiels des processus de parfumerie » mais également des inquiétudes qu’ils suscitent. Quelles conséquences des projets comme celui Osmo peuvent-elles avoir sur la créativité en parfumerie ? Quid de leur impact en termes de surconsommation (notamment énergétique) et de surproduction dans une industrie dont l’empreinte environnementale est déjà loin d’être négligeable ?
De son côté, le monde de l’art continue également de miser sur l’olfactif. Le Monaco Tribune annonce ainsi l’exposition « Couleurs ! », organisée au Grimaldi Forum Monaco. Du 8 juillet au 31 août, y seront présentées une centaine d’œuvres du XXe siècle issues des collections du Centre Pompidou – dont le bâtiment est fermé pour cinq ans pour cause de rénovation. Sept espaces monochromatiques seront animés par des créations sonores du compositeur Roque Rivas et des compositions olfactives développées par le parfumeur Alexis Dadier, avec le concours de la maison Fragonard. L’ambition ? Donner à « vivre la couleur non seulement visuellement, mais aussi à travers d’autres sens ». Une excuse pour se replonger dans le grand dossier du 18e numéro de Nez !
Dans le sud toujours, le site Côte d’Azur France nous informe de la tenue de l’exposition de l’artiste Eve Pietruschi au Domaine du Rayol, « Un geste vers le bas », jusqu’au 21 septembre. Les dessins, gravures, broderies, parures végétales et propositions olfactives qui s’y déploient résultent d’un dialogue entre la pratique d’atelier de l’artiste et sa pratique de cueillette. Les formes, couleurs et senteurs du vivant végétal se manifestent ainsi dans l’espace d’exposition, réagencées avec délicatesse par l’artiste comme en écho au jardin du Domaine, ce Jardin des Méditerranées imaginé par le paysagiste Gilles Clément.
Ce sont également les plantes et leurs parfums qui inspirent l’artiste et designer français Alexis Foiny, lauréat de la troisième édition du prix Flair qui a annoncé la nouvelle sur sa page Instagram. Ce jeune diplômé de l’École Nationale des Arts décoratifs (EnsAD) de Paris avait déjà été distingué par le Prix Révélation Design de l’ADAGP pour son œuvre Tant que les fleurs existeront encore (2021) qui ravivait les effluves de l’Astria Rosea, plante endémique de l’île Maurice introuvable depuis 1860. L’artiste poursuivra donc dans cette voie avec son projet Résurgence, pensé pour devenir une sorte d’archive olfactive d’espèces botaniques en voie d’extinction : « La flore étudiée sera celle de l’archipel des Mascareignes dont plus de 41% de la biodiversité est menacée d’extinction, selon une étude menée par l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN). »
Aux États-Unis, la diversité odorante du monde végétal est aussi au cœur d’une exposition au Stephen and Peter Sachs Museum, situé au sein du Missouri Botanical Garden, à Saint Louis : « Smelling the Bouquet : Plants & Scents in the Garden ». En place jusqu’au 31 mars 2026, l’exposition « explore l’histoire botanique, culturelle et olfactive du spectre des odeurs créées par les plantes » rapporte Art Daily. L’occasion de plonger dans le monde de la botanique et de l’écologie chimique mais également de la parfumerie. Une vingtaine de stations olfactives permettent de découvrir plusieurs matières premières végétales et quelques fragrances inspirées par les plantes de serres et du jardin créées spécialement par les parfumeurs locaux Shawn Maher et Weston Adam. Les visiteurs peuvent également découvrir une réédition de l’œuvre majeure de l’artiste américaine Gayil Nalls, World Sensorium, « une sculpture olfactive incarnant le patrimoine aromatique de la planète. » L’exposition s’accompagne d’un guide en scratch and sniff pour découvrir autrement l’emblématique fresque botanique ornant le plafond du musée et d’une riche programmation de conférences, performances et projections.
L’artiste brésilienne Karola Braga s’est quant à elle vue décerner le prix Sadakichi pour l’art olfactif lors des Art and Olfaction Awards organisés à Los Angeles par l’Institute for Art and Olfaction. Présentée l’an dernier lors de Désert X AlUla en Arabie Saoudite, son installation Sfumato (2024) – un hommage à l’ancienne Route de l’encens – aurait, d’après le site d’informations en ligne Portal Tela, « impressionné le jury par sa force conceptuelle » ainsi que par sa manière de « transformer le parfum en langage et en monument. » L’artiste a en effet façonné à la main plus de 10 000 cônes d’encens principalement composés d’oliban et de myrrhe, deux des résines précieuses qui ont longtemps transité dans la région, afin de les brûler depuis un tertre de sable érigé comme un immense brûle-parfum à l’échelle du paysage. Le site PIPA Prize, qui promeut l’art brésilien à travers le monde, parle ainsi d’un « rituel sensoriel brouillant la géographie, la mémoire et le temps. »
Loin des expositions et des prix d’art contemporain, un groupe de chercheurs japonais se sont récemment intéressés à l’odorat des chats. Vous pensiez que votre compagnon à moustache vous reconnaissait à votre voix ou à votre allure ? Ce serait en réalité (au moins en partie) votre odeur qui lui permet de vous identifier. D’après Le Point, rapportant les résultats de l’étude publiée au mois de mai dans la revue scientifique PLOS One, les félins domestiques sont capables de différencier l’odeur corporelle de leur humain familier de celle d’inconnus. Les chats de l’étude ont en effet passé un temps significativement plus long à renifler les échantillons provenant de nouvelles personnes. L’étude a en outre mis en évidence que « les chats utilisent préférentiellement leur narine droite pour analyser les odeurs inconnues, puis basculent vers la gauche une fois l’information traitée. Ce changement suggère une spécialisation des hémisphères cérébraux : le droit pour les nouveautés, le gauche pour les informations déjà assimilées. » Ce comportement et cette bascule, également constatés dans les relations intra-espèces (les chats reniflent les fèces des félins inconnus plus longtemps que celles des congénères appartenant à leur groupe social), « pourrait indiquer que nous faisons également partie de ce groupe social » note l’article.
Interprétant également les résultats de cette étude, Futura Sciences suggère que si « votre chat semble parfois vous ignorer délibérément » cela pourrait être une marque de confiance. Ceci va de pair avec le fait que les odorants familiers peuvent s’avérer particulièrement réconfortants pour les chats, réduisant le stress et l’anxiété et créant un sentiment de sécurité dans leur environnement. Un constat mis en avant par le HuffPost, qui recommande aux propriétaires de félins de laisser quelques vêtements préalablement portés à disposition des animaux de compagnie lors d’un départ en vacances. D’après les vétérinaires et comportementalistes cités dans l’article, « l’odeur familière peut être apaisante et aider votre animal à se sentir en sécurité. » Une façon de maintenir le lien, par effluves interposés.
Visuel principal : © Morgane Fadanelli