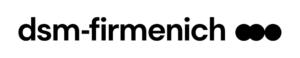Au menu de cette revue de presse, un prix Nobel remis en question par de nouvelles découvertes, les mystères de l’hyperosmie, des séductions florales plus ou moins macabres, des expériences culinaires qui font la part belle au nez, un timbre à tremper dans le café et une ribambelle d’expositions.
Ce mois-ci, la revue Science revient sur une étude qui pourrait bien remettre – partiellement – en question les découvertes publiées en 1991 par Linda B. Buck et Richard Axel, qui leur valurent de recevoir le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2004. Une équipe de recherche de l’entreprise Givaudan a en effet trouvé une nouvelle méthode pour étudier les protéines réceptrices du système olfactif humain – couramment appelées OR pour Olfactory Receptors – en modifiant des cellules de sorte qu’elles expriment des récepteurs olfactifs. Cela devrait permettre d’étudier ces derniers plus facilement, sans avoir à sacrifier des rongeurs à chaque expérience… En outre, l’équipe dirigée par Andreas Natsch affirme « avoir observé des schémas d’activité des récepteurs qui remettent en question le codage combinatoire », hypothèse qui suppose que plusieurs OR sont activés en même temps pour identifier les diverses parties d’une molécule odorante. Or, selon l’étude publiée dans Current Biology, certains odorants activeraient préférentiellement un seul OR, ce qui signifie qu’un seul pourrait suffire pour percevoir un odorant donné. Cela ne signifie pas que plusieurs récepteurs ne puissent pas être impliqués dans la perception odorante d’une molécule mais plutôt, précise Natsch, « qu’un seul OR peut être responsable d’une »direction olfactive spécifique » »
De son côté, The Scientist s’interroge : pourquoi certaines personnes possèdent-elles un odorat hors norme ? Si le phénomène de l’anosmie a été largement commenté et étudié depuis la première vague du Covid-19 en 2020, l’hyperosmie est, en revanche, beaucoup moins discutée. Pourtant, certains individus semblent capables de percevoir avec intensité des odorants présents dans l’air à de faibles concentrations, imperceptibles pour la majorité dite « normosmique ». Grâce aux techniques d’imagerie cérébrale, nous savons que les hyperosmiques présentent un volume de matière grise plus important que la normale dans les régions du cerveau traitant l’information olfactive. Les causes de cette hypersensibilité, qui peut s’avérer presque aussi handicapante que les autres dysfonctionnements du sens olfactif, restent néanmoins obscures. Le professeur Steven Munger, spécialiste en otorhinolaryngologie, avance une hypothèse : « il se peut que le cerveau ait changé [en raison] d’hormones, d’une maladie auto-immune ou de divers autres facteurs, qui peuvent rendre plus sensible à certaines odeurs ». L’étude des variations génétiques est également une piste suivie par les chercheurs et chercheuses, tout comme l’étude de la variabilité de la perception olfactive au cours d’une journée et au fil des saisons, qui pourrait apporter un éclairage sur ces fluctuations de sensibilité.
Les botanistes font, eux aussi, d’étranges découvertes en matière d’odeurs. The Conversation nous explique ainsi pourquoi le gigantesque spadice de l’arum titan (Amorphophallus titanum), une rare espèce de plante à fleurs endémique des forêts tropicales humides de Sumatra, dégage un parfum si nauséabond. Cette protubérance, souvent confondue avec un pistil, est en réalité l’inflorescence de la plante et ne fleurit qu’une fois tous les sept à dix ans, pendant deux nuits seulement. La pollinisation doit donc être assurée rapidement et efficacement pour permettre à la plante de se reproduire. C’est pourquoi celle-ci synthétise un puissant cocktail d’odorants évoquant « la chair en décomposition ou du poisson pourri », cocktail certes repoussant pour les humains mais irrésistible pour les mouches et coléoptères nécrophages qui le détectent à de très grandes distances. Trompés par cette odeur exacerbée par la thermogenèse de la plante, les insectes se précipitent sur le spadice, espérant y trouver non du pollen, mais une carcasse à grignoter. D’après les chercheuses à l’origine de l’article, seules les fleurs femelles s’ouvrent la première nuit, émettant une grande quantité de composés organosulfurés – en particulier du méthanethiol, mais aussi du sulfure de diméthyle (odeur d’ail), du trisulfure de diméthyle (oignon pourri), ainsi que plusieurs dizaines d’autres molécules comme le phénol ou le benzaldéhyde. Les fleurs mâles, qui ne s’ouvrent que la nuit suivante, diffusent quant à elles « un ensemble de composés aromatiques plus sucrés et beaucoup moins soufrés que les fleurs femelles. » L’hypothèse des chercheuses est donc la suivante : si les fleurs mâles ne déploient pas autant d’efforts pour attirer les insectes, c’est peut-être parce que ceux-ci sont déjà présents, séquestrés depuis la veille par les fleurs femelles qui ne les relâchent qu’au moment où le pollen des fleurs mâles devient accessible ! Une stratégie étonnante, dite du « piégeage floral », déjà constatée chez d’autres espèces d’arum.
Le Point met en avant un autre exemple des merveilleuses facultés développées par les plantes angiospermes au cours de millions d’années de coévolution avec les insectes. La Vincetoxicum nakaianum, récemment étudiée par un chercheur de l’université de Tokyo, s’avère capable de reproduire le parfum émis par des fourmis blessées. Si le mimétisme olfactif de certaines fleurs est déjà bien connu – notamment chez certaines orchidées du genre Ophrys, qui attirent ainsi mouches, abeilles ou guêpes en imitant leurs phéromones sexuelles – il s’agit du premier cas documenté d’une fleur empruntant des odorants propres au genre Formica. Le but de ce mimétisme : attirer les mouches chloropides « qui se nourrissent du fluide corporel d’insectes déjà blessés ou tués par des prédateurs. L’odeur des fourmis en détresse agit donc comme un puissant signal olfactif indiquant aux mouches la présence d’une proie facile et accessible. » Là encore, les insectes se laissent berner et deviennent, bien malgré eux, des agents de pollinisation. Parmi les composés volatiles émis par la fleur et identifiés par Ko Mochizuki, l’acétate de décyle et le méthyl-6-méthyl salicylate se révèlent particulièrement attirants pour les mouches, car il s’agit aussi de phéromones émises par les fourmis Formica japonica.
Alors que nous commençons à peine à les comprendre, ces étonnants phénomènes olfactifs qui tissent le monde vivant pourraient bientôt se déliter en raison des bouleversements anthropogéniques de la biosphère. De nombreux odorants risquent ainsi de disparaître avant même que nous ayons véritablement posé le nez dessus. Cette perspective d’un effondrement – environnemental mais aussi économique et sociétal – semble paradoxalement inspirer l’industrie de la parfumerie, comme l’explique Dazed Digital. Sans même parler des marques qui se penchent sur les effluves de plantes disparues ou en voie d’extinction (déjà évoquées par Dazed en 2022), il semble qu’une tendance « apocalyptique » soit en train de s’installer dans la niche, avec des parfums évoquant diverses catastrophes — réelles ou imaginaires. « Si certains cherchent à microdoser le désastre, qu’est-ce que cela révèle de notre humeur collective ? » s’interroge Felicity J. Martin qui évoque notamment le parfum expérimental bit bit de l’artiste d’origine chilienne agustine zegers, inspiré par le confinement, ou encore T-Rex de la marque Zoologist, qui comprend « des notes de bois carbonisé et d’oxyde de rose métallique pour évoquer la soif de sang et le météore annonçant la fin du règne mortel des dinosaures. » Elle revient également sur La Fin du Monde d’État libre d’Orange, Inexcusable Evil de Toskovat ou encore Eleventh Hour de Byredo, « le dernier parfum sur Terre », pour interroger ce qu’elle décrit comme la quête d’un « enfermement dans la terreur ». Si cette tendance eschatologique a de quoi intriguer, la journaliste insiste sur le fait que « l’art a toujours reflété les thèmes de la ruine, de la fin et de l’effondrement lors de moments perçus de déclin ou de transitions sociétales. » Le parfum, un art comme un autre ? On pourrait argumenter que ce n’est pas tout à fait le cas… Pour une industrie si étroitement liée aux logiques de marché, dont les activités s’inscrivent au sein d’enjeux politiques globalisés et contribuent aussi, inévitablement, à une certaine dégradation environnementale, marchandiser l’effondrement, le rendre en quelque sorte désirable – sous forme de fictions spéculatives en flacons – pourrait presque paraître cynique. Car ces récits olfactifs de fin du monde ne recyclent-ils pas l’angoisse (notamment écologique) en argument marketing, nous faisant oublier au passage les enjeux qui se cachent derrière une industrie notamment affligée, comme le souligne Jean-Claude Ellena dans une interview pour Le Figaro, par le phénomène de surconsommation ? Ces parfums, vendus au prix fort, ne peuvent donc pas être considérés tout à fait comme ceux créés, par exemple, par l’artiste Lindsay Tunkl qui proposait, il y a une dizaine d’années, de humer quatre Parfums de l’Apocalypse (explosion nucléaire, tsunami, sécheresse et collision d’astéroïde) dans le cadre d’une performance.
Si ce sujet vous laisse la boule au ventre, comptez sur Reporter Gourmet pour vous redonner l’appétit ! À Toronto, la cheffe du restaurant étoilé Aburi Hana a choisi de redonner à l’odorat toute sa place dans l’expérience culinaire, au point d’interdire à ses clients et clientes le port de parfum, déodorant ou produit cosmétique trop odorant. Ryusuke Nakagawa propose en effet une expérience culinaire dans la tradition du kaiseki, une forme de repas de la gastronomie japonaise composé d’une douzaine de petits plats, où chaque détail compte : harmonie des goûts, des arômes, des textures, des formes et des couleurs — mais aussi, chez Aburi Hana, beauté de la vaisselle en porcelaine d’Arita dont chaque pièce est choisie en personne par la cheffe. Dans cette narration gastronomique soigneusement orchestrée, rien n’est laissé au hasard, pas même l’ambiance sonore ou olfactive de la salle. Ainsi, en plus de la règle qui impose de ne pas se parfumer, les téléphones portables doivent être éteints, afin de favoriser une concentration de tous les sens sur les mets, et notamment sur les arômes des ingrédients. « La fraîcheur du shiso » ou « le citronné du yuzu » sont en effet des « notes délicates », explique Nakagawa, que des parfums extérieurs risqueraient de masquer, « compromettant ainsi l’intégrité du kaiseki pour tous les convives ».
En France, un autre projet culinaire hors du commun est mis en lumière par France Bleu, celui de l’association Le Regard au bout des doigts, près de Reims, qui, deux fois par an, propose un dîner entièrement à l’aveugle. Les yeux bandés, les convives guidés par des bénévoles découvrent leur environnement et leur repas par l’ouïe, le toucher, la proprioception, l’odorat et le goût, sans pouvoir s’appuyer sur ce sens dit « dominant » qu’est la vue. « C’est une façon de sensibiliser au handicap visuel » explique Aurore Sohier, présidente de l’association, mais aussi un exercice d’attention non-visuelle et une expérience culinaire singulière pour les personnes voyantes. Celles-ci (re)découvrent notamment l’importance de l’odorat afin de déterminer, avant même de goûter, ce qui se trouve dans leur assiette, mais également lors de la mise en bouche, grâce à la rétro-olfaction et la perception des arômes. « On essaye d’avoir une autre approche de son assiette, de prendre plus le temps de sentir, de goûter, de laisser en bouche pour faire travailler ses papilles ». Or cette approche révèle parfois des surprises, montrant combien notre sens olfactif tend à manquer d’éducation : lors du dîner du mois d’octobre, certains convives ont en effet confondu saumon et poulet, ou encore champagne et cidre !
Cet automne, le nez des gourmets est aussi flatté par La Poste française, puisque, comme le rapporte Le Figaro, un timbre parfumé au croissant au beurre vient d’être édité pour célébrer « la viennoiserie préférée des Français ». Grâce à de minuscules microcapsules olfactives, l’effluve de pâte beurrée et dorée s’échappe au moindre frottement (évitez tout de même de lécher la face imprimée !). Édité à 594 000 exemplaires, ce timbre d’une valeur de 2,10€ peut être utilisé pour les envois internationaux et semble avoir déjà été adopté par les philatélistes : dans l’une des agences où le nouveau timbre est disponible, cinquante collectionneurs se sont présentés dès la première journée de vente ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’art boulanger inspire La Poste : au printemps 2024, à l’occasion des Jeux Olympiques, un timbre à l’odeur de baguette sortant du four avait déjà été mis en circulation.
Enfin, il semble désormais impossible de faire une revue de presse olfactive sans évoquer les initiatives culturelles qui, à travers le monde, donnent une place – centrale ou périphérique – à l’odorat. Les 10, 11 et 12 octobre dernier, Riga, la capitale lettone, a par exemple accueilli la première édition de l’International Scent Art Festival, réunissant une quarantaine d’artistes venus de neuf pays (Lettonie, Argentine, Norvège, Chine, Nouvelle-Zélande, Finlande, Portugal, Allemagne et Grèce). Initié par Sandris Murins, fondateur de l’entreprise Scent Camera qui ambitionne la création d’un enregistreur à odeurs portatif, le festival se présentait comme l’un des premiers du genre à « explorer l’intégration des odeurs dans des formes d’art, telles que les arts visuels, la musique, la littérature, la danse et la performance. » Parmi les événements marquants du week-end, les artistes argentins Maria Zegna, Bruno Mesz et Sebastian Tedesco ont notamment présenté Osmo, un orgue à senteurs qui peut être utilisé dans divers contextes, en l’occurrence « une performance gastronomique, une pièce de musique contemporaine, une combinaison vidéo-odorat, et une séance d’improvisation musicale », précisait le communiqué de presse.
Un autre événement européen a également attiré l’attention de Nez : à Düsseldorf, l’exposition The Secret Power of Scents (20 octobre 2025 – 8 mars 2026) insère l’histoire des parfums au sein du parcours chronologique du Kunstpalast qui revient sur 1000 ans d’histoire occidentale. D’après l’édition allemande de Harper’s Bazaar, une trentaine de « stations olfactives » d’aspect et fonctionnement variés sont installées tout au long du parcours, permettant aux visiteurs et visiteuses de « découvrir des anecdotes fascinantes sur la fabrication des parfums modernes et anciens » mais également sur leurs divers usages culturels au fil des millénaires, des parfums-médicaments du Moyen-Âge au marketing olfactif contemporain, dont le commissaire de l’exposition, Robert Müller-Grünow, fondateur de l’entreprise Scentcommunication, est un spécialiste.
Aux États-Unis, les initiatives olfactives continuent également de se multiplier. À New York, l’exposition multisensorielle ALL ACCESS PASS de l’artiste Tom Fruin a notamment interpellé le magazine Time Out. L’artiste californien, connu pour ses sculptures en vitraux colorés, s’est en effet associé – pour la troisième fois – au studio de création olfactive Joya, créé par Frederick Bouchardy. Le point focal de ce nouveau projet était un château d’eau en plexiglas multicolore installé sur le toit du bâtiment abritant le studio à Brooklyn et qui diffusait, la nuit venue, une douce lumière ainsi qu’un parfum intitulé Latenight. Si les motifs de la sculpture s’inspiraient de divers objets et déchets ramassés dans les rues de la ville, la fragrance, composée de notes musquées et florales, d’agrumes, d’eucalyptus, de cumin, de gingembre et de poivre, était décrite comme « une seconde peau : une douceur sucrée et douce, de l’air chaud et de la sueur épicée ». L’exposition se poursuivait à l’intérieur du bâtiment où de petites sculptures en formes de maisons vitrées diffusaient également le parfum, que les visiteurs et visiteuses pouvaient aussi se procurer sous forme de flacons à bille ou de désodorisant pour la voiture.
Le même studio Joya odorise également cet automne l’importante exposition consacrée aux œuvres de Claude Monet au Brooklyn Museum : Monet and Venice (11 octobre 2025 – 1er février 2026), organisée par les commissaires Lisa Small et Melissa Buron. CBS News et Artnet reviennent sur cette proposition curatoriale immersive qui associe les toiles vénitiennes du maître de l’impressionnisme à plusieurs créations contemporaines : des images vidéos filmées dans la Venise d’aujourd’hui, une symphonie originale du compositeur Niles Luther, ainsi que trois parfums, Aqua Alta, L’Enveloppe et Nymphaea, diffusés dans les salles d’exposition. La proposition ne fait d’ailleurs pas l’unanimité et ARTnews qualifie d’ « embarrassant » cette tentative d’immersion et de « kitsch » le premier parfum de l’exposition, supposé rappeler l’odeur des canaux… En 2024, une précédente collaboration entre le musée et le studio Joya avait mené à l’organisation de visites parfumées et à la création d’une collection de bougies parfumées inspirées par les Cent vues d’Edo, du peintre japonais Hiroshige.
Enfin, à Los Angeles, alors que s’est achevée fin octobre l’exposition Ether: Aromatic Mythologies organisée par Saskia Wilson-Brown au Craft Contemporary, l’Institute for Art and Olfaction a présenté les senteurs créées par douze parfumeurs et parfumeuses de la région lors de leur résidence estivale au Craft Contemporary. Celle-ci a été l’occasion pour ces créateurs et créatrices de s’interroger sur les interactions entre parfum et formes visuelles puis d’imaginer comment contextualiser leurs compositions olfactives « à l’aide d’une image ou d’un petit objet ». C’est donc le résultat de ce travail qui a été présenté dans l’exposition Storycraft: Twelve Olfactory Narratives : chaque parfum était donné à humer dans un bocal en verre contenant des perles parfumées, au-dessus duquel se trouvait exposé l’œuvre, l’objet ou l’image associé. Pour LAist, James Chow a interrogé deux des participantes, Debbie Lin et Na-Moya Lawrence, afin de mieux comprendre pourquoi et comment ces dernières ont cherché à « mettre une mémoire en bouteille » par la transcription olfactive d’un souvenir d’enfance lié au deuil.
Le Louvre Abu Dhabi propose quant à lui une nouvelle visite accompagnée par un livret odorant intitulé Art in Scents. Empreintes olfactives, créé en partenariat avec Magique Studio et les parfumeurs de Givaudan Dalia Izem et Gaël Montero. Neuf parfums, micro-encapsulés dans les pages, sont associés à diverses œuvres de la collection permanente, signale The National News : la figure en bas-relief d’une reine ou déesse égyptienne du IIIe siècle av. J.-C., la représentation d’un ange thuriféraire du XVIe siècle par le peintre allemand Bernhard Strigel, une nature morte du XVIIe peinte par Jérémie Plume, une série de céramiques d’Iznik du XVIe siècle, trois œuvres – préraphaélite, impressionniste et post-impressionniste – du XIXe siècle et deux œuvres contemporaines de Kazuo Shiraga et Maha Malluh. Une dixième senteur, nommée A Universal Breeze et diffusée dans le hall d’entrée, constitue la nouvelle signature olfactive du musée, conçue comme un hommage à l’architecture et à l’environnement naturel de celui-ci. Pour Kathleen Vermeiren, guide-conférencière au Louvre Abu Dhabi, ce projet devrait permettre « de connecter différentes cultures grâce au langage universel des odeurs ».
Des laboratoires de recherche aux salles d’exposition, en passant par les cuisines et les serres botaniques, l’olfaction se révèle, plus que jamais, un champ de recherche, de création et de réflexion foisonnant.
Visuel principal : © Morgane Fadanelli


















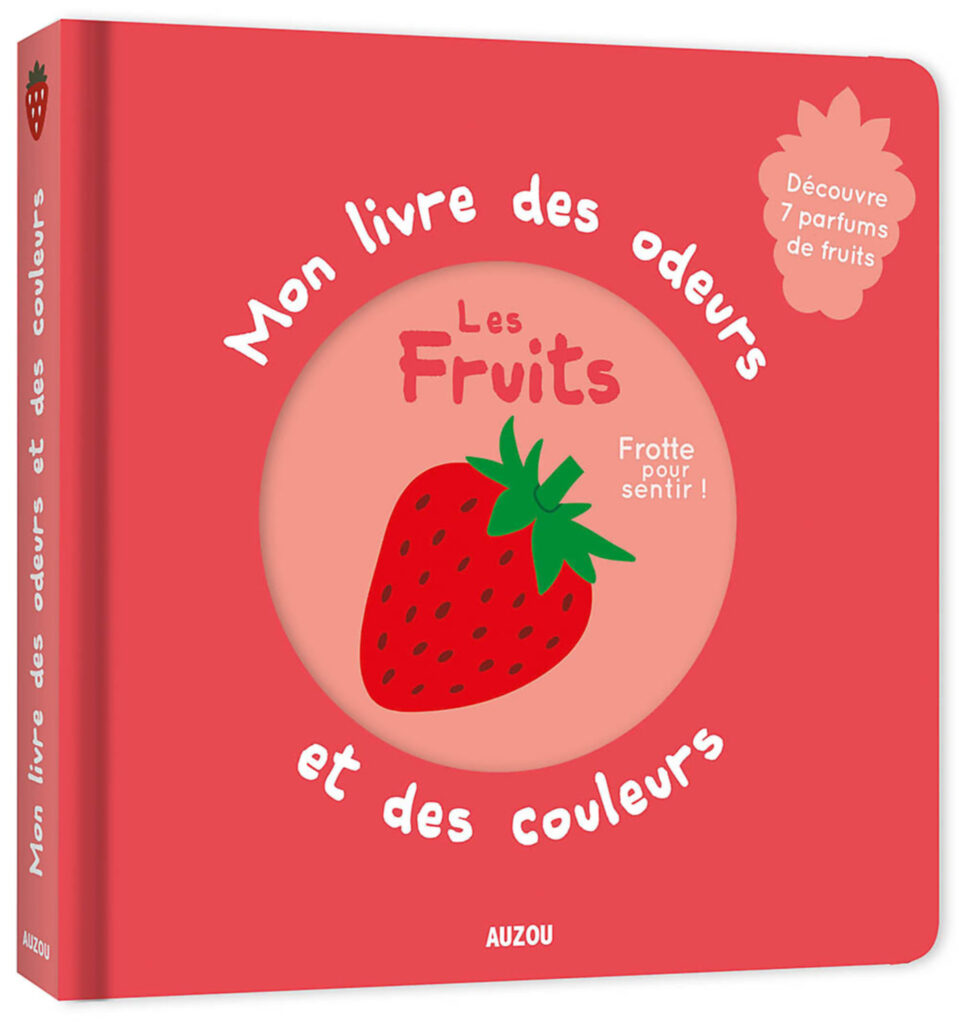
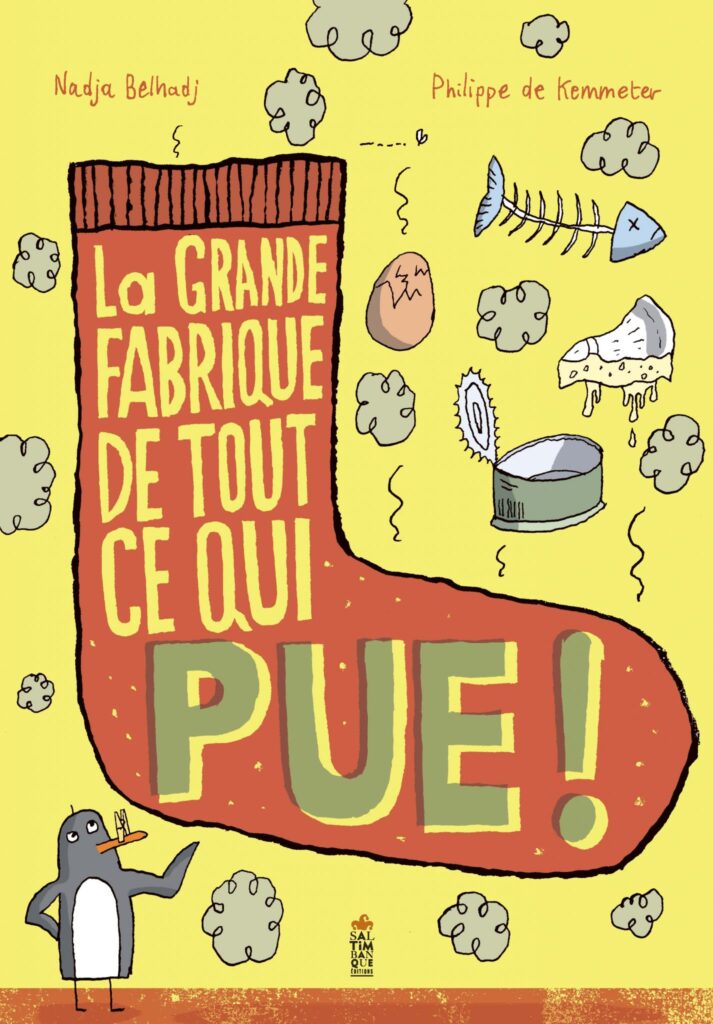
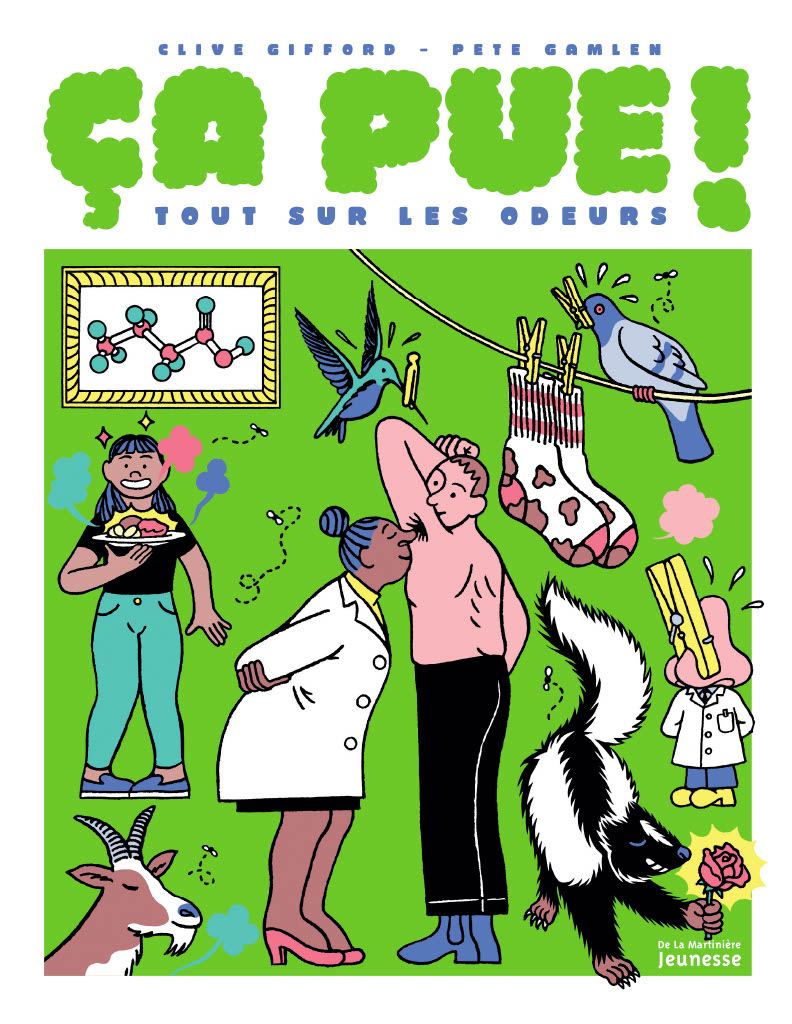
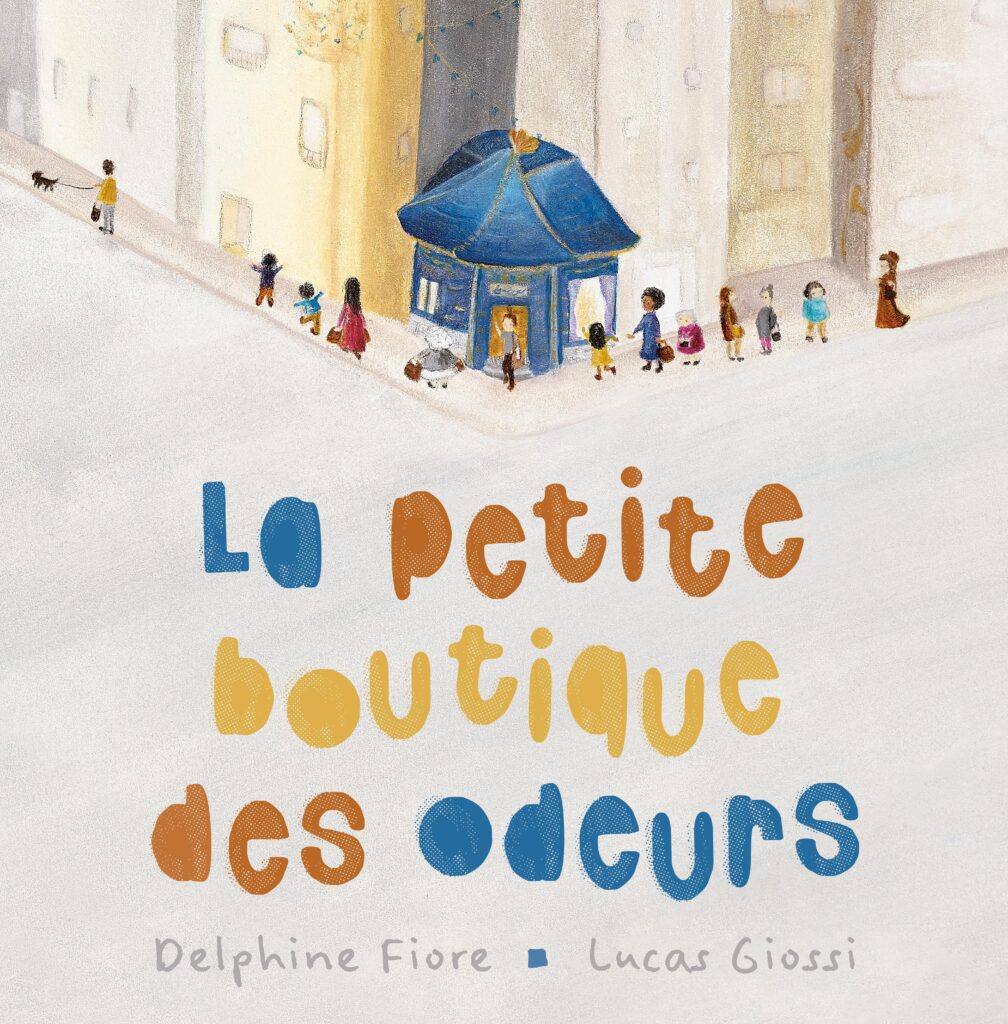
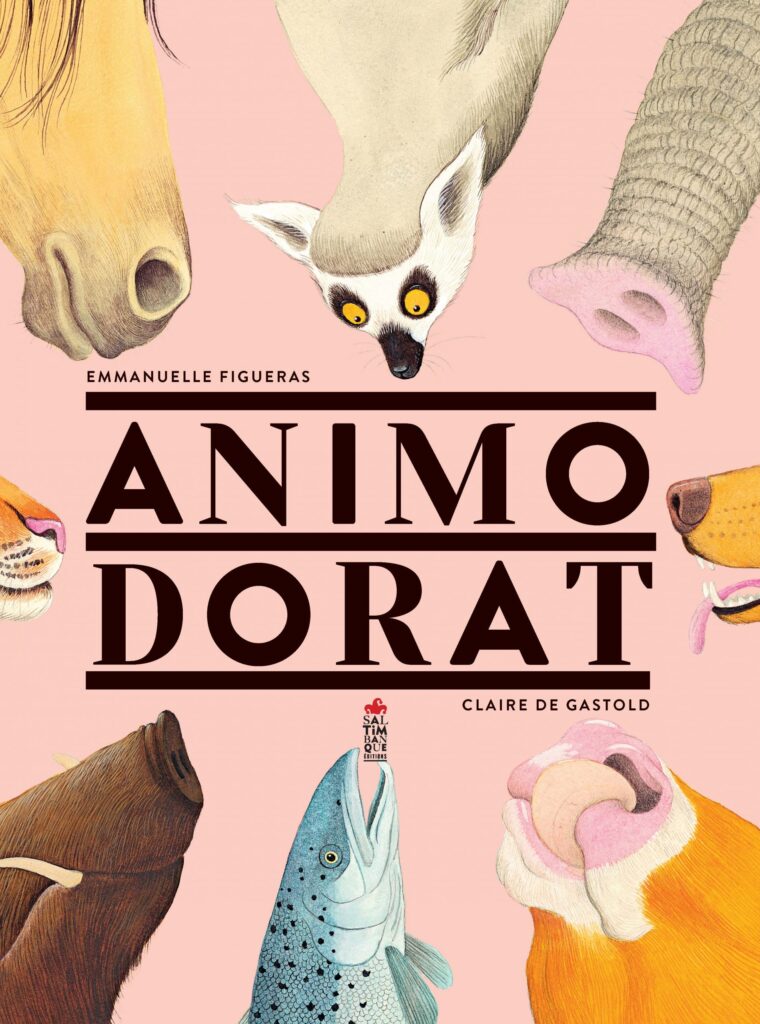
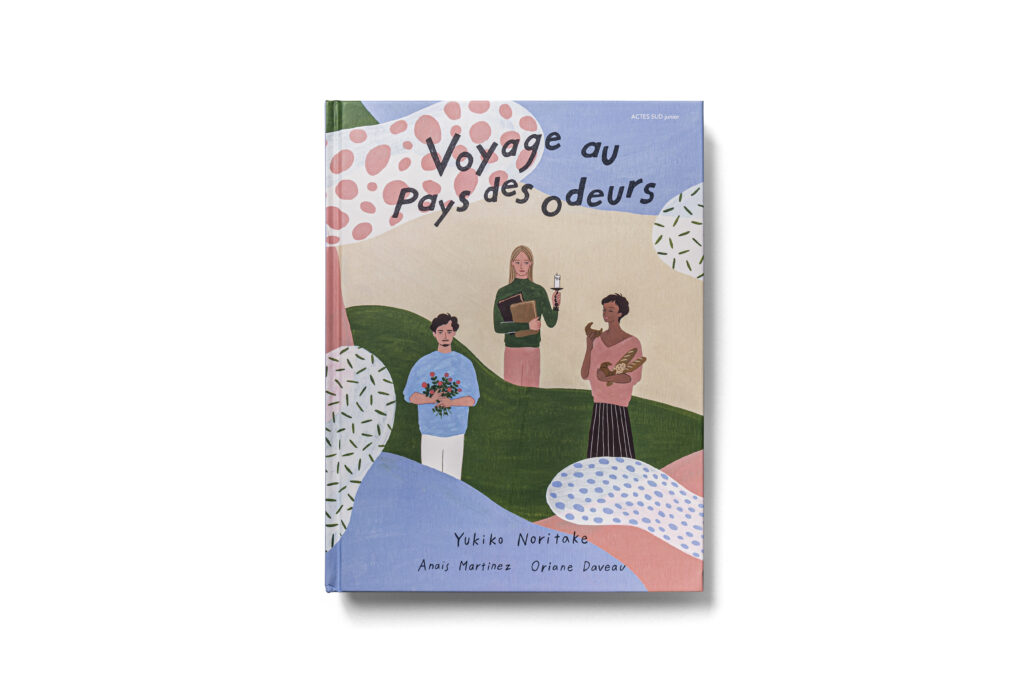
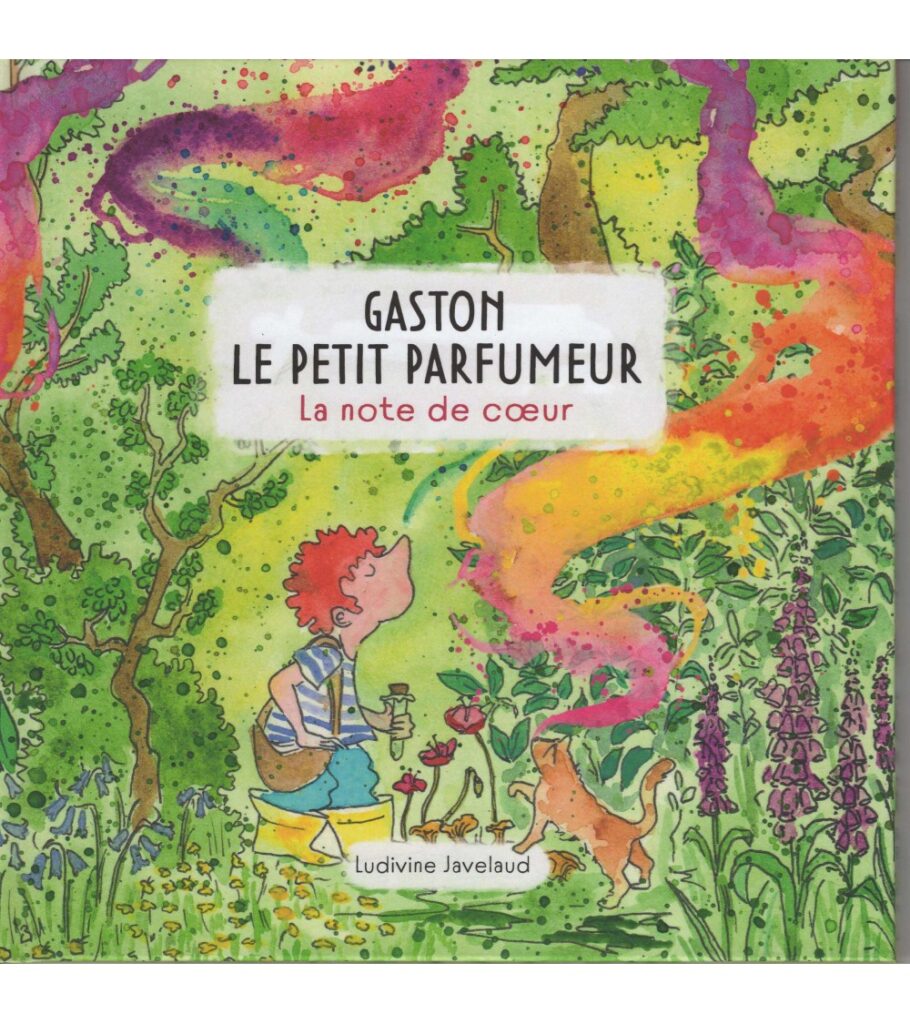
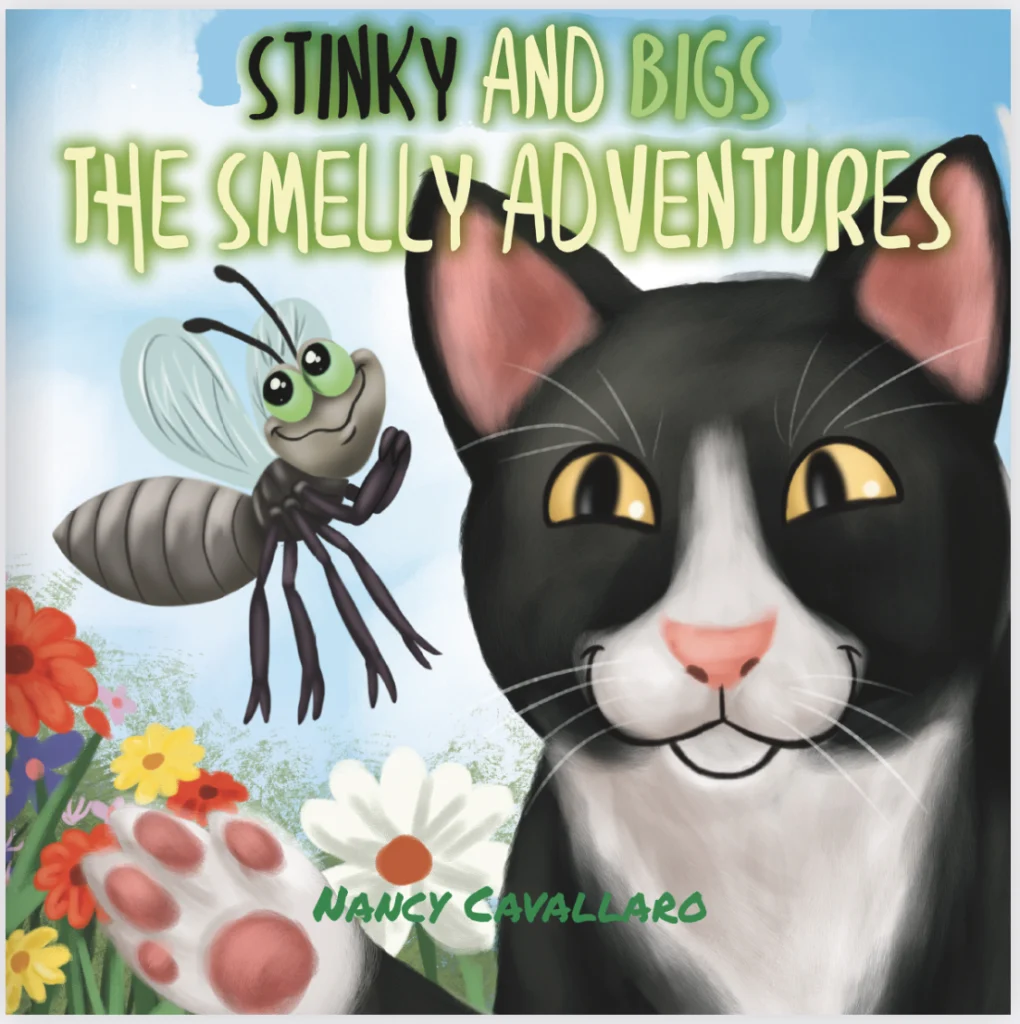
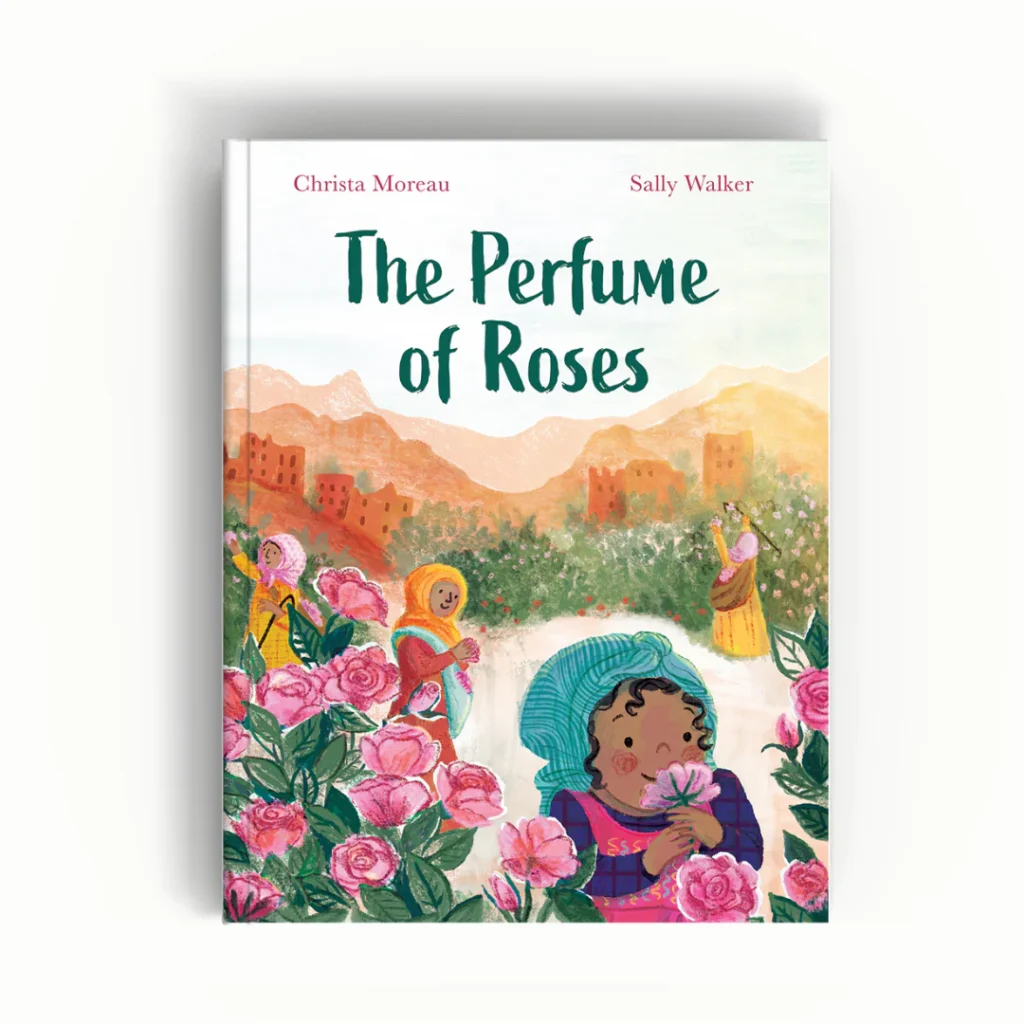




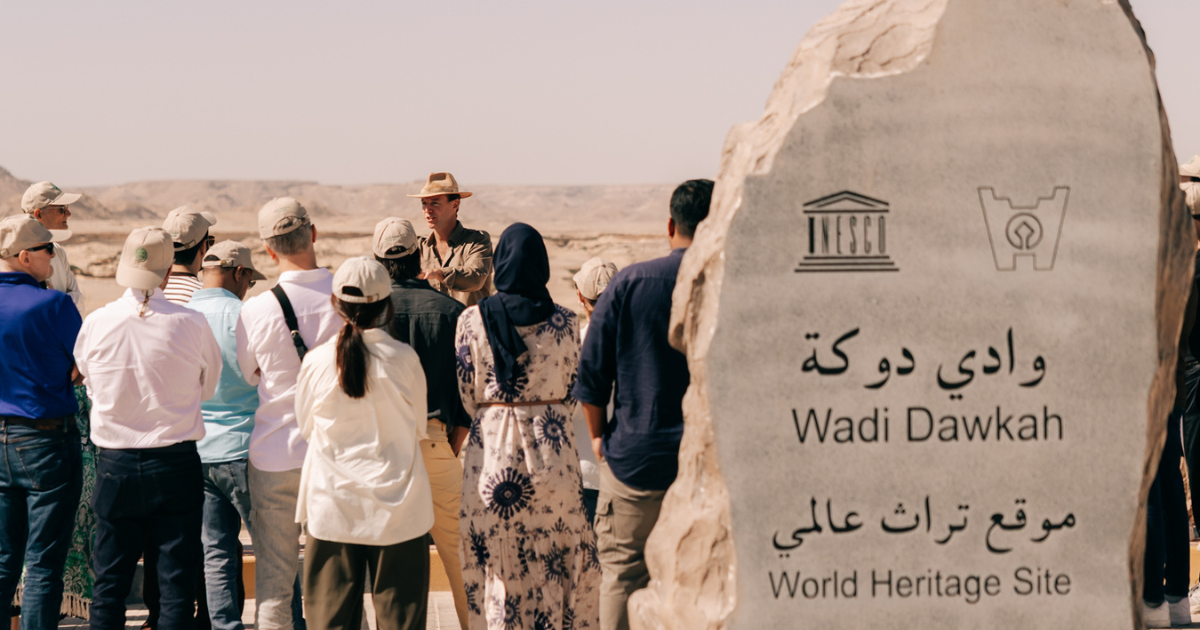




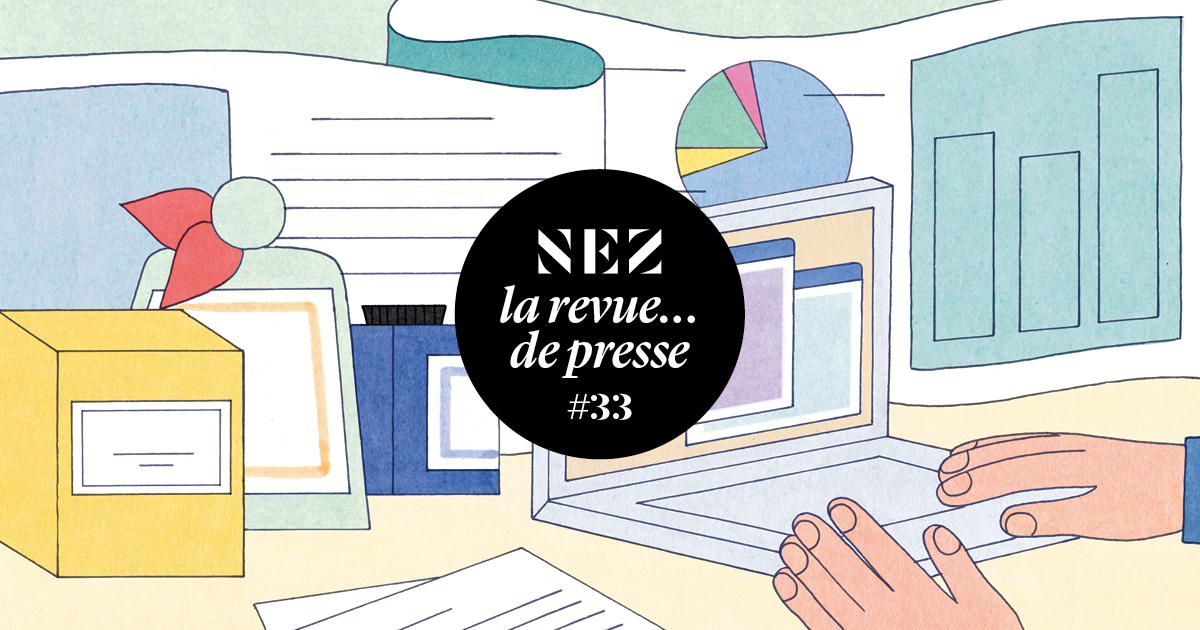
![Les Grands entretiens : Alexander Mohr [Podcast]](https://mag.bynez.com/wp-content/uploads/2025/11/1200-X-630-1.jpg)