Saveur poulet pour des chips, fraise pour un yaourt ou menthe pour un dentifrice… Derrière les arômes que nous ingérons se cache un métier méconnu. Les aromaticiens jonglent entre les exigences d’une industrie mondialisée et les attentes parfois paradoxales de notre époque en quête de naturel. À l’occasion de la Semaine du goût, nous vous proposons de (re)découvrir cet article initialement paru dans Nez #10 – Du nez à la bouche.
« Eux ils sont nez, toi tu es bouche ! » Aromaticienne chez Mane, Véronique Chambovet sourit en citant cet ami qui tenta un jour de comparer son métier à celui des parfumeurs. Car si c’est par la bouche que les arômes alimentaires pénètrent notre corps, c’est au contact de notre système olfactif qu’ils jouent leur rôle véritable, lorsque les molécules odorantes qui les composent sont perçues par voie rétronasale. Un arôme est, d’après le Syndicat national des ingrédients aromatiques alimentaires (SNIAA), « un ingrédient qui apporte un goût et/ou une odeur spécifique à l’aliment auquel il est incorporé à très petite dose », et c’est bien grâce à la rétro-olfaction qu’il influence ce que nous appelons généralement, de manière abusive, le « goût » de ce que nous mangeons. Présents dans le produit final dans des proportions oscillant entre 0,1 % et 2 %, les arômes sont avant tout des parfums… Employés par les sociétés de composition qui élaborent aussi les fragrances que nous portons, les aromaticiens sont bien moins connus du grand public que leurs collègues parfumeurs. Ils n’en colorent pas moins notre vie de tous les jours en concevant ces « goûts » qui s’invitent dans nos cuisines, nos salles de bains… et jusque dans nos vapoteuses. Les arômes sont partout et, s’ils jouissent d’un prestige moins important que la parfumerie fine, ils constituent souvent une part importante de l’activité des entreprises qui les produisent : en 2019, ils représentaient environ 40 % des 3,9 milliards de francs suisses (quelque 3,5 milliards d’euros) de chiffre d’affaires global de dsm-firmenich.
Chez le géant suisse comme chez ses concurrents, l’activité des aromaticiens est très segmentée. La distinction majeure se joue entre sweet (sucré) et savoury (salé). La première catégorie comprend notamment les boissons, les produits laitiers, la biscuiterie, la confiserie et l’hygiène buccale ; la seconde inclut les viandes et leurs substituts, les plats préparés, les margarines, snacks pour apéritif, etc. Selon la taille de leur société, les aromaticiens sont assignés à une catégorie plus ou moins précise : assez polyvalents dans les petites structures, ils sont très spécialisés dans les plus grosses, jusqu’à travailler exclusivement pour les produits laitiers, par exemple, avec parfois même une expertise sur une note précise comme la vanille. Pourquoi un tel cloisonnement ? Car à chaque base censée recevoir l’arôme – chaque matrice, comme on dit dans le jargon – correspondent des enjeux techniques bien particuliers, répond Margaux Cavaillès, aromaticienne côté sucré chez Mane. « Un parfumeur fine fragrance, dont la formule sera diluée dans l’alcool, n’a pas les mêmes contraintes que son homologue de la division home care [produits ménagers], qui va composer pour une base corrosive comme un spray détergent. Avec les arômes, c’est pareil. Dans les boissons, la stabilité est cruciale, il y a des critères de solubilité et de limpidité qui entrent en jeu, alors qu’en biscuiterie d’autres exigences sont induites par le fait qu’on va chauffer le produit, par exemple. »
Un an de travail
Cette importance de la matrice conditionne largement le travail au quotidien. Là où un parfumeur peut rapidement évaluer sa création en conditions réelles, en diluant sa formule dans une solution alcoolique, l’aromaticien troque souvent la mouillette en papier pour des couverts ! De l’eau agrémentée de sel ou de sirop peuvent lui permettre de goûter rapidement ses essais, mais il doit surtout éprouver ses formules dans la matrice visée. Pour cela, il fait appel aux techniciens d’application qui travaillent sur le même segment d’activité que lui. « Imaginons que je compose une vanille pour une glace, propose Emmanuelle Bonnemaison, aromaticienne senior chez Symrise. Une fois que j’ai quelques essais à tester, ils fabriquent de la glace, y intègrent mes arômes, et on goûte ensemble. Ils connaissent parfaitement le produit, les procédés industriels qui lui sont associés, et nos échanges vont me guider dans la formulation des essais suivants. »
Un processus complexe, mais le développement d’un arôme requiert bien moins d’essais que celui d’un parfum : parfois deux seulement et généralement moins de cinquante. Il est également moins long – en moyenne un an entre le brief et la mise sur le marché du produit final par le client, contre deux à trois pour un parfum –, bien qu’un de nos interlocuteurs cite le cas exceptionnel d’une boisson sur laquelle sa société a travaillé dix ans.
Sur-mesure ou prêt-à-consommer
Comme en parfumerie, c’est par le biais d’un commercial qu’un nouveau brief arrive dans une société de composition. Outre un profil olfactif, celui-ci détaille le produit final auquel l’arôme est destiné, le marché visé, les contraintes de prix et de réglementation. L’équipe détermine alors si elle peut répondre à la demande grâce à un arôme déjà présent dans la bibliothèque de la société, qui comprend toutes les références existantes ayant été vendues sans contrat d’exclusivité (donc susceptibles d’être proposées à un autre client) et qui est par ailleurs continuellement enrichie de nouvelles créations. « La maîtrise de ce portefeuille est l’affaire des portfolio managers qui officient dans chaque catégorie, précise Emmanuelle Bonnemaison. Les arômes y sont répertoriés par profil olfactif, par marché, par segment de produit, mais aussi par spécificité : UHT, halal, casher, etc. »
Lorsqu’un brief arrive, bien souvent, l’arôme idoine existe déjà dans cette vaste base de données. Il est alors soumis au client après avoir été testé dans la matrice de ce dernier et parfois ajusté. C’est ainsi qu’une majorité des dossiers est aujourd’hui traitée : « Il y a de moins en moins de création sur mesure, on capitalise au maximum sur ce qui existe déjà », résume Emmanuelle Bonnemaison.
Mais pour une autre partie des demandes, un travail de composition s’impose. L’aromaticien est alors en contact direct avec son client, sans l’intermédiaire de l’évaluateur qui chapeaute la plupart des échanges entre marques et parfumeurs. Loin d’être isolé dans la création pour autant, il peut compter sur le département Consumer Insight (CI), qui exerce aujourd’hui une influence croissante sur tous les développements, qu’ils visent à répondre à un brief précis ou à alimenter la bibliothèque d’arômes. « Le CI représente la voix du consommateur dans le laboratoire de création, résume Anne Besnard, responsable du Sensory & Consumer Insights arômes pour la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient chez IFF. Nous intervenons à trois moments clés : en amont de la création, pour comprendre les attentes – exprimées ou non – d’un client ou d’un marché ; pendant un développement, pour orienter le travail des aromaticiens de manière à ce qu’il réponde le mieux possible à ces attentes, et enfin pendant la phase de validation, lorsque plusieurs produits ont été développés et qu’il faut déterminer lesquels ont le plus de chance de plaire aux consommateurs. »
En parallèle, les aromaticiens entretiennent des échanges quotidiens avec les services réglementaires, qui leur permettent de composer des arômes conformes à la législation de l’industrie agroalimentaire, à la fois complexe et particulièrement stricte, différente dans chaque pays et sujette à d’incessants changements. C’est à l’issue d’un nombre important de procédures qu’un arôme peut enfin être vendu – par lots allant d’une dizaine de kilos à plusieurs centaines de tonnes selon les demandes, et sous près d’une centaine de formes possibles : en poudre, liquide, encapsulé, en billes ou en cristaux…
Un impératif figuratif
Difficile de résister à la tentation de comparer les aromaticiens et les parfumeurs, tant leurs métiers ont de points communs. Souvent issus de cursus voisins (notamment à l’Isipca, à Versailles), formés dans les écoles internes des sociétés de composition, ils travaillent ensuite une palette d’ingrédients commune, à l’exception notoire des molécules de synthèse n’existant pas dans la nature, essentielles à la créativité des parfumeurs mais que les aromaticiens ne manipulent presque pas.
Un symptôme de la différence la plus fondamentale entre les deux professions : l’approche de la formulation. « Lorsque mes amis parfumeurs reçoivent un brief, leur marge d’interprétation est grande, témoigne Jean-Philippe Fourniol, aromaticien senior chez IFF. Tandis qu’un arôme fraise devra toujours avoir le goût de fraise. On peut bénéficier d’un peu de liberté dans certaines notes, gourmandes notamment, mais on conservera toujours un référentiel culinaire ou naturel. » Si la parfumerie fine compte énormément de créations abstraites, les arômes semblent ne pas pouvoir se départir d’un impératif figuratif. « C’est fondamental, renchérit Anne Besnard. Au-delà de ses qualités techniques, un arôme doit contenir des éléments permettant au consommateur de l’identifier. Les gens doivent pouvoir se raccrocher au vrai fruit, au vrai poulet, au vrai fromage. » Quelques contre-exemples (les « arômes fantaisie ») existent, mais ils sont si rares que nos interlocuteurs ne citent guère que le Coca-Cola ou des boissons énergisantes comme Red Bull. Cette exigence de fidélité au référent naturel délimite nettement le cadre créatif dans lequel exercent les aromaticiens, mais elle n’empêche pas leur liberté.
Véronique Chambovet, qui partage son temps entre la biscuiterie-confiserie et l’hygiène buccale, concède que dans ce dernier secteur elle travaille « essentiellement la menthe ». « Mais il y a tellement de variétés différentes ! Et on peut, sans dénaturer le marqueur “menthe”, les twister avec des épices, des aromates, des agrumes… Le champ des possibles est vaste. » De son côté, Emmanuelle Bonnemaison évoque des notes de fleur d’oranger ou des facettes anisées, « perceptibles mais pas forcément identifiables », qui lui permettent de différencier les vanilles qu’elle travaille et d’y trouver un véritable territoire d’expression. Plus que tout, ce sont les contraintes du client qui titillent la créativité des aromaticiens, dès la sélection des matières premières. Reprenons l’exemple de la vanille – l’un des arômes les plus vendus au monde avec la fraise, le chocolat et le poulet. Quatre ingrédients permettent aujourd’hui de la travailler. L’extrait, très onéreux, est obtenu par extraction des gousses. Naturellement présente dans ces dernières, la molécule la plus caractéristique de leur odeur, la vanilline, peut être reproduite sous deux formes, l’une considérée comme naturelle (car obtenue par biotechnologie), l’autre comme synthétique (car obtenue par voie de synthèse chimique) et dite « identique nature ». Enfin, l’éthylvanilline est une molécule de synthèse dite « artificielle » (car n’existant pas dans la nature). Les aromaticiens jouent de ces options en fonction de la revendication que souhaite faire le client : pour que celui-ci puisse écrire sur un packaging « arôme naturel de vanille », 95 % des ingrédients (au moins) doivent provenir de la gousse et les 5 % restants, être naturels. Pour une mention « arôme naturel », pas de minimum d’extrait à utiliser, mais la vanilline de synthèse et l’éthylvanilline restent proscrites. Enfin, « arôme » tout court permet d’utiliser tous ces ingrédients sans restriction. À l’arrivée, la différence de prix est de taille : le kilo d’arôme se monnaie à partir de 5 euros, quand celui de certains extraits purs de vanille dépasse 5 000 euros…
Les goûts et les couleurs
Le marché auquel le produit est destiné constitue un autre paramètre important. Car face à un arôme de fraise, un consommateur espagnol n’a pas les mêmes attentes qu’un Allemand ou un Français : le premier aime sa fraise verte et fraîche, le second plutôt crémeuse et confiturée, et le troisième quelque part entre les deux… Assez arbitraires, ces différences de perception en côtoient d’autres qui s’expliquent par de réelles habitudes de consommation. Anne Besnard prend l’exemple de la mangue, un arôme pour lequel le profil olfactif connaît d’importantes variations selon les marchés. « En France, on mange essentiellement des mangues africaines, qui ont des notes soufrées et florales très différentes des mangues indiennes. Cette différence doit être prise en compte, car, si on propose le mauvais profil de mangue, les consommateurs ne reconnaissent pas le fruit. »
Il n’est parfois pas besoin de traverser les frontières pour constater une grande variété d’attentes vis-à-vis d’un même produit. Commercial chez dsm-firmenich, Nicolas Maire donne ainsi l’exemple d’un célèbre café soluble dont pas moins de sept recettes coexistent sur le seul territoire suisse : à chaque région la sienne ! Dans ce pays perméable à l’influence de la France, de l’Italie et de l’Allemagne voisines, certains produits révèlent des habitudes de consommation plutôt hétérogènes. « À un moment, la marque a voulu rationaliser ses dépenses et s’est mise à proposer une seule recette dans tout le pays. Les ventes ont chuté de 40 % ! Il a fallu réintroduire ces arômes spécifiques. » Alors que certains parfums deviennent des hits planétaires, le succès d’un arôme ne s’affranchit jamais totalement des différences culturelles qui s’expriment encore assez fortement dans l’alimentation, même si la mondialisation tend à homogénéiser les habitudes et les goûts. Là encore, l’exception qui confirme la règle est le Coca-Cola : une abstraction compatible avec toutes les sensibilités…
Du naturel !
Tandis que la découverte d’odeurs inédites peut engendrer de véritables modes en parfumerie, les tendances qui animent l’univers des arômes sont surtout liées aux évolutions de la société bousculant les produits alimentaires eux-mêmes. Tous nos interlocuteurs évoquent le phénomène « végétal » qui rebat les cartes de l’industrie depuis quelques années. Des steaks de céréales aux laits végétaux et à tous leurs dérivés, ces nouvelles matrices suscitent dans certaines sociétés la création d’équipes spécialisées. « Ce sont des bases compliquées, avec souvent beaucoup de off notes [des notes désagréables] qui doivent être masquées », précise Nicolas Maire. Aux arômes hédoniques, destinés à apporter du plaisir à la dégustation, se juxtaposent alors des arômes « technologiques », dont la vocation est plutôt de compenser un défaut perçu.
L’engouement de notre époque pour le naturel se retrouve aussi dans le cahier des charges des arômes eux-mêmes. « Les clients l’exigent de plus en plus, jusqu’à nous demander parfois le retrait de la mention “arôme”. Cela nous oblige à jouer avec des extraits », témoigne Margaux Cavaillès. Sauf que, ici comme en parfumerie, l’obsession pour le naturel n’est pas compatible avec les ressources limitées de la planète – planète qu’elle entend souvent, paradoxalement, protéger. « Tout le monde veut du naturel, du bio, mais personne ne comprend que la Terre ne peut pas nous fournir indéfiniment, regrette Nicolas Maire. Pour obtenir un litre d’extrait pur de fraise, il faut parfois plus de deux tonnes de fruits. C’est-à-dire que, si vous preniez littéralement toutes les fraises du monde, vous pourriez répondre aux besoins en extrait naturel… de l’Allemagne. »
L’ironie ne s’arrête pas là. Car il faut encore que l’arôme soit perçu comme authentique par des consommateurs dont le goût a été façonné par des standards qui ne l’étaient pas. « Ils demandent de la naturalité, mais souvent on leur présente un extrait et ils le rejettent, constate Emmanuelle Bonnemaison. Beaucoup ont une vision déformée de la cerise, par exemple, parce qu’ils se sont habitués à la molécule qu’on lui associe, le benzaldéhyde, avec cette note “noyau” amandée que la vraie cerise n’a pas si intensément. » Et lorsque ce ne sont pas les arômes qui ont déformé le palais des consommateurs, ce sont les contraintes de l’industrie agroalimentaire mondialisée qui en ont eu raison. « Combien de gens savent ce qu’est un vrai goût de pêche ?, s’interroge Jean-Philippe Fourniol. Ceux qui ont eu le privilège d’en cueillir une sur l’arbre à maturité savent que c’est très différent de celles que l’on trouve en supermarché : des fruits cueillis trop tôt pour qu’ils tiennent le temps du transport. »
Finalement, comme souvent, tout est une question d’éducation. « On a régulièrement été montrés du doigt, accusés de mener les gens par le bout de la langue, poursuit Jean-Philippe Fourniol. Pourtant on ne fait que répondre aux attentes du consommateur, et on mesure combien celui-ci est paradoxal. Il attend d’un produit qu’il soit rigoureusement identique toute l’année, et les arômes permettent justement cette standardisation. Si on passe au tout-naturel, il faut prendre en compte la saisonnalité, accepter que certaines tonalités soient parfois accessibles et parfois non, qu’il puisse y avoir des variations de goût. Ça, le consommateur est prêt à l’accepter quand il fait la cuisine ou qu’il va au restaurant, mais pas quand il achète un produit industriel. Les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à l’écologie, à l’impact des modes de production sur la nature. Mais est-ce qu’elles le répercutent réellement sur leur façon de consommer ? » Si l’industrie fait le pari de la transparence et de la pédagogie, les aromaticiens pourront certainement jouer un rôle essentiel dans cette délicate – mais nécessaire – transition.
- Cet article est initialement paru dans Nez, la revue olfactive #10 – Du nez à la bouche
Visuel principal : © Antoine Cossé






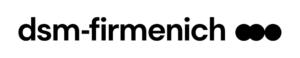

Commentaires