Notre intérêt pour ce qui sent est souvent réduit au plaisir que nous, humains, pouvons y prendre – ou non. Pourtant, les molécules olfactives ont bien d’autres fonctions. En s’y plongeant, notre nez peut-il se faire le vecteur d’une transformation de notre rapport au monde ? C’est la question que pose cet article que nous vous proposons à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, ce mercredi 5 juin.
Notre rapport aux odeurs semble relativement superficiel et polarisé : celles que l’on apprécie d’un côté, celles que l’on n’aime pas de l’autre. Pourtant, dans le monde vivant, les molécules olfactives ont des fonctions bien plus diversifiées – y compris pour l’humain. Nous en prenons conscience lorsque nous expérimentons ce handicap qu’est l’anosmie : notre nez nous permet, certes, de prendre du plaisir lors de nos repas et dans notre environnement, mais aussi de nous protéger des mets avariés, de nous alerter de divers dangers invisibles, ou encore de créer de l’attachement grâce à la mémoire olfactive.[1]Voir l’ouvrage Être nez sans odorat de l’association Anosmie.org, auto-édition, à paraître le 6 juin 2024
On a souvent dit que l’odorat a été mis de côté parce qu’il serait le sens qui nous renvoie le plus à notre animalité.[2] Voir notamment Chantal Jaquet, Philosophie de l’odorat, PUF, 2010 Son rejet tient aussi, probablement, de ce qu’il est par son fonctionnement même le sens le plus lié aux émotions, à ces « affects » que les penseurs de différentes époques se sont attachés à faire passer de l’autre côté de la rationalité, dans ce geste dualiste (corps/âme, animal/humain) qui a traversé la majeure partie de la pensée philosophique. Dans ce geste de rejet de la sensibilité, nous avons cherché à effacer une part de nous : nous sommes en effet une part de ce vivant que nous nous attachons pourtant à exploiter.
Atmosphère anthropocène
Nous avons ainsi fait du vivant un « environnement » : quelque chose qui nous entoure, nous humains, comme nous avions jadis fait de la Terre le centre de l’Univers, dans notre folie toute nombriliste. Quelque chose que nous pouvons utiliser, travailler, nous approprier : « Pour le capital, la nature est l’ensemble des réalités qui, n’ayant pas de valeur, sont disponibles pour l’appropriation », résume ainsi le chercheur en philosophie Paul Guillibert.[3]Paul Guillibert, Exploiter les vivants, Amsterdam, 2023, p. 74 Comme le rappelle Dominique Roques dans Le Parfum des forêts, les humains n’ont pas attendu pour décimer les cèdres du Liban : « Il reste aujourd’hui moins de 2% de la forêt initiale. Toutes les civilisations de l’Antiquité sont venues couper les cèdres, ils avaient déjà presque disparu avant que notre Moyen Âge ne commence. Avec les cèdres, l’humanité à l’aube de son histoire a inauguré l’exploitation sans limite de la nature, une tragédie qu’elle va rejouer avec application partout sur la Terre jusqu’à nos jours. » Mais cette fureur consumériste s’est, comme on le sait, nettement amplifiée ces dernières années : « Ce que le monde occidental va faire de ses forêts à partir du début de l’ère moderne est la réplique accélérée de ce qui s’est joué dans le temps long au Proche-Orient. Il aura fallu trois mille ans de coupe des cèdres pour commencer à manquer d’arbres capables de fournir des poutres, mille ans suffiront pour que le XVIIe siècle européen constate une pénurie de grands arbres pour la construction de navires. […] Tout a changé d’échelle, en dix ou douze siècles, les hommes ont coupé dans le seul pays de France, avec les mêmes outils, l’équivalent de trois cent fois la surface de la forêt des cèdres du Liban ! », poursuit l’auteur.[4] Dominique Roques, Le Parfum des forêts – L’homme et l’arbre, un lien millénaire, Grasset, 2023, p. 55; p. 85
Et ainsi, à bien des égards, nous avons rendu l’air irrespirable. C’est ce que met en avant l’exposition « Atmosphère primale », issue d’un travail de recherche et création mêlant arts et sciences et qui rend en effet sensible, à travers des expériences polysensorielles, l’évolution de l’air et de ses odeurs sur le temps long : « L’équipe cherche à rendre perceptibles les atmosphères passées et futures, confrontant ainsi les visiteurs à l’irrespirabilité de ces espaces […] invitant le public à une réflexion profonde sur notre place dans l’univers et notre relation au vivant qui ne se limite pas à l’humain », note Edwige Armand, artiste et maîtresse de conférences en art numérique, qui a imaginé ce projet. En expérimentant par tout notre corps les évolutions drastiques de l’environnement, sur le temps long mais aussi sur le temps court des dix dernières années, l’exposition nous invite à porter un autre regard sur l’air que nous avons rendu moins respirable. Roland Salesse, ingénieur agronome et docteur en sciences, remarque : « À partir de l’ère industrielle, tout change : les pollutions s’intensifient, et l’exploitation du pétrole à partir du XIXᵉ modifie notre environnement olfactif mais aussi celui de tout le vivant, que nous noyons dans un bruit olfactif. On a oublié que les odeurs signifiaient quelque chose, on superpose des senteurs manufacturées à celles existantes : des parfums floutent les senteurs des bases désagréables de nos lessives ».
Réodoriser le monde
Parallèlement à la désodorisation que l’hygiénisme a véritablement ancrée, nous avons réodorisé le monde, achevant le geste d’appropriation du vivant dont les racines remontent plus loin que ne le laisse imaginer le concept d’ « anthropocène », aujourd’hui mis en avant. Nous avons décorrélé les odeurs des informations qu’elles sont censées porter, et ce désintérêt conscient fait le bonheur du marketing olfactif. De fausses odeurs de croissant chaud sont diffusées pour attirer les clients dans les boulangeries industrielles, le plastique des poupées est parfumé à la vanilline pour que l’on en oublie la toxicité… Et les constructeurs des usines à bitume de l’autoroute A69 reliant Castres à Toulouse promettent de parfumer aux huiles essentielles les émanations polluantes. Qu’importent qu’elles rejettent de l’oxyde d’azote, du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre ou encore du benzène, toxiques pour l’humain comme pour bien d’autres vivants. Certes, des initiatives pionnières, et notamment celles d’Atmo Normandie, mettent un coup de projecteur sur les nuisances olfactives, en parallèle à leur travail sur la surveillance de l’air par la mesures des composés chimiques qui s’y trouvent. En proposant une formation aux habitants pour qu’ils puissent devenir évaluateurs, l’association participe à l’amélioration de la qualité olfactive ambiante dans une région où les industries sont nombreuses. Mais sa directrice, Véronique Delmas, souligne aussi qu’il n’y a « pas de lien univoque entre toxicité et odeurs : des molécules peuvent sentir mauvais sans être néfastes, et à l’inverse des composés inodores peuvent présenter des dangers conséquents. Par ailleurs, le recours au masquage d’une odeur par une autre peut poser problème, car on ajoute un composé de plus, dont on ne connaît pas toujours les propriétés chimiques ». En bref, un pansement sur une jambe de bois, qui pose aussi le problème de la confiance que nous pouvons avoir en notre capacité olfactive : « dans ce cas, notre nez ne peut plus s’acquitter de sa fonction première, qui est de nous avertir du danger », appuie un récent documentaire proposé par Arte.[5]Voir https://www.arte.tv/fr/videos/109817-007-A/que-nous-transmettent-les-odeurs/
Faisons un pas de plus : les parfums ne se contentent pas de flouter les informations émises par notre environnement. À l’opposé des discours ambiants, ils tendent de plus en plus à nous habituer aux odeurs « antithétiques de la nature » à l’instar du recours aux bois ambrés, qui par leur puissance concentrent l’attention sur la personne qui les portent (boostant au passage leur attractivité et donc les ventes) , comme nous l’écrivions dans l’article que nous leur avions consacré : « Ironiquement, à l’heure où le public réclame plus de naturel, de sain, de bio, et où les marques ne communiquent quasiment que là-dessus – ne se gênant d’ailleurs pas pour avancer des pourcentages plus ou moins mensongers, du moins trompeurs, pour nous rassurer –, le sillage des bois ambrés peut être perçu comme une antithèse de la nature. Et ce n’est pas tant leur origine 100% artificielle qui pose problème – comme déjà évoqué sur ce site – mais le fait qu’ils évoquent une atmosphère urbaine, polluée, une sorte de retranscription olfactive de pots d’échappements, de pétrole, de tarmac d’aéroport, d’émanations d’usines, de cendriers ou de goudron. Un condensé de tout ce que notre société de consommation génère de pire, en somme. »
Par ailleurs, estimer l’impact de la parfumerie sur le vivant en général reste complexe : nous avions consacré un dossier entier posant de premières ébauches sur son caractère « durable », soulevant autant de questions qu’il en traitait. Depuis, d’autres approches ont étoffé cette réflexion, avec notamment celui sur le néocolonialisme latent de l’industrie dans Nez#17 – Argent & parfum : l’exploitation des populations plus précaires – moins protégées par les droits sociaux de leur pays – pour participer à la récolte des matières premières naturelles qui entrent dans nos flacons participe à la dégradation du vivant humain et non humain, sans parler du fait que les populations exploitées seront aussi les premières à subir les conséquences du changement climatique et de la perte de biodiversité. Les champs de monoculture, les techniques de transformation énergivores et les quantités de flacons produits participent évidemment à la destruction du vivant, comme c’est le cas de toute industrie de masse.
Sentir le vivant : une autre voie est possible
Il faudrait donc imaginer une autre manière de considérer la nature, non plus comme un environnement, mais comme vivant, permettant de nous inscrire en son sein à l’égal des autres êtres, – animaux, végétaux… – qui la composent. Et cela passera, selon le philosophe Baptiste Morizot, par une attention sensible qui permettra de contrer la « crise de la sensibilité » dont il fait le constat dans Manières d’être vivant : celle-ci consiste en « un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant […] conjointement un effet et une part des causes de la crise écologique qui est la nôtre. »[6]Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Actes sud, 2020, p. 21 Si l’auteur ne se penche pas en particulier sur notre odorat, qu’il qualifie ici ou là de « sens pauvre », on peut cependant argumenter que cet appauvrissement est justement une conséquence (et cause) de la crise de la sensibilité, et non pas un statu quo inhérent à notre génétique humaine. On peut en tout cas imaginer une autre manière de sentir, comme le fait Clara Muller, historienne de l’art et rédactrice pour Nez, qui se penche sur le lien entre odorat et vivant dans un projet d’ouvrage, et qui anime des ateliers de sensibilisation à destination du grand public : « Les odeurs ne sont pas seulement des odeurs pour nous humains : ce sont des messages que s’échangent les vivants. Cette idée s’est imposée à moi lors d’une promenade dans le Jura, où j’avais été la seule d’un groupe de quinze personnes à avoir prêté attention à ce que nous croisions. Je ne cessais de me répéter “si la forêt sent si bon, c’est parce qu’elle parle”. À la même période, j’ai lu les ouvrages de Vinciane Despret, de Laurent Tillon, d’Estelle Zhong Mengual ou encore de Baptiste Morizot, qui m’ont confortés dans cette intuition. Prêter une attention sensible au vivant est une nécessité, et cela passe selon moi aussi par l’odorat. Certains artistes contemporains l’ont d’ailleurs bien compris ! ».
Elle reprend l’hypothèse du philosophe selon laquelle ce sont les pratiques et non les seules idées qui permettent de faire évoluer les choses : « Baptiste Morizot prône notamment le pistage, mais nous pouvons penser à d’autres pratiques, concevoir des sessions d’olfaction naturalistes, à l’écoute des senteurs, pour nous y rendre plus sensibles », imagine Clara Muller. On pourrait tirer de cette nouvelle manière de sentir des bénéfices concrets, « en termes de biocontrôle en agriculture, pour lutter contre les insectes ravageurs, contrôler les maladies vectorielles – en attirant hors des habitats humains les moustiques – ou encore pour protéger les animaux lorsque nos routes traversent leurs habitats, en les attirant vers des ponts à l’aide de dispositifs odorants », énumère-t-elle. Mais c’est surtout la question d’une « reconnexion essentielle au monde » qui intéresse la chercheuse, au-delà de tout bénéfice pratique immédiat. L’idée étant à terme de provoquer un changement de paradigme dans notre rapport à l’olfaction, afin de : « sentir une rose pour la valeur intrinsèque de sa vie de rosier », et non seulement parce que son odeur est plaisante pour nous.
Sentir la vie d’un rosier
L’attention de plus en plus accrue au « langage du vivant » pousse les chercheurs à se pencher sur leurs odeurs, éléments de communication importants puisque transportables dans l’air. Le biologiste David G. Haskell propose ainsi de sentir divers végétaux et d’en comprendre les significations dans son ouvrage Le Parfum des arbres, 13 façons de le respirer, publié en 2022 aux éditions Flammarion.
On se confronte alors à un monde complexe, dans lequel on a d’ailleurs peu mis le nez jusqu’à présent, comme l’explique Roland Salesse : « À l’échelle du micromètre (millième de millimètre), il y a les microbes qui échangent entre eux par des signaux chimiques, mais ceux-ci ne sont pas toujours perceptibles pour nous. À l’échelle des individus multicellulaires, comme les plantes et les animaux, la diversité est fantastique, notamment chez les insectes qui communiquent beaucoup par phéromones. Mais les plantes sont également d’incroyables usines à composés chimiques, ceux-là mêmes dont la parfumerie exploite les produits. » Les signaux olfactifs émis par les plantes peuvent être des signaux de comestibilité et d’habitabilité qui déclencheront copulation et/ou ponte…
Parmi ces molécules, « certaines sont issues de la photosynthèse, comme les terpènes ; d’autres sont des produits métaboliques, comme le parfum de la rose », précise-t-il. Parmi les championnes de l’odorat – qui mettraient K.O. tout participant à un bras de fer olfactif – on pense aux abeilles, dotées d’une soixantaine de récepteurs olfactifs, capables d’apprendre à leurs collègues où trouver par exemple des sources alimentaires, ou encore aux fourmis, laissant derrière elles des phéromones de piste.
Mais en réalité, les échanges sont aussi nombreux que les vivants eux-mêmes, comme le montre l’ouvrage L’Odorat des animaux de Gérard Brand (EDP Sciences, 2023).
Il nous serait alors in fine possible de porter un regard différent sur les parfums, comme y invite Clara Muller, « en considérant qu’ils sont composés, entre autres, par les mots des vivants autres qu’humains. On peut ainsi penser son parfum comme un bouquet de significations multi-spécifiques. Ce décentrement de notre façon de sentir ce que nous considérons en général simplement comme un assemblage de “matières premières” me semble être à la fois une manière de rendre des égards à tous les non-humains qui contribuent à nos parfums, et une manière de réenchanter quelque peu la parfumerie. »
Voilà enfin de quoi se réjouir, et espérer, peut-être, que nous posions un autre nez sur le vivant, en ne le considérant plus comme simple environnement.
Visuel principal : Rosa et Auguste Bonheur, Bovins sur une colline, 1851. Source : Wikimedia Commons
Notes
| ↑1 | Voir l’ouvrage Être nez sans odorat de l’association Anosmie.org, auto-édition, à paraître le 6 juin 2024 |
|---|---|
| ↑2 | Voir notamment Chantal Jaquet, Philosophie de l’odorat, PUF, 2010 |
| ↑3 | Paul Guillibert, Exploiter les vivants, Amsterdam, 2023, p. 74 |
| ↑4 | Dominique Roques, Le Parfum des forêts – L’homme et l’arbre, un lien millénaire, Grasset, 2023, p. 55; p. 85 |
| ↑5 | Voir https://www.arte.tv/fr/videos/109817-007-A/que-nous-transmettent-les-odeurs/ |
| ↑6 | Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Actes sud, 2020, p. 21 |






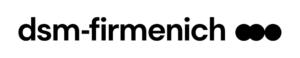

Commentaires