Maître parfumeur chez DSM-Firmenich (anc. Firmenich), société de composition dans laquelle il est entré en 1992, Olivier Cresp est l’auteur de quelques-unes des créations les plus emblématiques des années 1990 (Angel de Thierry Mugler, Noa de Cacharel, L’Eau par Kenzo pour femme et pour homme…) et des suivantes (Light Blue de Dolce & Gabbana, Nina de Nina Ricci, Black Opium d’Yves Saint Laurent…), mais aussi le cofondateur de sa propre marque de parfums, Akro. Il nous partage ses impressions sur la parfumerie de cette décennie, et en particulier sur la tendance marine, véritable marqueur olfactif de l’époque. À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan ce jeudi 8 juin, nous vous offrons cet entretien initialement paru dans Une histoire de parfums de Yohan Cervi.
Comment se passait le développement d’un parfum dans les années 1990 ?
Il y avait beaucoup moins de lancements. Quand on avait 350 nouvelles références par an, c’était le bout du monde. Aujourd’hui, nous sommes à plus de 2 500 lancements mondiaux, notamment du fait des flankers et de la profusion de marques de niche. Il est très difficile de faire un grand succès. À l’époque, la logique était différente. On signait un parfum féminin pour une marque, puis, éventuellement, un ou deux ans plus tard, sa version masculine. Le turn-over était moins important, et les parfums restaient généralement plus longtemps sur le marché.
Quelles sont pour vous les créations emblématiques de la sous-famille olfactive des aquatiques ?
On peut trouver les origines de ce courant en 1989, dans Parfum d’elle de Montana, le premier aquatique transparent. Mais la tendance va véritablement exploser l’année suivante, aux États-Unis, avec New West d’Aramis. Parmi les parfums emblématiques, il y a Escape de Calvin Klein, L’Eau d’Issey d’Issey Miyake et bien sûr Acqua di Giò de Giorgio Armani, tous de très grands succès. On peut également citer L’Eau par Kenzo, un aquatique assez atypique sur lequel j’ai travaillé.
Des créations originales et novatrices, très marquées par la Calone…
Oui, c’est une molécule artificielle de DSM-Firmenich, brevetée par Pfizer dans les années 1960. Lorsque j’ai commencé ma carrière, on l’employait en très petite quantité, presque à l’état de traces. À partir des années 1990, on a osé multiplier les proportions par cent dans les formules… La Calone a été une vraie révolution. J’ai même tenté de l’introduire dans un des essais d’Angel. Comme le parfum était bleu, une couleur froide, Vera Strubi (alors présidente des Parfums Mugler) se demandait si l’on ne devait pas en ajouter, pour créer une fraîcheur aquatique. J’ai donc essayé une variante avec la fameuse molécule, mais le résultat était assez désagréable et créait une dissonance avec les notes gourmandes et le patchouli. Le parfum devenait également trop puissant et intense.
C’est par ailleurs la décennie d’un autre grand succès de DSM-Firmenich, CK One, qui incarne aussi à sa manière une nouvelle fraîcheur.
Oui, car on ne peut pas parler de cette vague de fraîcheur sans parler de CK One, créé par Alberto Morillas et Harry Frémont. C’est un accord thé très frais et propre, une cologne moderne. Nous nous sommes tous beaucoup interrogés à l’époque sur la capacité de ce genre de notes à fonctionner sur le marché américain. C’était une vraie prise de risque, car il n’existait pas de fragrances de ce type aux États-Unis, et CK One constitue le premier parfum frais contemporain sur ce marché. Le brief était simple, il s’agissait de composer une cologne fraîche autour d’une note de thé. Un parfum frais et moderne pour une nouvelle génération d’adolescents. Il avait une ambition américaine, mais a connu un immense succès mondial. Il a ouvert la voie à une nouvelle forme de fraîcheur et une nouvelle génération de colognes.
En quoi la tendance marine, avec cette quête de l’odeur de l’eau de mer, rencontrait-elle son époque ?
Les grandes ruptures en parfumerie sont marquées par les crises. Dans les années 1990, il y a peut-être la pandémie du sida, les prises de conscience écologiques. Ces notes fraîches, propres, transparentes, apparaissent comme des moyens de protection. C’est également une parfumerie plus jeune, qui s’éloigne de la tendance des parfums à base de tubéreuse et au profil olfactif chargé des années 1980. Et la contribution de DSM-Firmenich à ce courant est considérable, de nombreuses fragrances emblématiques ayant été créées par des parfumeurs de la maison, comme Acqua di Giò d’Armani.
Vous avez d’ailleurs vous-même signé L’Eau par Kenzo pour femme en 1996, pouvez-vous nous en parler ?
J’ai travaillé sur ce parfum avec Pierre Broc, qui était à ce moment-là président des Parfums Kenzo. Il était pour moi comme un deuxième père. Avec Kenzo Takada, ils marchaient à l’intuition. Le brief, c’était « H2O ». « Mais attention, me disait-il, de l’eau de source, pas de l’eau de mer. » L’idée était de faire surgir un paysage de campagne au printemps : une prairie, le ciel bleu, une rivière, les coquelicots et la rosée du matin. J’ai écrit tous ces mots, que j’ai traduits en matières premières pour créer un parfum figuratif. Le rendu est aérien, vif, cristallin, avec cette fraîcheur humide qui perdure.
Et la version masculine ?
Pour le masculin, j’ai eu envie de travailler autour du yuzu (un agrume japonais), une note peu connue à l’époque. Ce fut une intuition. Il y a également dans ce parfum de la Calone, de la bergamote, de l’orange, de la limette, des aldéhydes et beaucoup de muscs. Il a un beau sillage, mais conserve cette fraîcheur propre et transparente. L’idée initiale était de le lancer uniquement au Japon, mais, devant son succès, sa distribution a finalement été déployée à l’international.
Vous êtes aussi l’auteur de Dune pour homme de Dior, qui n’est pas vraiment océanique olfactivement parlant, mais qui s’inspire d’un environnement de bord de mer.
Dior voulait faire un Dune au masculin, qui crée une passerelle avec le féminin signé Jean-Louis Sieuzac et Dominique Ropion. Je l’ai senti de nouveau et j’y ai décelé une note de figue. Je suis ainsi parti sur une feuille de figuier plutôt que sur le fruit, avec beaucoup de mandarine, qui confère à l’ensemble une fraîcheur intense. À travers ce parfum, l’idée était également d’imaginer une nouvelle Eau sauvage, celle d’une nouvelle ère, en quelque sorte. Il a été très bien accueilli par le public à son lancement.
Même si le marketing était déjà très important, on a le sentiment que certains grands lancements étaient plus intuitifs…
Oui, il y avait beaucoup moins de tests consommateurs, et une certaine forme d’audace. Je ne dis pas que c’était mieux qu’aujourd’hui – chaque période apporte son lot de merveilles, de progrès et d’innovations –, mais il s’agit d’une époque qui mérite d’être célébrée.
Qu’est-ce qui a changé, depuis, dans votre manière de travailler ?
À l’époque, on travaillait davantage en solitaire. Aujourd’hui, il y a bien évidemment une compétition avec les autres sociétés de composition, mais en interne, chez DSM-Firmenich, la concurrence n’existe plus. On travaille ensemble dès le départ, cela fait partie de notre culture. Les étudiants en parfumerie, à l’Isipca ou à l’École supérieure du parfum, ont également l’habitude du travail collectif. Nos clients apprécient cette démarche collaborative pour le développement d’un parfum. Nous signons désormais souvent une fragrance à deux, à trois. Je trouve cela agréable et reposant. Il y a une véritable entraide, qui constitue selon moi une forme de progrès.
- Cet article est initialement paru dans Une histoire de parfums de Yohan Cervi.
- Vous pouvez également lire un grand entretien avec Olivier Cresp dans le dernier numéro de la revue Nez, Au fil du temps.
Visuel principal : © Franck Juery


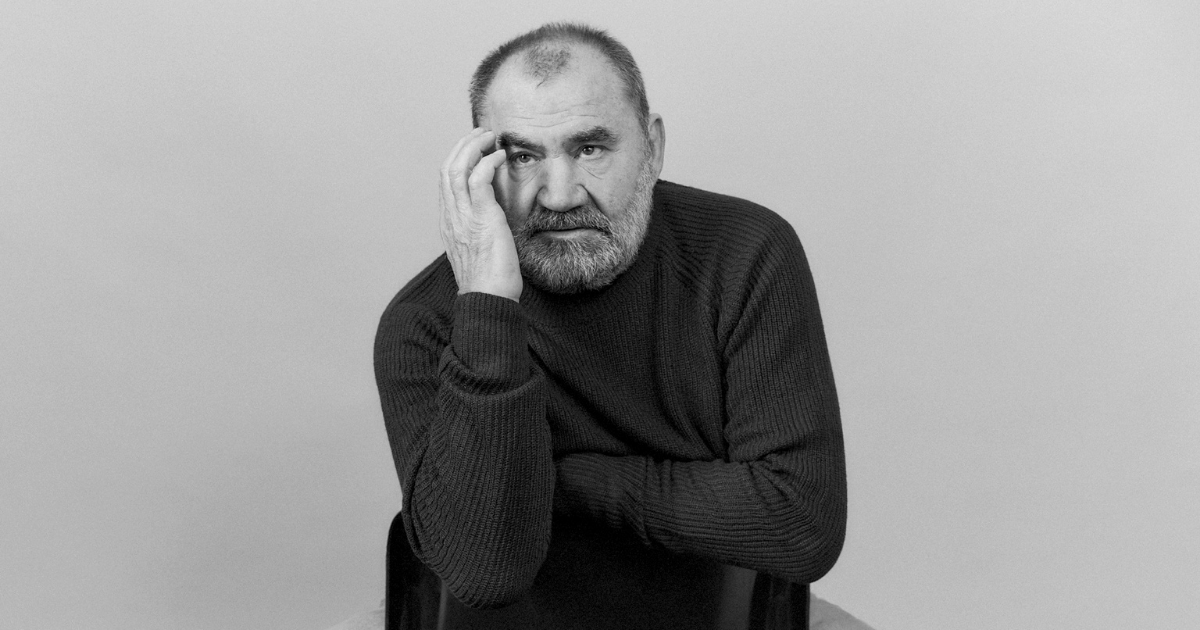



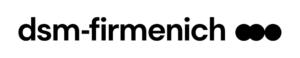

Commentaires