Créée il y a 50 ans, Atmo Normandie est l’association régionale de surveillance de la qualité de l’air. Elle forme notamment de nombreux nez normands, capables de signaler les problèmes d’odeurs sur la région et d’aider à établir un dialogue avec les industriels. Pour la date anniversaire, l’association propose aussi de nombreux événements réjouissants. Véronique Delmas, qui en est la directrice, et Baptiste Delaunay, ingénieur d’études, nous parlent de son histoire et de son fonctionnement.
Pouvez-vous nous parler de la naissance d’Atmo Normandie ?
Véronique : Il faut remonter 50 ans en arrière, dans les années 1973-1974 : à l’époque, la région était particulièrement industrialisée ; le niveau de pollution était alors très supérieur à aujourd’hui, avec des centrales thermiques et des raffineries qui ont pour certaines fermé depuis. La nécessité de créer un réseau de contrôle de la qualité de l’air s’est faite sentir : cela a été le deuxième au niveau national. Au côté des services de l’État, des collectivités territoriales et des industriels, les associations REMAPPA[1]Réseau d’Etude et d’Alarme pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique sur Rouen et ALPA[2]Association de Lutte contre la Pollution Atmosphérique sur Le Havre, réunies plus tard en Air Normand était née en Haute Normandie, et c’est la fusion avec Aircom en Basse Normandie, lors de la réforme des régions en 2015, qui a abouti à la dénomination Atmo Normandie.
Si la surveillance de la qualité de l’air était d’abord centrée sur les problématiques industrielles – et cela reste un de nos domaines d’expertise – nous nous sommes peu à peu rendus compte qu’il y avait d’autres enjeux importants, comme le chauffage, le trafic ou les pratiques agricoles.
Quelles sont les techniques d’évaluation de la qualité de l’air ?
Baptiste : Il y a, d’une part, la surveillance de l’air, qui est obligatoire : certains polluants, comme par exemple le benzène, les particules (PM10 et PM2.5), le dioxyde d’azote, l’ozone et/ou le dioxyde de soufre, sont en effet réglementés ; l’OMS a aussi établi des valeurs seuils. Ils sont mesurés grâce à divers capteurs.
En parallèle, il y a la surveillance des odeurs. Les habitants se posent en effet facilement des questions sanitaires à leur sujet, même s’il faut souligner qu’il n’y a pas de lien univoque entre toxicité et odeurs : une mauvaise odeur peut ne pas être dangereuse, et l’inverse est vrai aussi, ce qui est dangereux n’a pas forcément d’odeur. Mais c’est aussi une question de nuisance, de confort.
Véronique : Les évaluations olfactives de l’air ont émergé dès les années 1980-1990 au Havre ; elles étaient assez rudimentaires, il fallait que les habitants sortent deux fois par jour de chez eux, et notent s’ils sentaient des odeurs gênantes, en leur attribuant une puissance sur une échelle de 1 à 5. Ces données étaient corrélées aux directions du vent et permettaient déjà d’identifier certaines problématiques.
Une première évolution a eu lieu à la fin des années 1990 : une industrie de fabrication d’huile de colza, qui s’était développée sur l’agglomération de Rouen, émettait des odeurs nouvelles. Des habitants ont alors été formés au Champ des odeurs, la méthode de classification olfactive imaginée par Jean-Noël Jaubert. Cela demandait beaucoup d’engagement, avec 70 heures de formation : je me souviens de m’être demandé si ça pouvait fonctionner… Et ça a été le cas ! L’industriel en question a mis en place un biofiltre pour réduire les nuisances et les habitants ont pu mesurer la réduction des odeurs. Et cela a aussi permis de créer du lien entre tous les acteurs autour de visites de sites olfactives, permettant de sentir et de comprendre les différentes émanations lors de la transformation, et l’ambiance a vraiment évolué. Cela nous a poussé à développer à nouveau le concept avec d’autres usines dans d’autres secteurs.
Désormais, vous utilisez le « Langage des nez »[3]Le Langage des nez est un modèle déposé. pour former habitants et industriels, quel en est l’intérêt ?
Baptiste : Il permet de qualifier les notes odorantes perçues sans rester sur du subjectif de gêne ou d’appréciation. Il permet de donner une objectivité aux perceptions : il s’agit d’une méthode qui a fait l’objet de publications scientifiques, cela aide à notre crédibilité. Ce langage commun permet aussi de réaliser des audits olfactifs : l’utilisation des mêmes termes permet de faire le lien entre les industriels et les particuliers. Une station d’épuration a ainsi récemment organisé une visite pour les personnes formées au Langage des nez, en leur expliquant les étapes. Par la suite, ces personnes peuvent faire le lien avec les autres habitants, et on observe ainsi que les plaintes sont beaucoup moins récurrentes. Mais pour cela, il est aussi nécessaire que l’industriel s’inscrive dans une démarche de progrès et communique de façon transparente, en cas d’incident par exemple. Ce qui est recherché ainsi, c’est notamment l’amélioration du cadre de vie.

Les habitants non formés ont-ils leur mot à dire ?
Baptiste : Nous utilisons une plateforme en ligne, Signalair,[4]https://www.signalair.eu/fr/ créée avec d’autres associations de surveillance de la qualité de l’air, qui permet à tout citoyen de recenser une gêne visuelle (fumée…) ou olfactive. On parle en évocations, cela permet d’avoir un maillage plus complet de la région, et l’on peut ensuite envoyer des nez formés sur le terrain pour passer de l’évocation à la note odorante, et entamer de vraies recherches.
Comment les industriels font-ils évoluer leurs pratiques en conséquence ?
Véronique : Ils réalisent localement des audits olfactifs, et forment des évaluateurs en interne : il y a par exemple 18 personnes formées pour l’usine TotalEnergies du Havre. Lorsqu’un signalement est fait par un nez industriel formé au Langage, cela peut déclencher une alerte chez tous les nez formés dans les industries voisines, qui complètent l’alerte et nous permettent de faire un bilan afin de détecter la source olfactive.
Quand un problème se pose, beaucoup de solutions se présentent : de l’entretien plus régulier des tuyaux à l’investissement dans un biofiltre…
Baptiste : Il y a aussi beaucoup d’échanges entre les entreprises, de visites olfactives entre elles. Depuis quelque temps, on observe que la question se pose en amont d’une installation, pour anticiper cette problématique. On essaie de travailler ensemble ; cela peut être sur le sourcing, le process ou le traitement post émission.
Y a-t-il des notes olfactives qui reviennent en particulier dans les signalements ?
Baptiste : Cela dépend des endroits. On a notamment des problématiques avec les méthaniseurs [installation de traitement des déchets agricoles permettant de produire du biogaz], ou au niveau des zones d’enfouissement, qui dégagent des odeurs de déchets ménagers. Au Havre, près des raffineries, c’est une note assez soufrée qui est relevée, même si elle est moins forte qu’avant. Mais cela peut aussi être des émanations au niveau d’usines de torréfaction, actuellement plutôt dans l’agglomération rouennaise.
On prend en considération tous les signalements de la même manière, on transmet tous les signalements anonymisés aux services de l’État concernés (DREAL, DDPP, etc), à l’exception des problèmes de voisinage que l’on essaie de régler en interne. Car si l’on ne traitait pas tous les signalements, les gens cesseraient d’en faire.
Minute internationale des odeurs, exposition, Olympiades des nez, colloque… Cette année, vous avez organisé de nombreux événements, pouvez-vous nous en dire plus ?
Véronique : Dans le cadre des 50 ans de l’association, on a eu envie de mettre en valeur tout ce qu’on faisait sur les odeurs avec les nez normands, car notre démarche est pionnière et semble assez unique au monde.
L’idée de la Minute internationale des odeurs est venue suite à une discussion avec l’écrivain Mathieu Simonet, auteur de la Journée internationale des nuages. L’idée est simple : le lundi 10 juin, à 10h06, chacun est invité à sortir de chez soi et à noter ce qu’il sent, avec le langage qu’il veut. Nous avons traduit le protocole en plusieurs langues, pour que ce soit vraiment international. Nous exposerons les réponses lors d’une exposition à Rouen cet été, qui traitera de l’odorat et de ses langages tout au long de notre histoire. Sept classes sont formées au Langage des nez à cette occasion, avec des résultats très positifs, qui font penser que l’éducation olfactive devrait être inscrite dans le programme scolaire.
Nous avons aussi organisé une olympiade, Les Nez d’or, en avril, au cours de laquelle différentes épreuves odorantes faisaient s’affronter des nez dans une ambiance conviviale ; ou encore une « rando-Nez », balade olfactive qui aura lieu le dimanche 16 juin dans le parc des Boucles de la Seine Normande, où petits et grands seront initiés au Langage des nez. Enfin, nous organisons une journée de colloque interdisciplinaire le mercredi 11 septembre au Pavillon des Transitions à Rouen, ouverte à toutes et tous.
Avec ces événements, nous souhaitons mettre un gros coup de projecteur sur la question de l’odorat. Jusqu’à présent, nous avons beaucoup travaillé sur les odeurs industrielles, les gênes, mais dans le dernier rapport de veille olfactive sur l’agglomération de Rouen,[5]Voir https://www.atmonormandie.fr/publications/bilan-de-la-veille-olfactive-realisee-par-les-nez-citoyens-de-la-metropole-rouen d’autres odeurs de la vie courante sont mises en avant : celles des fleurs, de l’herbe coupée, de la Seine… Nous avons envie de nous ouvrir à de nouvelles approches.
- Le site d’Atmo Normandie : https://www.atmonormandie.fr/
- Cliquez ici pour découvrir le programme des événements organisés par Atmo Normandie
Visuel principal : Véronique Delmas et Baptiste Delaunay
Notes
| ↑1 | Réseau d’Etude et d’Alarme pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique |
|---|---|
| ↑2 | Association de Lutte contre la Pollution Atmosphérique |
| ↑3 | Le Langage des nez est un modèle déposé. |
| ↑4 | https://www.signalair.eu/fr/ |
| ↑5 | Voir https://www.atmonormandie.fr/publications/bilan-de-la-veille-olfactive-realisee-par-les-nez-citoyens-de-la-metropole-rouen |


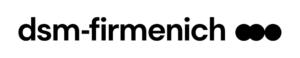

Commentaires