Si le goût et l’odorat ne font pas qu’un, ils sont intimement liés. À tel point que le premier n’existe plus si le second s’est enfui. Cuisiniers et mixologues jouent de cette symbiose pour satisfaire ou troubler nos sens. À l’occasion de la semaine du goût, nous vous proposons un article initialement paru dans Nez, la revue olfactive – #10 – Du nez à la bouche.
Chacun de nous a déjà expérimenté, à l’occasion d’un simple rhume, la perte du plaisir de manger. Pourquoi, lorsque notre nez est pris, la nourriture perd-elle toute sa saveur ? « C’est simple, ce qu’on appelle généralement le goût est en fait de l’odorat, au moins à 80 %, explique Roland Salesse, ex-ingénieur agronome à l’INRA (devenu l’Inrae). C’est lui qui apporte le relief et la finesse à ce que l’on mange. Essayez donc de déguster un plat en vous pinçant le nez ! »
Cet abus de langage est directement lié à l’usage inexact, et répandu, du mot « goût » en français. Le Petit Robert le définit comme le sens grâce auquel l’homme perçoit les saveurs propres aux aliments.
Même si historiquement sa classification a pu contenir l’onctueux, l’aigre ou l’astringent, le sec et l’humide, on a longtemps réduit le goût à quatre saveurs primaires : le salé (donné par le chlorure de sodium), le sucré (par le saccharose), l’amer et l’acide. Au cours des années 1980, on en a ajouté une cinquième, l’umami (la « saveur délicieuse ») – déjà mentionnée en 1908 par un chimiste japonais. Il s’agit d’une saveur apportée par deux acides aminés, le L-glutamate et le L-asparate, très présents dans la cuisine nippone (sauce de soja, miso, algues, thé vert) mais que l’on trouve également dans des produits aussi différents que le parmesan, la sardine, le champignon, la tomate ou le jambon cru !
Mais on emploie couramment le mot « goût » pour caractériser un arôme (de fraise, par exemple). « Notre bibliothèque d’odeurs est composée en très grande majorité d’arômes alimentaires, explique Roland Salesse, mais on ignore qu’elle est olfactive puisqu’on qualifie ceux-ci de “goûts”. Car notre cerveau stocke les images cérébrales “odeurs” et “goûts” dans des réseaux neuronaux différents. »
Afin de classer l’information dans le bon réseau, le nerf trijumeau va devoir détecter d’où provient le flux d’air qui se dirige vers l’épithélium olfactif : s’il est issu des narines, le cerveau interprète « odeur » ; si c’est du pharynx (on parle alors de voie rétronasale), il comprend « goût ». Mais ce nerf crânien, composé de neurones partant des yeux, du nez et de la gorge, ne se contente pas de jouer les guides spirituels : c’est lui aussi qui perçoit en bouche le piquant, le pétillant ou la fraîcheur d’un aliment. Les sensations trigéminales relèvent du toucher et sont perçues par les muqueuses buccales. Avec le goût et l’odorat, qui forment un couple fusionnel, le nerf trijumeau est le troisième larron d’une dégustation. Et un terme existe bien en français pour désigner l’ensemble des sensations qu’ils produisent à eux trois : le mot « flaveur ».
Clé et serrure
Le plaisir de manger commence ainsi par celui de percevoir le « nez » d’un mets, ces molécules volatiles qui planent au-dessus d’un plat et qui mettent l’eau à la bouche. Dès qu’on se met à mastiquer, l’odorat capte les parfums en bouche, par voie rétronasale, sans avoir besoin de les flairer. Odorat et goût sont les seuls de nos sens à être biochimiques : le premier est sensible aux molécules volatiles odorantes, le second aux molécules sapides solubles dans la salive. Lorsque l’un ou l’autre est sollicité, ni photons ni vibrations ne viennent tambouriner dans notre tête, mais un système de clé-serrure se met en place, entre les récepteurs olfactifs et gustatifs d’un côté, et les molécules aromatiques et sapides de l’autre. Lorsque la serrure s’active parce que la clé qui vient d’y entrer correspond à sa forme, le cerveau est alerté via une chaîne biochimique de transmission – une succession de réactions chimiques et de signaux électriques.
Le nez est capable de détecter 1 000 milliards d’odeurs. Rappelons que 2 % de nos gènes sont dévolus à la perception des senteurs, soit environ 400 gènes de récepteurs olfactifs, contre quatre seulement pour traiter la couleur. La découverte des récepteurs olfactifs a été couronnée par un prix Nobel en 2004. Quant aux cellules gustatives, plus d’un demi-million d’entre elles tapissent la langue, dans ce qu’on nomme les bourgeons du goût (environ 200 bourgeons par centimètre carré), abrités par les papilles. Ces bourgeons, dont la membrane porte les récepteurs gustatifs, contiennent chacun une centaine de cellules gustatives.
Faire saliver le cerveau
Ce qui se joue lors d’une dégustation n’est ainsi pas qu’une affaire de papilles, mais une expérience plus complexe, qui assemble trois messages différents : olfactif, gustatif et trigéminal. Si le duo nez-palais se singularise dans le ballet des sens, il ne joue pas sa partition isolé des autres. « Le goût est multisensoriel », insiste Roland Salesse. La bouche, la langue, le palais et même les dents sont sensibles au moelleux, au tendre, au visqueux, à la température d’un mets… L’ouïe est également sollicitée. Des études de Charles Spence, un psychologue de l’université britannique d’Oxford, ont montré que des chips peuvent paraître jusqu’à 15 % plus croustillantes si leur emballage produit lui-même un son délicieusement craquant au moment de l’ouverture. Quant à la vue, elle règne en majesté dans le plaisir de la dégustation. Ne commence-t-on pas à manger avec les yeux ? Variété des mets, jolies serviettes et assiettes colorées font saliver le cerveau. Au point qu’il est parfois trompé par ce qu’il croit voir : une étude de 2001 a montré que des œnologues peinaient à distinguer un vin rouge d’un blanc coloré en rouge, la teinte de ce dernier les orientant vers des termes habituellement employés pour décrire le nez d’un vin rouge même si les odeurs n’y correspondaient pas.
Manger, c’est donc mobiliser ses cinq sens, dont les perceptions s’influencent les unes les autres – avec toujours à la manœuvre le cerveau, grand reconstructeur de nos sensations devant l’éternel. « Pourquoi le monoï nous rappelle-t-il tant la plage, par exemple ? Parce que c’est là qu’on a enregistré son parfum pour la première fois », analyse Marlène Staiger. Cette Bourguignonne bonne vivante qui adore cuisiner s’est formée en aromatique alimentaire à l’Isipca, l’école de parfumerie de Versailles, avant de travailler avec le parfumeur Christophe Laudamiel pour l’OPhone de David Edwards, d’inventer des nuages de saveurs reprenant les notes du parfum Popeye de Jean Paul Gaultier, ou de jouer à masquer le goût d’un édulcorant, la stévia, pour une marque de boissons. Aujourd’hui, c’est une designer du goût réputée, qui intervient auprès des mixologues des plus grands bars de Paris. « Parfumeur et aromaticien ont 50 % de molécules en commun, c’est pas mal ! », juge-t-elle.
Marlène Staiger a choisi d’allier créativité et rigueur dans cette façon de formuler qui l’a toujours attirée : le liquide. Sous la marque H.Theoria, elle a imaginé des liqueurs composées comme des parfums, dans lesquelles il y a autant à boire qu’à (res)sentir. Formuler, dit-elle, c’est « trouver des points d’impact, construire un nez qui ait une puissance aromatique mais aussi un corps, quelque chose qui se tient en bouche, moins éphémère et volatil qu’un parfum ». Elle aime ainsi créer des « entrechocs entre le nez et la bouche », rechercher un équilibre olfactif ténu au palais. Elle peut pour cela jouer avec des dimensions étrangères aux parfumeurs : la sucrosité, l’acidulé, l’amertume, mais aussi la texture, qui vient enrichir et préciser l’olfaction directe. Certaines notes lui semblent « lumineuses », d’autres « colériques », « bleues », voire « nostalgiques » : « des arômes moins joviaux, plus graves, comme la câpre, l’aigre-doux, l’umami… » Elle ne souhaite pas associer sa dégustation à un jeu ou y voir un aspect éducatif, l’alcool devant se déguster avec modération. Il s’agit plutôt, conseille-t-elle, de laisser « vaquer ses sensations et son imaginaire ».
Roquefort, brocolis ou endive
Un imaginaire qui remonte loin dans la vie d’un être humain. « La construction de la personnalité multisensorielle d’un individu commence dès la vie intrautérine », explique Roland Salesse. Par réflexe, le cerveau du bébé raffole du sucre, se montre indifférent au salé et grimace devant l’amer – aversion sans doute inscrite dans nos gènes comme une caractéristique de survie pour l’espèce, les composés les plus toxiques, comme la ciguë, étant souvent les plus amers.
Mais, pour le reste, tout est à construire. Et semble se jouer avant l’âge de raison : des études menées par les experts du Centre des sciences du goût et de l’alimentation de Dijon ont montré que les préférences gustatives d’un enfant de 7 ans dépendaient directement de la diversité alimentaire qu’il avait connue (ou non) avant son premier anniversaire. Pendant cette période, en effet, le bambin peut se montrer friand de nombreux aliments réputés « difficiles », comme le roquefort, le brocolis ou l’endive. Seule une exposition progressive, ludique et répétée peut porter ses fruits. Être patient tout en sachant faire vite. Car à partir de 18 mois, c’est trop tard : l’enfant entre alors dans une période où il rejette systématiquement les aliments qu’il ne connaît pas, parfois même ceux qu’il aimait avant. « Comme si, en devenant plus autonome dans sa façon de se nourrir, il devait apprendre à se méfier davantage de l’inconnu », explique Roland Salesse.
Le chercheur est à l’initiative de nombreux projets d’éducation au goût menés par l’association Nez en herbe avec les crèches Cap Enfants et dans des écoles maternelles : présenter aux enfants, dans des boules à thé, des épices qu’ils sont invités à sentir ; leur faire découvrir un univers grâce à des odeurs (le cirque avec la barbe à papa, par exemple) ou un territoire à travers de la musique, des animaux, des plantes, mais aussi des senteurs et des aliments – la vanille pour Madagascar, le fish and chips pour la Grande-Bretagne, le camembert pour la Normandie… Le but de cette démarche ? « Faire prendre conscience aux tout-petits qu’ils possèdent un nez et qu’ils peuvent s’en servir dans la vie de tous les jours », explique Roland Salesse. D’autant qu’avant l’âge de 2 ans ils ne rejettent pas systématiquement les odeurs et les arômes jugés mauvais par les plus grands. « Cela change vers 4-5 ans. »
Pour poursuivre ou parfaire l’initiation, « il est important d’être curieux », souligne Marlène Staiger : « Plonger le nez dans le basilic, goûter le jus d’une orange et le comparer à la saveur d’un zeste, tester différentes épices… Sentir, goûter, c’est la base pour s’initier. Et la pluralité des expériences culinaires multiplie les mémoires. Plus on pratique, plus le goût s’ancre. » Découvrir les cuisines du monde est aussi une façon de prendre conscience que le plaisir ressenti devant un aliment ou un plat relève bien souvent de l’histoire familiale et culturelle. « Toute odeur aimée est le centre d’une intimité », écrivait le philosophe Gaston Bachelard. Tout comme l’arôme aimé, tant il est lié à la sensibilité de chacun, à ses émotions, son histoire familiale, sa culture, autant qu’à un mécanisme physiologique. Pas de saveurs favorites universelles, donc, mais la promesse de mille découvertes culinaires encore à venir.
Cet article est initialement paru dans Nez, la revue olfactive – #10 – Du nez à la bouche.
Visuel principal : © Antoine Cossé






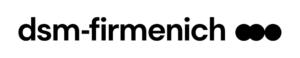

Commentaires