Sans sa tasse de thé (bon, d’accord, de tisane), la madeleine proustienne n’eût pas vu le jour. Cette boisson millénaire, répartie à travers le globe et le temps, imprégnée de multiples cultures et d’histoire, connaît depuis quelque temps un regain d’intérêt dans le monde du parfum. Son influence sur la création olfactive ne date cependant pas d’hier : elle a même orienté notre rapport aux flacons.
Explications avec Jeremy Tamen, ethnobotaniste, sourceur et évaluateur de thé, enseignant en Arômes et gustation à l’Ecole supérieure du parfum, et Jean-Christophe Hérault, VP parfumeur chez IFF, notamment auteur de Poudre matcha pour Kenzo.
Une brève histoire du thé
Tous les thés que nous buvons sont issus d’une même plante originelle : Camellia sinensis, un arbuste de la famille des Théacées. Originaire de Chine du sud-ouest, dans les montagnes du Yunnan, il aurait côtoyé une variété sauvage poussant à Assam, Camellia assamica. Si sa consommation est aujourd’hui répandue – on parle en effet de la deuxième boisson la plus consommée au monde, après l’eau – elle est, dans son pays d’origine, « un élément fondamental de la culture philosophique et religieuse », pour citer Jean Vitaux.[1]Jean Vitaux, « Le thé », dans : , La mondialisation à table, sous la direction de Jean Vitaux, Paris Presses Universitaires de France, « Hors collection », 2009. Les premières graines de thé ont été retrouvées dans la tombe du marquis Yi de Zeng, en 433. Mais la première mention de sa culture date de 59 av. JC, dans une commande d’un maître à ses esclaves, souligne l’archéologue Jean-Paul Desroches. Il fait d’abord partie de la pharmacopée locale, puis devient un élément essentiel – sous forme de soupe épaisse bouillie mêlée à d’autres ingrédients, notamment des épices – des cérémonies bouddhistes à partir du VIe siècle, car il permet de rester éveillé lors des longues liturgies. Dès 730, « on parle déjà de 30000 cueilleuses de thé », note ainsi le chercheur.[2]Jean-Paul Desroches, « Archéologie du thé », Le Salon noir, France Culture, 3 octobre 2012 Après le thé bouilli, c’est le thé battu – le désormais tendance matcha – que l’on prépare sous les Song au Japon.
Importé en Angleterre par les Néerlandais dès 1653, il deviendra rapidement un élément culturel autour du « five o’clock tea », sa version aromatisée à la bergamote étant popularisée par le Premier ministre britannique Charles Grey dans les années 1830. En France, l’attrait est plus récent : s’il est présent depuis le XVIIe siècle, c’est seulement à partir de la seconde moitié du XXe siècle qu’il devient plus largement consommé.
La production mondiale s’élevait à 6,7 millions de tonnes en 2022, fournie pour moitié par la Chine, pays le plus productif, suivie de l’Inde (20%), le Kenya et Sri Lanka.[3]Toutes ces données sont issues du rapport de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’ONU de Janvier 2024 Le réchauffement climatique touche de plein fouet les producteurs dont les rendements sont en baisse, et si la consommation est globalement en hausse, elle a diminué en Europe et aux Etats-Unis en raison de la concurrence des boissons gazeuses, du café mais aussi de la guerre en Ukraine.[4]Voir https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/06/24/en-chine-la-production-de-the-affectee-par-les-fortes-chaleurs_6179072_3244.html
Les familles de thé : couleurs, odeurs et textures
C’est toujours Camellia sinensis qui est à l’origine de nos différents thés, qu’il s’agisse de thé vert au jasmin, du matcha ou du Earl grey anglais. Mais comment expliquer une telle diversité de couleurs, d’odeurs et de textures ? « On compte aujourd’hui 250 à 300 variétés naturelles de ce camélia, et plus de 3000 cultivars – l’équivalent de cépages. Ce qui permet de distinguer les six grandes familles de thé, c’est leur méthode de transformation et ainsi notamment l’oxydation de la feuille ; même si, selon le transformateur, le profil peut être très différent », explique Jeremy Tamen.
Faisons fi un instant de ce qui fait pourtant toute la spécificité de chaque thé : ses détails propres, les nuances qui le distinguent des autres rejetons d’une même famille. Dressons-en une cartographie générale, certes imparfaite, mais bien pratique pour les classer dans un premier temps.
Les thés blancs et verts ne sont pas oxydés. Le thé blanc, qui tient sa spécificité de ce qu’il est constitué principalement de jeunes pousses et de bourgeons de l’arbuste, est assez discret : « On y trouve des notes zestées, fruitées – osmanthus, fruit jaune mais sans le côté lacté –, florales peu entêtantes – celles d’une fleur d’oranger au petit matin, du chèvrefeuille –, avec parfois un fond plus soutenu, menthé ou évoquant le patchouli », énumère le spécialiste.
Pour le thé vert, les feuilles qui sont cueillies sont flétries, malaxées, puis chauffées afin qu’elles ne s’oxydent pas. « On retrouve des notes florales et d’agrumes, mais aussi quelque chose de plus végétal, au nez de courgette, de petit pois, voire de châtaigne cuite, de fruits à coque, de foin… » Le thés verts japonais se distinguent cependant du lot par « leur attaque beaucoup plus marine et iodée, comme la chair de crustacé. Le matcha, quant à lui, rappelle souvent le chocolat blanc, le rhizome d’iris, la prune et l’épinard. »
Moins courants, les thés jaunes ne sont pas non plus oxydés, mais « ils subissent une post-fermentation pendant vingt-quatre heures dans des ballotins de lin, ce qui leur confère des saveurs caractéristiques de cette plante, évoquant le coton humide, l’osier, le rotin, la chair de châtaigne ».
Vient ensuite la catégorie des thés semi-oxydés : les oolongs. Pour ceux-ci, Jeremy Tamen relève leur volubilité remarquable, qui offre une porte d’entrée facile dans le monde du thé : « Ceux qui sont faiblement oxydés se rapprochent du thé vert, avec ce côté fleurs blanches : chèvrefeuille, magnolia… D’autres, plus oxydés, révèlent des notes de lilas, géranium, de zeste de kumquat, voire menthées, avec un fond boisé presque santalé ou cédré. J’ai à l’esprit un oolong taïwanais de 1500 mètres d’altitude, ultra floral, qui m’a vraiment fait penser à En passant d’Olivia Giacobetti pour Les Éditions de parfum Frédéric Malle. »
Quant aux thés noirs, totalement oxydés, « leurs profils tournent plutôt autour de notes chocolatées, maltées, de fruits jaunes, de bois de réglisse, cèdre, vétiver – santalés pour certains, avec un bouquet floral opulent ».
Les pu erh, enfin : ceux-ci, fermentés, renvoient souvent aux senteurs de sous-bois, « avec des inflexions de champignon, de mousse de chêne, de laurier ; des saveurs camphrées et tourbées, animales et pour certains quelque chose proche du miso. »
Il y a ainsi de quoi trouver dans les thés une source d’inspiration quasiment illimitée. Et ce d’autant plus que la boisson ne se réduit pas à ses arômes : son ancrage culturel diversifié, son histoire, la mise en lumière de la culture de la plante, mais aussi la pluralité de l’approche sensorielle lors de la dégustation constituent autant de points d’accroche à la créativité. Lorsqu’il déguste un thé, Jeremy Tamen juge ainsi « d’abord de l’aspect des feuilles : leur couleur, de l’ébène au doré en passant par toutes les nuances du vert ; leur texture, parfois tannée lorsqu’ils sont chauffés au wok. Puis on sent les feuilles sèches, qui délivrent des arômes qu’on ne trouve pas forcément à la tasse. On les dépose ensuite dans le gaiwan chauffé, pour que la vapeur les imprègne : elle donne une première esquisse du thé. Lorsqu’on ajoute l’eau, on est aussi sensible à la danse des feuilles, à leur redéploiement dans la tasse et aux tanins qui se diffusent peu à peu. On sent ensuite deux choses : l’infusion, c’est-à-dire les feuilles imbibées d’eau, puis la liqueur, notre boisson finale. La majorité du ressenti se fait en olfaction directe et en rétro-olfaction. »
Et, outre ces thés natures déjà infiniment variés, il y a les thés aromatisés, du classique thé à la menthe marocain, en passant par le chaï indien et le thé au jasmin, avec les mille nuances que peuvent apporter ceux qui les créent. « Certes, il s’agit en majorité de grandes sociétés qui proposent des catalogues entiers, avec des bases de thé souvent médiocres. En tant qu’artisans indépendants, on se compte sur les doigts de la main. Mais en utilisant des ingrédients de qualité, on peut proposer de très belles choses. J’aime cet exercice qui permet d’imaginer de vrais accords, comme en parfumerie ! »
Interpréter le thé
Et cette inspiration est réciproque, comme le note Jean-Christophe Hérault : « C’est un thème très fédérateur, qui a la particularité d’offrir une infinité de variations. On peut en proposer une interprétation fraîche, ou bien plus réconfortante en le mariant à des facettes musquées, santalées… Mais il peut aussi être racé, dans un registre boisé, voire fumé. »
Pour en reconstituer l’odeur, il existe une extraction CO₂ de thé noir, ou encore une absolue de thé, mais la matière la plus utilisée est l’absolue de maté, qui sent « la feuille sèche, avec à la fois un pôle très vert rappelant l’herbe coupée, mais aussi un aspect foin coumariné », précise le parfumeur. Cependant, si ces matières permettent d’entrer dans la note, pour obtenir un résultat complexe, il faut faire appel à d’autres ingrédients de la palette. Parmi eux, « l’extrait de bois de Gaïac, fumé ; la fève tonka, aux inflexions de feuille sèche, de flouve ; la sauge sclarée, qui donne un côté feuille froissée… Dans les molécules de synthèse, on pense au linalol, à l’acétate de linalyle, au géraniol, à la damascénone, au cis-3-hexénol pour sa verdeur, à l’hexénal, ou encore à l’ionone béta évoquant l’aspect feuille sèche du thé. Mais tout dépend du thé auquel on pense. Pour le matcha, on peut utiliser l’absolue de feuille de violette, qui apporte une tonalité verte naturelle, et qui n’est pas sans rappeler l’épinard ; on peut jouer avec la bergamote, qui a des facettes thé et qui entre dans la composition du Earl Grey. Si on imagine un Darjeeling, on partira plutôt sur des tonalités florales de freesia, légèrement jasminées, avec de l’Hédione. Les possibilités sont infinies ! »
La verdeur des débuts
Cependant, l’accord thé s’est d’abord conjugué au singulier : c’est l’Eau parfumée au thé vert chez Bulgari qui, en 1992, a donné le coup d’envoi de la note : bergamote, notes rosées, ionones et Hédione renvoient à l’imaginaire de fraîcheur florale d’une bonne tasse de Darjeeling, dans une interprétation toutefois plus personnelle que littérale, signée du minimalisme cher à Jean-Claude Ellena. Cela n’empêche pas à l’accord de faire mouche. On le retrouve dans Déclaration de Cartier, du même parfumeur, en 1998. L’année 1999 est particulièrement prolifique en la matière, avec Aroma Tonic de Lancôme, Green Tea d’Elizabeth Arden, et Thé Vert (Green Tea) de L’Occitane, Aqua Allegoria Herba Fresca de Guerlain, ou encore Thé Vert de Roger & Gallet. Comme une traînée de poudre, il se répand aussi dans les produits parfumés, du déodorant au parfum d’ambiance.
Et de dessiner de nouvelles lignes dans les tendances de l’époque, comme le relève Jean-Christophe Hérault, la mise sur le marché de CK One en 1994 : « Ce parfum est l’une des premières créations mixtes : il a ouvert la voie aux “gender-fluid” d’aujourd’hui. L’accord thé qui sert de point de départ, inspiré du Bulgari, a permis de remettre les eaux fraîches sur le devant de la scène, en réinterprétant la cologne, qui était alors perçue comme datée, rappelant des gestuelles de nos grand-parents. »
D’autres proposent cependant une approche différente : on citera notamment le plus fumé Bulgari Black imaginé par Annick Ménardo en 1998. La même année sort également Le Feu d’Issey de Jacques Cavallier, qui évoque le chaï latte, avec ses notes épicées infusées dans un lait chaud et boisé. Chez L’Artisan parfumeur, Olivia Giacobetti propose le naturaliste Thé pour un été en 1995, puis Tea For Two en 2000, où l’on perçoit son écriture vaporeuse. Bulgari poursuit son exploration avec L’Eau parfumée au thé blanc en 2003. Loin de l’aspect propre et sage qui marque ses débuts, la note est interprétée la même année par un Marc-Antoine Corticchiato rêvant de samovars et de lampées de vodka dans Ambre russe, pour sa marque Parfums d’empire. On peut également penser à Duel, chez Goutal, aux nuances de foin et de maté, qui voit le jour au même moment.
Les années 2010 voient la tendance monter en puissance. Fumé et vanillé dans la sublime La Treizième Heure de Cartier ou version maté sauvage et renversante de beauté dans L’Heure fougueuse (merci Mathilde Laurent), aromatisé au jasmin dans Impérial Tea de By Kilian en 2014, elle poursuit sa route dans L’Île au thé d’Annick Goutal, en passant par le Thé noir 29 et sa figue bien trempée chez Le Labo, ou encore les deux nouvelles Eaux parfumées au thé bleu et au thé noir chez Bulgari, tous lancés en 2015. Certaines marques, comme Jo Malone, leur consacrent toute une gamme (« Tea collection » en 2011, puis « Rare Teas » en 2016).
Les années 2020, du thé pour tous les goûts
Si bien des thés ont vu le jour dans nos flacons avant notre décennie, ce qui fait la particularité des dernières années est d’avoir exploré de nouvelles facettes du breuvage.
On retrouve toujours le thé vert, qui semble être l’un des favoris quand il s’agit de parfum : que l’on Rêve de thé chez Nuxe, que l’on exige Encore du temps pour Meo Fusciuni, que l’on s’habille du Kimono vert d’Art de parfum ou que l’on déguste le Gyokuro de The Merchant of Venice, on le déniche partout !

Mais le thé devient véritable terrain de jeu : Patrice Revillard explore ainsi le genmaicha, avec ses notes de riz toasté addictives, dans Je ne sais quoi chez Teo Cabanel. Au même moment se confirme la tendance matcha (à laquelle nous avons consacré un article dans Nez#17 – Argent & parfum), qui fait fureur chez les foodies – et s’invite donc dans nos flacons : coup d’envoi avec Ukiyo-E chez Gri Gri Parfums, l’une des marque d’Anaïs Biguine, en 2017, puis avec 4711 Acqua Colonia Matcha & Frangipani signé Mathieu Nardin ; succès de Matcha Meditation de la Maison Margiela dès 2021, par Maurice Roucel et Alexandra Carlin avec ses facettes lactées réconfortantes, ou encore figuratif Thé matcha 26 du Labo, il s’incarne aussi dans le très beau Poudre matcha de Kenzo sorti en 2022. Jean-Christophe Hérault explique avoir « travaillé une verdeur fraîche, avec des notes hespéridées et même une amertume qui rappelle le pamplemousse. Pour l’umami, j’ai joué avec les muscs, les notes santalées et vanillées pour donner une texture, apporter quelque chose de rassurant, qui reprenne l’idée du délicieux. » Cette collection Memori a donné lieu à d’autres très belles créations autour du thé, comme Soleil thé, musqué et poudré.

Suivront Un Été d’Obvious, par Meabh Mc Curtin, avec ses facettes estivales d’ambre solaire, ou encore la fraîcheur verte de Current Culture (Claude Dir) chez Roan, marque récemment lancée qui consacre ses trois premières créations à la boisson avec Porcelain Pulse, le Darjeeling selon Gino Percontino, et Mountain Memories, un oolong signé Ugo Charron.

Parmi les oolong, on ne peut pas ne pas citer Hongkong Oolong, première création de notre collection 1+1 (aujourd’hui épuisé), qui réunit en 2019 Maurice Roucel et le designer hongkongais Alan Chan, autour d’une tasse musquée, épicée, florale et lactée. Sa douceur est également interprétée par la parfumeuse indépendante Isabelle Larignon avec Milky Dragon, dans une danse de foin vaporeuse, ozonique, complexe mais parfaitement confortable. C’est aussi ce thé qu’a choisi d’interpréter Olivier Cresp pour sa marque Akro, avec Infuse, tout juste mis sur le marché : avec ses fleurs blanches charnues et ses épices fusantes, il oscille entre milky oolong, ce thé aux notes beurrées et lactoniques, et chaï puissant et boisé.

Cette spécialité indienne a d’ailleurs été la source d’inspiration de Margaux Le Paih Guérin dans Dinajpur pour la marque Coelia, qui en propose une version à la fois grillée, épicée et crémeuse, entre thé et café. On pense aussi à Tchai d’Hima Jomo, une ode au Darjeeling qui s’épice de cardamome et s’habille de notes florales.

Le thé noir s’invite également dans nos flacons, avec Dandy or not G.A. (Sidonie Lancesseur) lancé en 2022 par D’Orsay, Bleu nuit d’Amélie Bourgeois chez Couleurs et sa figue cédrée ; ou encore les plus fumés Tea & Rock’n Roll proposé par Voyages Imaginaires, la marque de parfums naturels d’Isabelle Doyen et Camille Goutal ; le « remix » Souchong Journey de Suzy Le Helley pour Edit(h) ; le très bel Indigo Smoke d’Arquiste et ses notes goudronnées offertes par Calice Becker ; ou encore Smoky Soul de Marc-Antoine Corticchiato pour Olfactive Studio, une tasse fumée infusée d’absolue d’osmanthus qui a séduit la rédaction en 2023.

La tasse de thé des parfumeurs
Le dialogue se fait aussi en sens inverse, et quelques marques de parfum imaginent une collection de breuvages. C’est le cas de Teo Cabanel, qui a lancé un genmaicha twisté de notes plus florales et légèrement fruitées, inspiré de Je ne sais quoi [voir plus haut] ; mais aussi Café Cabanel, d’après l’un des best-sellers de la marque, qui offre une tasse de caramel toasté, aux inflexions de cacao et de vanille ; et Encore, un oolong gourmand et complexe qui s’inspire du carrot cake, à l’image du parfum homonyme sorti en 2023.

Byredo a également récemment lancé une collection de thés « construits comme des parfums », sans toutefois établir de correspondance directe entre breuvage et flacons.
Mais c’est certainement la marque State of Mind, fondée en 2017, qui a le plus poussé ce dialogue entre thé et parfums en imaginant un concept de « salon de thé olfactif », situé au cœur de Versailles. Le dégustateur Olivier Scala y crée des thés comme l’on imagine des fragrances, la parfumeuse Karine Dubreuil Sereni travaille les compositions qui en reprennent les noms en écho synesthète. Ainsi, Aesthetic Turbulence est à la fois un breuvage goûtant l’immortelle et le poivre rouge sur une base d’oolong et de perles de jasmin, et un parfum où la petite fleur jaune de nos plages, avec ses atours épicée et liquoreux, réchauffe un accord thé vert floral ; Modern Nomad se décline en tasse de pu erh hojicha grillé et Yunnan noir adoucie de vanille et de rose et une vaporisation puissante à la fois fumée, cuirée et ambrée ; Open Mind reprend les notes iodées, fraîches et vertes d’un Gyokuro japonais… Bref, que l’on cherche de beaux mélanges ou des accords thé pour s’en habiller, il y a de quoi faire.

Et de quoi nous laisser penser que l’histoire qui mêle ces deux univers n’a pas fini de faire parler d’elle ! Et vous, quelle tasse de thé aimeriez-vous sentir ces prochaines années ?
Notes
| ↑1 | Jean Vitaux, « Le thé », dans : , La mondialisation à table, sous la direction de Jean Vitaux, Paris Presses Universitaires de France, « Hors collection », 2009. |
|---|---|
| ↑2 | Jean-Paul Desroches, « Archéologie du thé », Le Salon noir, France Culture, 3 octobre 2012 |
| ↑3 | Toutes ces données sont issues du rapport de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’ONU de Janvier 2024 |
| ↑4 | Voir https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/06/24/en-chine-la-production-de-the-affectee-par-les-fortes-chaleurs_6179072_3244.html |




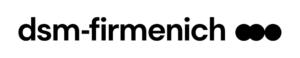

Commentaires