Cette publication est également disponible en :
English
À l’occasion de la Journée mondiale de l’art ce 15 avril 2022, Nez vous propose de (re)découvrir un article sur la question du parfum comme œuvre de l’esprit, initialement publié dans Nez, la revue olfactive #04.
En France, le droit positif ne reconnaît pas le parfum comme œuvre de l’esprit du point de vue de la création. Qu’en est-il selon une perspective philosophique ? Quelles destinations esthétiques vise cette œuvre immatérielle et volatile ?
Dans Langages de l’art, une approche de la théorie des symboles (1990), édition française d’un ouvrage publié en 1968 au fil duquel Nelson Goodman aborde l’œuvre d’art comme un signe au fonctionnement spécifique, le philosophe américain distingue « les arts autographiques » (peinture, sculpture), qui créent des œuvres uniques, des « arts allographiques » (musique ou art dramatique), propres à créer des œuvres multiples et dont l’avènement est conditionné par l’écriture d’une notation spécifique. Précisément, il indique : « Une différence notable entre la peinture et la musique est que le compositeur a fini son travail lorsqu’il a écrit la partition, même si ce sont les exécutions qui sont les produits terminaux, tandis que le peintre doit achever le tableau. Peu importe le nombre des études ou des révisions faites dans l’un ou l’autre cas, la peinture est de ce point de vue un art à une phase et la musique un art à deux phases ». De façon similaire, comme le morceau musical, le parfum n’est pas un objet unique, non reproductible ; il est même voué, au contraire, à être reproduit. Il obéirait par conséquent au régime allographique des arts à deux phases.
L’art de la formule
Le terme allographique vient du grec : il est composé du préfixe allo (de allos [autre]) et de la racine du verbe graphein [écrire]. Dès lors, il s’oppose à la désignation autographique, qui se rapporte à la peinture, la sculpture, et à tous les cas où les œuvres sont directement réalisées par l’artiste, en exemplaire unique. Dans les arts allographiques, la réalisation de l’œuvre se fait par l’intermédiaire d’un document écrit, qui n’est pas l’œuvre en soi, – l’identité de l’œuvre étant garantie à la condition qu’on en reproduise rigoureusement la notation. Selon Goodman, tout exemplaire issu de la notation sera reconnu comme un exemplaire correct. En musique, cette notation est partition, en théâtre, elle est texte, en architecture, elle est plan, et en parfumerie, elle est formule. Car, oui, le parfum naît d’une formule, document intermédiaire entre la volonté du parfumeur– sa visée mentale – et sa matérialisation. La formule rappelle la proximité entre la pharmacie et la parfumerie, il s’agit précisément de la liste exhaustive des composants du parfum. Comme la partition, elle est indication, mais en tant que telle, ne contient pas de consigne d’exécution, tandis que la recette en contient. Une formule ne dit que le nom des ingrédients – plus, quand ils sont naturels, leur qualité (absolue ou essence) et leur origine (vétiver de Haïti ou de Java, par exemple) et leur proportion.
Initialement, le parfum se réalisait en suivant une recette qui donnait, en plus des ingrédients nécessaires, leur mode d’élaboration avant incorporation dans la préparation odorante. Les recettes de Simon Barbe (célèbre parfumeur parisien du Grand Siècle) détaillées dans un traité destiné aux gens du métier, Le Parfumeur royal (1699), en sont un exemple : les mentions « faites bouillir », « laissez infuser »… y sont nombreuses.
On donne aussi au parfumeur les instructions pour réaliser ses propres distillations. Pour exemple, L’Eau de gerofle [girofle], dite d’Œillet : « Vous pilerez dans le mortier quatre onces de clou de gerofle, & vous les mettrez infuser dans quatre pintes d’eau un peu tiède pendant trois ou quatre heures dans l’alambic au refrigeratoire ; ensuite vous l’exposerez sur le fourneau, fournissant d’eau fraîche au refrigeratoire ; l’eau qui en proviendra sera d’une odeur si adoucie, qu’elle approchera plus de l’œillet que du gerofle. C’est ainsi qu’on fait l’eau d’œillet, car l’œillet n’a pas assez de qualité pour produire de l’eau. »
Selon l’historienne Eugénie Briot, « c’est à la fin du XIXe siècle que les recettes sont devenues formules, quand les parfumeurs ont eu accès aux matières premières à incorporer directement dans le mélange alcoolique. » Inutile dès lors de dire aux parfumeurs comment obtenir d’une plante son huile. Les matières se présentaient prêtes à l’emploi.
Identité et notation
Plus la recette se précise, comble les blancs et devient formule, plus la part d’interprétation de la phase d’exécution de cette formule est réduite. Sa notation conditionne donc entièrement l’identité du parfum. Et d’un point de vue théorique, tout écart à cette formule, qu’il s’agisse du remplacement d’un ingrédient (restrictions toxicologiques ou environnementales obligent), ou d’une copie du parfum qui se ferait au nez, devrait donner un autre objet. Le débat est alors celui du bateau de Délos. Un bateau dont on a changé toutes les pièces au fur et à mesure, reste-t-il le même, bien que la forme générale soit maintenue ? Au puriste goodmanien, s’oppose ici le théoricien gestaltiste, théoricien qui s’intéresse non à la rigueur d’exécution de la notation, mais à la forme perçue comme un tout. C’est le point de vue déjà défendu par Edmond Roudnitska dans L’Intimité du parfum (1974), ouvrage coécrit avec Odile Moréno et René Bourdon. « Nos formules ne peuvent être divulguées. Mais le pourraient-elles que les femmes ne seraient pas plus renseignées pour autant même si la formule était rédigée en clair. Car si je vous énonce tous les constituants de mon parfum, je ne vous aurai encore rien décrit de sa forme. Par plus que je n’aurai décrit telle sonate en disant qu’elle est composée de do ré mi fa sol la si […]. Ce qui importe c’est l’arrangement de tous ces composants. » On bascule vers une esthétique de la réception qui privilégie non pas les règles d’élaboration (exactitude de la formule) mais le résultat final, y compris les mécanismes cognitifs et émotionnels d’accueil de l’œuvre. Le point de vue est celui de la reconnaissance d’une entité – forme de perception –, comme on reconnaît le thème des Quatre saisons sur une attente téléphonique, même si une note est fausse, et le tempo modifié.
Le régime du secret
Pour recomposer un parfum : deux voies. La première consiste à reproduire la formule (on obtiendra un exemplaire correct) ; la seconde, en l’absence de formule, consiste à reproduire la forme sentie (ici, on fonctionne sur le mode de l’approximation). Du point de vue de la protection du parfum, parce qu’on peut difficilement empêcher la seconde voie, la parfumerie a préféré ne pas faciliter la copie et opté pour le régime du secret quant aux formules.
Pendant longtemps, parfums et remèdes d’apothicaire étaient associés, partageant les mêmes précurseurs botaniques. Mais le choix s’est fait au début du XIXe siècle. « Le 18 août 1810, un décret impérial officialise la séparation de la parfumerie et de la pharmacie » rappelle Annick Le Guérer, dans Le Parfum, des origines à nos jours (2005). Pour protéger les consommateurs des charlatans, Napoléon impose que les formules d’apothicaires soient révélées, tandis que la parfumerie n’y est pas obligée. Dès lors, d’un parfum dont on tairait la formule, on ne peut plus vanter les pouvoirs curatifs (ni inciter à le boire). Après l’ère thérapeutique, on entre dans l’ère ornementale. La formule reste alors la propriété exclusive du parfumeur. Aujourd’hui, le modèle a un peu évolué, en raison du passage à l’échelle industrielle. Hormis de rares cas où les marques ont leur parfumeur attitré (Chanel, Cartier et Hermès, notamment), les marques font appel à des parfumeurs extérieurs, salariés de sociétés de composition (IFF, Firmenich, Givaudan, etc.), pour créer les parfums. La formule n’est jamais communiquée à ces marques, elle reste aux mains de la société de composition qui vend aux enseignes le concentré parfumé. Aux marques ensuite de le diluer dans de l’alcool et de le mettre en flacon. Arrivée à épuisement des stocks, la marque recommandera à la société de composition le volume de concentré nécessaire. Et même si le parfumeur change de société de composition, c’est la société d’origine qui continue la production du concentré. Le parfumeur, en quelque sorte, cède l’autorité de sa formule à la société qui l’emploie.
Toutefois, avec le perfectionnement dans les années 1980 des instruments d’analyse reposant sur les techniques de chromatographie sur phase gazeuse, nécessairement secondées par un parfumeur aguerri, il devient de plus en plus facile de déterminer a posteriori la composition d’un parfum et par conséquent, de l’imiter. Dans ce cas, puisque le parfum n’est pas protégé par le droit d’auteur, ce sont les lois commerciales qui s’imposent.
L’affaire des contretypes
Il existe un grand éventail de contretypes : depuis le souk où le client achète, en toute connaissance de cause, une imitation du produit dépourvu de packaging, aux copies plus sophistiquées, vendues sur le marché sous d’autres noms, sous d’autres marques. Dans ce dernier cas, à défaut de droit d’auteur, le droit peut ici être saisi sur le principe d’une concurrence déloyale, voire de parasitisme, et ce sont les tribunaux de commerce qui sont concernés.
Parmi les affaires célèbres, l’affaire Thierry Mugler contre Molinard. Le 24 septembre 1999, le tribunal de commerce de Paris reconnaissait à la fois l’originalité du parfum Angel, mais aussi le parasitisme et la concurrence déloyale à laquelle se livrait la société Molinard à travers la commercialisation de Nirmala (parfum créé en 1955, mais reformulé ultérieurement). Lors, la grande majorité des mille consommatrices choisies pour juger de la conformité des deux parfums ne put relever de détails discriminants entre les deux compositions, l’absence de dissemblance entre les deux parfums étant d’autant plus dommageable pour la défense que, comme l’a montré Egon Peter Köster dans « The Specic Characteristics of the Sense of Smell » (Olfaction, Taste and Cognition, 2002), l’olfaction discrimine les qualités plus facilement qu’elle ne repère les identités. Or, la contrefaçon en général est évaluée en fonction des ressemblances et non des différences. Dans ce cas, les divergences de formes invoquées n’étant pas perceptibles, on a pu considérer que les formes olfactives étaient synonymes et que Nirmala était une réplique du parfum Angel. À la suite du jugement, Molinard a été contraint de modifier sa formule. Les poursuites de ce genre restent néanmoins très isolées, et il est de nombreux cas où les tribunaux ne sont pas mobilisés.
Un même nom, diverses formes olfactives
Dans un article publié en 2011 par le journal Le Monde (« Le Groupe LVMH se réapproprie la fabrication de ses parfums », 27 mai 2011), Nicole Vulser indiquait déjà que, à la faveur de reformulations par le groupe LVMH, consécutives à l’arrivée d’un parfumeur maison, la paternité d’un certain nombre de parfums phares du groupe ne pouvait plus être revendiquée par les sociétés de composition à l’origine de leur création. Les formes olfactives générales, si elles sont préservées, pour ne pas dérouter le consommateur, n’obéissent plus à une exactitude de formule initiale. Pour preuve : l’absence, dans certaines compositions de molécules captives, des composés réservés à l’usage exclusif des sociétés de composition qui les ont produits et qui se comportent comme de véritables traceurs de production.
Mais ici, pas de procédure engagée, s’attaquer au géant, c’est commercialement se tirer une balle dans le pied. Depuis longtemps, la parfumerie reposant sur un principe de Gentleman’s agreement, qui privilégie l’intérêt commercial à la justice du législateur, le compromis est préférable à la publicisation.
Il en résulte que, sous un même nom, ont été commercialisés des parfums différents. On voit donc ici illustré que, finalement, un parfum n’est pas seulement une matière olfactive. Il est également fait d’un flacon, d’un packaging et surtout d’un nom dont la permanence garantit l’identité de l’œuvre, et favorise le contexte de réception du parfum. C’est en somme dans l’hétérogénéité des matériaux (olfactifs, sémantiques, visuels) que se joue la spécificité du parfum.
Un art hybride et hétérogène
Métis, le parfum est un art à la fois décoratif, à usage ornemental, et contemplatif. On distinguera ainsi le parfum qui s’arrête à la mouillette – première étape distante, dans le cas d’un parfum évalué par un expert, par exemple –, du parfum qui signe la peau et rentre dans l’intimité d’un individu qui le porte. Et dès lors, on entrevoit que le parfum peut prétendre, dans sa réalisation, à une troisième phase, celle de la diffusion qui ne peut se passer de support, mais dont la nature même du support change l’attention esthétique. En effet, mon attention aux détails du parfum ne sera pas la même selon que j’ai le nez sur la mouillette, ou que je sens le sillage d’une personne rencontrée. D’un côté je perçois une évolution, je discrimine des ingrédients, de l’autre, je perçois une forme générale.
Sans revenir sur la distinction entre art majeur et art mineur – frontière fluctuante déjà discutée par Georges Roque dans Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art (2000) –, faisant correspondre à « majeur » les arts académiques et à « mineur » les arts dits impurs (arts industriels, décoratifs, folkloriques…) – le parfum est par nature un art (em)mêlé. Un art – mais c’est loin d’être le seul – où enjeux commerciaux rivalisent avec enjeux esthétiques, et un art hybride qui ne s’adresse pas qu’à un seul sens. Il semble alors impératif que cette hétérogénéité ne soit pas occultée au bénéfice seul de l’odorat, mais soit au contraire mise en avant.
Essentialisme vs pragmatisme
En esthétique, deux approches sont possibles : d’un côté, une approche essentialiste qui cherchera à donner les critères d’avènement d’un art et les conditions de réalisation d’une œuvre au sein de ce domaine (approche assortie du jugement c’est de l’art / ça n’est pas de l’art) ; de l’autre, une approche pragmatique qui donne les conditions de réussite d’une œuvre, c’est-à-dire qui énonce : cet objet fonctionne en tant qu’œuvre d’art à condition que… Dans le domaine du parfum, l’approche essentialiste a été beaucoup expérimentée, par nécessité de comparaison avec les autres arts. On songe aux critères proposés par Edmond Roudnitska d’après les travaux du philosophe spécialisé en esthétique Étienne Souriau, dans l’article intitulé « Caractères esthétiques du parfum » figurant dans L’Esthétique en question. Introduction à une esthétique de l’odorat (1977).
Le parfum est un art s’il est prouvé qu’il remplit les conditions suivantes : (1) produire des stimuli adressés à un sens spécifique ; (2) présenter un ensemble de données [qualia] qui se combinent et s’ordonnent (en gamme ou en palette) ; (3) attester l’existence de moyens de production permettant la réalisation des œuvres (uniques ou multiples) tout en garantissant l’identité de ces œuvres ; (4) développer un appareil éducatif qui sensibilise créateurs et public ; (enfin,) (5) constituer, par ces œuvres, un moyen d’expression reconnu pour les créateurs.
Si pendant longtemps les critères (4) et (5) étaient difficilement remplis, aujourd’hui tout est mis en œuvre pour les satisfaire avec notamment l’avènement du storytelling autour des parfums et des médias qui leur sont consacrés, de la publicisation des parfumeurs et de leur démarche créative, etc. Dans cette lignée se situent aussi les travaux des parfumeurs du groupe du Colisée (Blayn, Bourdon, Haasser, Delville, Latty, Maurin, Morillas, Preyssas, Roucel, Sebag, Vuillemin) dans Questions de parfumerie. Essais sur l’art et la création en parfumerie (1988) – travaux qui ont déterminé les spécificités du parfum en tant que médium artistique de représentation.
Si elles sont nécessaires et contribuent au rayonnement de la création olfactive, ces perspectives restent un peu rigides. L’approche pragmatique vient ici nuancer l’acceptation ou le rejet du label « art », disant que, au même titre qu’un Rembrandt utilisé pour boucher un trou dans un mur (l’exemple est de Nelson Goodman), un parfum, aussi fin et nuancé soit-il, utilisé pour désodoriser, jamais ne pourra remplir les conditions d’avènement de l’expérience esthétique. Cette expérience naît en grande partie dans l’attention portée au parfum, senti pour lui-même, et dans la verbalisation de sa perception.
Pour que le parfum quitte sa dimension accessoire, il faut donc lui mettre un cadre, qui à défaut d’être visuel, serait celui de l’attention focalisée. Le contexte n’est pas nécessairement muséographique, il s’agit plus d’une rigueur d’accueil, d’une ouverture consciente à la réception olfactive.
Cet article a été originellement publié dans Nez, la revue olfactive #04 – Le parfum et l’art
Image principale : Vassily Kandinsky, Mit dem schwarzen Bogen (Avec l’arc noir), huile sur toile, 1912, Centre Pompidou






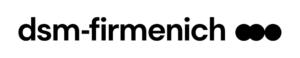

Je suis très vieille (75) mais avec toujours la même passion pour le parfum souvent consolateur toujours généreux… chaque jour j ai 20 ans et là tout à coup je lis que je pourrais découvrir 2 petites merveilles…mmmm…