Cette publication est également disponible en :
![]() English
English
La cueillette d’ylang ylang des Comores dénoncée dans un article de Médiapart en 2023, le travail d’enfants lors de la récolte du jasmin d’Égypte mis en avant dans un documentaire de la BBC[1]« Child labour behind global brands’ best-selling perfumes » sur la chaîne Youtube de la BBC, ainsi que l’article de Ahmed ElShamy et Natasha Cox sur le site du média en mai… Plusieurs scandales touchant l’industrie du parfum ont été mis à jour ces derniers temps, alors même que l’on voit fleurir les discours sur l’éthique dans la communication des marques.
Et si l’un des nerfs de la guerre tenait dans la juste rémunération des premiers maillons de la chaîne ? Ce qui semble être une évidence est pourtant encore loin d’être la règle. Nous proposons une analyse de ce sujet brûlant, tout juste publiée dans le dernier numéro de la revue Nez, qui explore les différents liens entre argent et parfum.
Derrière les beaux discours sur les matières premières vantées dans les publicités, il est des histoires que l’on préférerait oublier. Celle des racines colonialistes de l’industrie du parfum en fait partie. Cette histoire est pourtant essentielle pour comprendre le fonctionnement actuel de l’industrie, et se doit d’être rappelée par décence envers les peuples colonisés. Sans eux, la parfumerie telle qu’on la connaît n’existerait pas. Car ce n’est pas seulement la chimie qui a permis de passer d’une création onéreuse et réservée à quelques privilégiés à une industrie de masse. Le mouvement est global, comme en fait état Sylvie Laurent dans Capital et race, Histoire d’une hydre moderne (Seuil, 2024) : « Sans cette “nature bon marché” constitutive du capitalisme, sans l’esclavage et l’exploitation des terres américaines (à laquelle s’ajoute le travail non rémunéré des femmes en métropole), l’Europe n’aurait pu entrer dans l’âge de la croissance et de la technique. » Pour produire la quantité de naturels que nous connaissons aujourd’hui, il a fallu avoir recours à une main-d’œuvre exploitée, mais aussi à des terres fertiles et dominées par l’Occident, comme celles de Madagascar, des Antilles-Guyane ou encore de la Réunion.
Certaines plantes cultivées sont endémiques, d’autres sont introduites à la suite d’expérimentations. Dans le manuel Les Plantes coloniales utiles que l’on peut cultiver en France, publié en 1943, le botaniste Auguste Chevalier conçoit ainsi l’exploitation colonialiste comme un moyen pour « rapatrier les richesses » : « Les colonies françaises de l’Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie ont le devoir impérieux de se préoccuper de subvenir aux grands besoins de la Métropole en ces essences. […] La fabrication de ces essences hespéridées n’est pas compliquée : point d’outillage coûteux, fabrication simple et facile, main-d’œuvre peu coûteuse, féminine et enfantine. »
L’historienne Mathilde Cocoual a étudié le cas de Madagascar, où l’industrie grassoise a introduit les cultures de l’ylang-ylang, de la vanille, du girofle et de la cannelle au début du XXe siècle : « Il y a une dualité dans ce geste : d’un côté, évidemment, il y a eu une exploitation des populations locales ainsi que des effets néfastes liés à la colonisation ; de l’autre, la plante à parfum a été une ressource complémentaire pour les paysans locaux, souvent plus facile que le travail à la mine », explique-t-elle. Bouleversements migratoires, culturels et religieux, modification durable des terres, villageois réquisitionnés de gré ou de force, mauvaises conditions de vie sur les domaines font partie de l’empreinte impérialiste. Au moment de la décolonisation, dans les années 1960, tout est laissé à l’abandon, sans aide ni compensation financière ; les cultures de plantes à parfum finiront par être rachetées par d’autres sociétés.
Prix légal, prix éthique
Qu’en est-il en 2024 ? S’il est difficile d’avoir accès aux revenus des cueilleurs et paysans, qui fluctuent beaucoup – et parce que le sujet est tabou –, et si les conditions d’accès, les intermédiaires et les spécificités propres à chaque matière rendent complexe le contrôle d’une juste rémunération des premiers maillons de la chaîne, la situation est suffisamment précaire, voire critique pour justifier des mouvements de protestation, à l’image de celui mené par les agriculteurs français en janvier 2024. Lorsque le contexte géopolitique est compliqué, la situation est encore plus désastreuse. Dans un article publié sur Médiapart en mars 2023, Florence Loève dénonçait « derrière les flacons Dior, l’exploitation de celles qui cueillent les fleurs d’ylang aux Comores ».[2]« Derrière les flacons Dior, l’exploitation de celles qui cueillent les fleurs d’ylang aux Comores », de Florence Loève, sur le site de Médiapart Les prix sont fixés par les acheteurs et sont soumis à de nombreux facteurs d’incertitude. Six euros par jour pour une cueilleuse, entre dix et vingt euros pour un ouvrier en distillerie… Mais les locaux n’ont que peu le choix : ils dépendent en grande partie de ces cultures. « Il y a une contradiction dans l’industrie du luxe. Les marques portent un discours de développement durable, mais il me semble difficilement crédible tant que les acheteurs de matières premières ont d’abord des objectifs financiers, souligne la journaliste interrogée. Et, même si une marque cherche à sourcer son produit avec de bonnes intentions, la situation géopolitique de pays comme les Comores rend les choses très complexes : la communication des marques doit être plus réaliste à ce sujet. »
Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Shamiso Mungwashu, spécialiste en développement de projets pour la Fairtrade Support Network Zimbabwe, faisait ainsi état de la somme payée aux paysans qui cultivent les épices dans son pays lors d’une conférence de l’UEBT en octobre 2022 : 70 dollars par mois pour la plupart, 170 dollars pour les employés les plus qualifiés ; le solde accordé aux cueilleurs est plus bas encore, et n’est souvent pas encadré : moins de 15 dollars par mois sur quatre à six mois, dans un pays où il s’agit de la principale ressource financière : « Si on ne considère que les repas, pour une famille de quatre personnes, on dépasse déjà le revenu minimum établi par la loi. Sans compter l’électricité, l’école… » Et de compléter : « Nous avons de la gratitude pour nos partenaires. Car la plupart des communautés avec lesquelles je travaille dépendent de vous [les maisons de composition], de la relation que vous avez construite, ne serait-ce que pour avoir la dignité de nourrir leurs familles. » Avant de soulever une question centrale : « Payer 80 dollars est légal. Mais est-ce nécessairement éthique ? »
La concurrence de la synthèse
À Madagascar, c’est la vanille qui constitue une ressource importante, comme le note Georges Geeraerts, président du Groupement des exportateurs de vanille de Madagascar et vice-président du Conseil national vanille : « La gousse peut représenter jusqu’à 8 % du PIB, et fait vivre localement plus de 150 000 familles. C’est un produit qui demande beaucoup de temps et d’étapes, et qu’on devrait considérer comme un vrai luxe. Mais son prix Fairtrade a été calculé à 5,6 dollars le kilo ; or cela n’est pas du tout suffisant pour faire vivre une famille, sans parler de l’accès à une éducation décente, par exemple. » Collecteurs, préparateurs, conditionneurs, stockeurs, exportateurs, traders constituent autant d’étapes qui font ensuite grimper le tarif de la matière première pour les sociétés de composition qui en sont les utilisatrices. Sur ce terrain, la gousse a un ennemi puissant : « Les arômes de synthèse, mille fois moins chers, et dont la dénomination entretient un flou dans l’esprit des consommateurs qui ne savent même plus ce qu’ils achètent. » Les mentions « arôme naturel » et « arôme naturel de vanille » ne désignent ainsi pas la même chose ; le cas est similaire dans les parfums : la quantité de matière première n’est pas la même pour obtenir un extrait ou une infusion de vanille ; cela permet pourtant de revendiquer de la même façon l’ingrédient dans la composition. « C’est ce qui explique qu’on vende la même quantité de vanille depuis plus de vingt ans, alors que la population a augmenté, et qu’on doive finir par la céder au rabais. Or, sans la gousse naturelle, la synthèse n’existerait pas : on lui doit un tribut. » Pour pallier ce problème, un prix plancher a été établi en 2021 par le gouvernement malgache, « mais il a été libéralisé en 2023, sans période de transition. C’est dramatique, les paysans n’arrivent plus à vendre, et finissent par le faire à des prix dérisoires pour ne pas perdre leur production. »
Le prix, sujet central de la soutenabilité
L’industrie agroalimentaire est certes la plus grande consommatrice de la gousse, et la parfumerie reste proportionnellement une petite acheteuse. Mais elle a son rôle à jouer, et ce d’autant plus que les arômes et les parfums sont créés par les mêmes sociétés. Rappelons qu’à l’heure où LVMH, dirigé par Bernard Arnault, envahit nos boutiques grâce à ses nombreuses marques et enregistre un chiffre d’affaires sans commune mesure, Madagascar est actuellement positionnée au 173e rang sur 191 dans le classement des pays par indice de développement humain. La richesse n’a en toute apparence pas su ruisseler jusqu’aux paysans, sans qui pourtant les grands parfums que nous aimons n’existeraient pas. « Si on veut pouvoir parler de soutenabilité et d’éthique, le prix, qui reste un tabou dans l’industrie, est le sujet central. Les situations varient beaucoup selon les pays et les matières. De manière classique, le prix est indexé sur le temps passé sur place ou sur la quantité récoltée, mais c’est assez inégalitaire : les jeunes sont plus rapides par exemple, les plus âgés sont pénalisés, et cela incite au travail infantile. Au Guatemala, quand la cardamome qui y est produite est achetée à un prix décent, que nous calculons avec les données des producteurs, les paysans peuvent être rémunérés pour assurer leur subsistance, les études des enfants et quelques loisirs. Mais c’est un marché très volatil », note Elisa Aragon, cofondatrice et CEO de la société Nelixia, productrice de matières premières en Amérique latine. Pour autant, la demande en naturels est forte, même dans les produits d’entretien de la maison. Les sociétés clientes veulent cependant faire baisser les coûts, et cherchent des naturels plus low cost. « Le souci est que la hiérarchie très verrouillée dans les entreprises acheteuses, avec en bout de chaîne les actionnaires, cherche toujours à faire baisser les prix, mais ne se rend pas compte de l’impact sur les paysans dont c’est souvent la seule source de revenus. Rémunérer mieux les paysans changerait des millions de vies, sans avoir un impact réellement significatif sur le coût de production des matières. » Le réchauffement climatique a tendance à amplifier le problème : les rendements sont globalement moindres ; il faut donc accompagner les paysans vers des solutions comme l’agroécologie pour leur permettre de trouver une résilience. « Je crois qu’il n’y a pas une seule matière première pour laquelle on peut dire que le prix payé est juste. Mais les clients nous posent de plus en plus la question : une prise de conscience est advenue, et je suis persuadée que les choses vont commencer à changer », conclut Elisa Aragon.
Accompagner le changement
Un grand nombre de maisons de composition cherchent néanmoins à s’engager pour que les producteurs gagnent en autonomie, en investissant dans du matériel par exemple, en mettant en place des partenariats à long terme, ou encore en créant des outils d’évaluation de la durabilité des matières premières et compositions parfumées… C’est aussi l’une des raisons d’être de l’Union for Ethical Biotrade (UEBT), une organisation à but non lucratif créée en 2007 pour garantir un sourcing équitable. Parmi les différents critères d’évaluation, « le principe 3 porte notamment sur les prix équitables et sur la manière dont les entreprises doivent s’assurer que les accords d’approvisionnement avec les producteurs sont fondés sur le dialogue, la confiance et la collaboration à long terme », explique Rik Kutsch Lojenga, directeur exécutif de l’UEBT. « Traditionnellement, les pratiques de rémunération des cueilleurs et cultivateurs sont informelles, et les équivalents du salaire minimum ne sont souvent pas respectés. Nous avons créé une approche progressive pour accompagner les sociétés : valorisation du temps moyen consacré par les producteurs aux activités de culture ou de collecte à un taux au minimum proportionnel au salaire de subsistance, soutien à la diversification des sources de revenus locales, ou encore objectifs pour faire progresser les salaires pour les travailleurs sous contrat. Nous guidons aussi les auditeurs tiers pour déterminer le salaire vital, que nous définissons comme la rémunération perçue pour une semaine standard par un travailleur dans un lieu donné, suffisante pour assurer un niveau de vie décent à celui-ci et à sa famille », poursuit-il. Pour garantir que les sociétés acheteuses respectent les normes, l’UEBT réalise des vérifications sur le terrain, permettant de définir une base d’amélioration progressive qui vise à accompagner les changements. Elle propose également un programme de certification pour chaque ingrédient, orchestré par un organisme tiers, pour lequel elle ne perçoit pas de rémunération, et qui seul permet d’obtenir un label. Si de telles démarches ont permis une amélioration et une sensibilisation globale de l’industrie, « les évaluations de l’UEBT ne sont pas des “garanties” et ne peuvent à elles seules résoudre des problèmes profondément enracinés tels que les inégalités et les déséquilibres de pouvoir », souligne Rik Kutsch Lojenga. Les audits ont par ailleurs un prix que le producteur ne peut être le seul à payer, et l’accompagnement financier en ce sens doit devenir un engagement des grandes marques, qui bénéficient de la valeur ajoutée de ces produits certifiés.
Rien dans le flacon
Pourtant, les situations restent largement précaires pour les « petites mains », premières à subir les conséquences des spéculations, crises diverses engendrées par le Covid ou les guerres… Et les décisions des marques. Les matières premières naturelles sont souvent valorisées dans les campagnes marketing des grands parfums qui en vantent les origines. Rose bulgare, vanille de Madagascar, ylang-ylang des Comores font voyager, et donc vendre. On sait pourtant que le prix du concentré constitue une faible proportion du prix final du flacon – entre 1 et 5 %, surtout pour les marques mainstream qui bénéficient d’une large présence dans les médias. Mais le scandale, pour le parfumeur Christophe Laudamiel, tient à la communication : « Ce que l’on sait moins, c’est que les marques n’utilisent souvent qu’entre 0,01 et 0,1 % d’extrait pur d’un ingrédient naturel dans leur concentré pour pouvoir le mentionner dans leur communication. On laisse habilement croire au public que ces naturels constituent une part significative du parfum, mais si les formules étaient publiques, tout le monde serait très certainement bouche bée. » Il a ainsi envoyé une lettre aux grands groupes en août 2022, dans laquelle il souligne qu’utiliser 100 ppm (0,01 %) d’un ingrédient dans une composition ne devrait pas autoriser à le mentionner dans un dossier de presse. « Pour un flacon de 50 ml, les grands groupes paient 70 centimes à 1,50 dollar le concentré. Cela doit couvrir tout le monde : parfumeur, évaluateur, commercial, législation, et évidemment fermiers, coopérative, transformateurs, transport… Au kilo, évidemment, les matières naturelles peuvent être chères, mais si on ne met quasiment rien dans le flacon, on ne garantit rien au fermier, payé selon les volumes vendus. Augmenter son revenu ne changerait rien aux bénéfices énormes de ces groupes qui possèdent des poignées de licences et se félicitent de leurs chiffres annuels sans aucune honte ! » Pour mettre en évidence ce grand écart, le parfumeur publie sur le compte instagram Fragrance Drama[3]Voir https://www.instagram.com/fragrance.drama/ les analyses de certaines compositions célèbres. « C’est comme si l’on faisait passer un vêtement composé à 99 % de nylon pour un drap de laine de qualité. Les maisons de luxe n’accepteraient pas ça dans leurs gammes de mode, pourquoi l’accepteraient-elles dans leurs flacons ? »
De toute évidence, les efforts dilués ne suffisent plus ; la prise de conscience doit être générale si l’on veut imaginer un avenir différent du passé. Pour reprendre les mots de Sylvie Laurent : « Briser le cercle funeste commence par la dissipation des illusions et des légendes. »
Visuel principal : © Nicolas Nadé
Notes
| ↑1 | « Child labour behind global brands’ best-selling perfumes » sur la chaîne Youtube de la BBC, ainsi que l’article de Ahmed ElShamy et Natasha Cox sur le site du média |
|---|---|
| ↑2 | « Derrière les flacons Dior, l’exploitation de celles qui cueillent les fleurs d’ylang aux Comores », de Florence Loève, sur le site de Médiapart |
| ↑3 | Voir https://www.instagram.com/fragrance.drama/ |
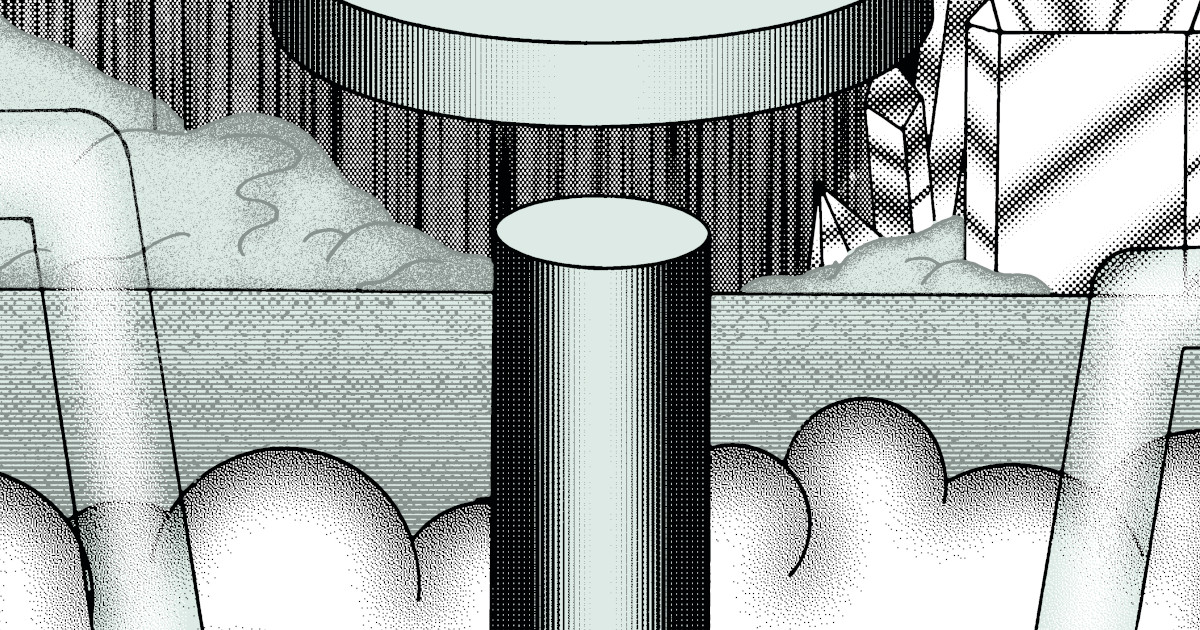


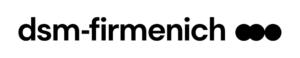

Merci Jessica !!