Cette publication est également disponible en :
English
Dans son roman fleuve, l’écrivain asthmatique met en scène un narrateur hypersensible dont les narines ne sont pas moins fines que le palais. À l’occasion du centième anniversaire de sa mort ce 18 novembre 2022, nous vous proposons un article de Clément Paradis initialement paru dans Nez, la revue olfactive #13 – De près ou de loin.
Ah, « le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul » ! Quel succès ! On y fait même allusion pour parler de l’effet qu’une fragrance pourrait avoir sur nous dans le temps. C’est vrai qu’il y a quelque chose de vertigineux à avoir ainsi condensé, comme Marcel Proust dans le début de son roman À la recherche du temps perdu, publié en sept tomes de 1913 à 1927, « tout Combray » dans une tasse de thé, tout un village d’enfance dans une réminiscence fugace et bouleversante. Si Proust était assurément un homme « de goût », son approche de la sphère olfactive, peu connue, n’en est pas moins délicate et porteuse de réflexions sur l’art et la vie.
Né en 1871, Marcel Proust est diagnostiqué asthmatique dès l’âge de 9 ans : en rentrant d’une promenade au bois de Boulogne, l’enfant est pris d’une effroyable crise de suffocation qui manque de l’emporter. Son univers sensible se déploie dès lors comme un labyrinthe complexe. Il se tient éloigné des parfums capiteux de son temps, qu’il ne tolère pas, tandis qu’il se plonge avec délice dans la littérature du XIXe siècle qui fait l’éloge des senteurs les plus enivrantes. Son roman garde la trace de ces émerveillements ; il y cite l’évocation d’une « odeur fine et suave d’héliotrope [qui] s’exhalait d’un petit carré de fèves en fleurs » comme « une des deux ou trois plus belles phrases » des Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand. Il y rappelle aussi la verve baudelairienne et la recherche par le poète, « dans l’odeur d’une femme par exemple, de sa chevelure et de son sein, [des] analogies inspiratrices qui lui évoqueront “l’azur du ciel immense et rond” et “un port rempli de flammes et de mâts” ». Les effluves donnent à lire l’espace et ouvrent pour le lecteur les horizons de nouvelles correspondances.
Des arômes redoutés, différents
Le héros d’À la recherche du temps perdu, créature sans nom mais perpétuellement traversée par le monde et ses mots, réévalue sans cesse sa position face à la dimension olfactive du monde. Dans sa maison d’enfance, chez ses grandsparents, c’est d’abord l’escalier le séparant de sa mère qui se pose en adversaire, avec son « odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de chagrin ». Mais les jeunes années apportent aussi leur lot de senteurs amies, et peut-être le premier « parfum » marquant de la Recherche : celui du pot de chambre après la dégustation d’un plat d’asperges. L’esprit de l’enfant prête en effet vie à ces dernières et les imagine jouer, « dans leurs farces poétiques et grossières comme une féerie de Shakespeare, à changer [son] pot de chambre en un vase de parfum ». La chambre devient un lieu matriciel : au fil du roman, le héros en visitera de nombreuses, dans des demeures familiales ou des hôtels ; elles se rappelleront à son souvenir par leurs exhalaisons.
Chez Proust, le parfum n’est pas toujours où l’on croit, et la méfiance de l’asthmatique a peut-être conduit l’écrivain à prêter prudemment attention à tous les changements d’air. Construisant sa culture olfactive, le héros nous fait comprendre que les arômes redoutés, différents, sont aussi ceux qui nous édifient. L’un d’entre eux traverse le roman : le vétiver.
Découvrant la chambre qui lui est allouée au Grand Hôtel de Balbec, une station balnéaire imaginaire où se transportent en saison les mondanités parisiennes, le protagoniste se retrouve « dès la première seconde […] intoxiqué moralement par l’odeur inconnue du vétiver ». Émanerait-elle des « savons trop parfumés » de l’établissement ? En tout cas, les effluves de la Recherche révèlent pleinement leur pouvoir dans ce passage du deuxième tome, À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Provoquant plus qu’une gêne fugace, ils sont capables d’offensives qui laissent le narrateur dépossédé de son monde : « N’ayant plus d’univers, plus de chambre, plus de corps que menacé par les ennemis qui m’entouraient, qu’envahi jusque dans les os par la fièvre, j’étais seul, j’avais envie de mourir. » Ce qui devait être un séjour de repos se transforme en cauchemar. Quelques centaines de pages plus tard, alors que la saison touche à sa fin, le personnage, bon client, se voit proposer de meilleures chambres pour ses prochains séjours. La direction essuie alors un surprenant refus. « J’étais attaché maintenant à la mienne où j’entrais sans plus jamais sentir l’odeur du vétiver. » La chambre est adoptée, les séjours se répètent. L’indifférence finit même par faire place à des sentiments plus intenses et des associations plus incongrues : à la fin du roman, le héros se découvre « exalté » par les arômes pourtant déplaisants de la naphtaline et du vétiver qui lui rendent « la pureté bleue de la mer le jour de [son] arrivée à Balbec ». La racine d’Haïti se confond avec les paysages de la côte normande, nous rappelant que c’est d’abord l’arbitraire qui tisse notre relation olfactive au monde. Dans le roman proustien, les odeurs conditionnent donc un rapport à l’espace et à son souvenir, et régulent parfois astucieusement la chorégraphie mondaine. Pourtant, rares sont les personnages qui se parfument : la grande comédienne du roman, la Berma, inspirée de Réjane et Sarah Bernhardt, en fait partie ; ou plutôt, on apprend au détour d’une anecdote qu’elle utilise « des océans de parfums pour laver ses chiennes ». La principale figure mondaine dont on peut suivre le sillage est – sans surprise – Odette, la « cocotte » qui deviendra madame Swann. Sa fragrance de prédilection se perçoit « jusque dans l’escalier » et contribue à faire de sa demeure une « chapelle mystérieuse » au cœur de laquelle on trouve certains plaisirs, mais aussi « tant de chaleur, de parfums et de fleurs ». Ces plaisirs suspects n’enthousiasmant guère Françoise, l’employée de maison du héros, elle s’affairera à discréditer Albertine, la femme qui partage sa vie pendant un moment, elle aussi amatrice d’agréments olfactifs : « ça va être une vraie parfumerie ici » !
Catleyas et seringas
Mais ce qui rebute les uns attire les autres : Swann, le mondain charmeur et cultivé, se laisse parfois guider par son odorat dans le faste des réceptions parisiennes. On le croise ainsi serrant la main d’une marquise et plongeant « un regard attentif, […] absorbé, presque soucieux dans les profondeurs du corsage » de la dame : il est grisé par son parfum, si bien que ses narines palpitent « comme un papillon prêt à aller se poser sur la fleur entrevue ». Le savoir-vivre de Swann étant impeccable, la rencontre n’ira pas plus loin. Mais avec Odette, lorsqu’il se rend compte que l’attirance qu’il a pour elle est réciproque, un autre ballet prend forme dans l’intimité d’une voiture. Portant à la main un bouquet de catleyas, la cocotte arbore des fleurs de cette même orchidée dans ses cheveux ainsi qu’à l’ouverture de son corsage décolleté. La voiture cahote, les catleyas chancellent, Swann entreprend de sauver ceux qui ornent la gorge d’Odette. « Il était vraiment nécessaire de les fixer, ils seraient tombés », explique-t-il timidement à la jeune femme qui n’offre aucune résistance. L’effluve des fleurs, ou plutôt son absence éventuelle, est alors le prétexte choisi par Swann pour se rapprocher encore davantage d’elle : « Sérieusement, je ne suis pas désagréable ? Et en les respirant pour voir s’ils n’ont vraiment pas d’odeur, non plus ? Je n’en ai jamais senti, je peux ? dites la vérité. »
Dans le trouble des exhalaisons florales, leurs parcours s’unissent quand d’autres se séparent. Si Swann « fait catleya » avec bonheur, le héros du roman souffre plus tard, victime d’une mise en scène retorse lors du « soir de la branche de seringa ». Il rentre pourtant chez lui heureux : madame de Guermantes lui a offert, parce qu’elle savait qu’il les aimait, des seringas du Midi. Seulement, en montant l’escalier il croise Andrée, une amie d’Albertine, que la senteur « si violente » des fleurs semble incommoder. Elle lui confie d’ailleurs qu’Albertine ne devrait guère plus apprécier l’entêtant bouquet. Passant la porte de l’appartement, il ne s’émeut donc pas de voir cette dernière le fuir et se réfugier dans sa chambre. Il n’apprendra qu’après la mort de sa compagne ce qui s’est joué ce soir-là : la répulsion des deux jeunes femmes était feinte, probablement destinée à lui dissimuler draps défaits et autres vestiges de jeux charnels qu’elles venaient peut-être de partager dans son appartement. Les odeurs tissent ainsi des jeux sociaux complexes, des scènes marquantes pour le narrateur, tant et si bien qu’il finit par élaborer une curieuse théorie : notre esprit fonctionnerait comme travaille un parfumeur.
Héros synesthète
Le protagoniste est un être de désir, et son expérience du monde convertit ses déceptions en savoir, remplace les fantasmes par des connaissances réelles. Mais comment rendre sensible au mieux cette réalité ? Son admiration pour une sommité de la vie aristocratique, la princesse de Parme, est l’occasion d’un exposé théorique précis. Il avait en effet « fait absorber à ce nom de princesse de Parme le parfum de milliers de violettes » au fil des années, « comme un parfumeur à un bloc uni de matière grasse ». C’est bien la technique de l’enfleurage qui est décrite ici, c’est-à-dire l’utilisation de la capacité des corps gras à absorber naturellement l’odeur des plantes. Mais les fleurs sont remplacées par nos fantasmes, et leurs supports sont les personnes qui nous entourent. Le rêve est cependant toujours bref et source de désillusion : en fréquentant la princesse de Parme, le héros s’aperçoit qu’elle n’est qu’une femme comme il en a tant connu, humaine, humble. Son esprit doit alors s’atteler à une seconde opération : celle-ci consiste, « à l’aide de nouvelles malaxations chimiques, à expulser toute huile essentielle de violettes et tout parfum stendhalien du nom de la princesse et à y incorporer à la place l’image d’une petite femme noire, occupée d’œuvres ». Senteurs et images se mêlent ainsi pour le héros synesthète affairé à recomposer en permanence l’effluve qu’il associe en lui-même à chaque être.
Proust n’est donc pas seulement attentif aux sensations olfactives : tout le procédé de fabrication des fragrances a été un centre d’intérêt pour lui, nourri par la lecture de Pays des aromates de Robert de Montesquiou (qu’il considérait comme un abrégé de l’histoire de la parfumerie) et de celle des Hymnes orphiques, ces prières aux divinités de la Grèce antique, précédées de la mention de substances odorantes à consumer pour accompagner leur récitation. L’auteur nous apprend ainsi que l’encens était le parfum de la mer, mais aussi celui des déesses Dikè, Thémis, Mnémosyne, des neuf Muses et de Circé. Ce partage d’une même essence par diverses divinités le trouble, mais il en tire une nouvelle leçon : les senteurs intérieures et les désirs que nous projetons sur les êtres qui nous inspirent sont moins personnalisés qu’on ne le croit. Ainsi peut-on expliquer pourquoi les déceptions et les tristesses qui les suivent sont également, dans le cours de nos vies, si semblables les unes aux autres. Les élans de pessimisme restent cependant passagers dans la Recherche : la vie parvient toujours à tirer le narrateur de ses idées noires en l’entourant de sensations à interpréter, émanant des espaces les plus divers, comme la madeleine parisienne ou les aubépines de Combray, avec lesquelles le héros dialogue dans son enfance. Malicieusement, Proust choisit pourtant une référence plus modeste pour parachever son raisonnement : le petit vase de parfum, espace de synthèse de ce qu’il y a de plus trivial et de plus crucial, d’infiniment petit et d’infiniment grand – car « une heure n’est pas qu’une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats ».
- Cet article est initialement paru dans Nez, la revue olfactive #13 – De près ou de loin
Visuel principal : Portrait de Marcel Proust par Paul Nadar, 1892 (détail) ©Ministère de la Culture – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. RMN-Grand Palais / Paul Nadar






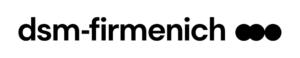

Commentaires