Cofondateur d’Act Up Paris et de la revue Têtu, Didier Lestrade a dès la fin des années 1980 décrit dans Libération l’essor de la house music de Chicago, New York et Detroit. Interrogé pour le grand dossier Musique & parfum de Nez #14 par Clément Paradis sur les liens entre critique musicale et olfactive, il prolonge ici son propos, partageant son amour pour les effluves simples et abordables. Des clubs de Manhattan à l’île de la Réunion, de sent-bon nostalgiques en sillages musqués, il évoque la dimension sociale et thérapeutique qu’a tenue le parfum tout au long de sa vie.
La série Le Parfum, diffusée en 2018 sur Netflix, utilise les essences comme trame d’un polar inquiétant, une manière d’aborder le sujet des fragrances tout aussi étrange que le film de Tom Tykwer sorti en 2006, Le Parfum, histoire d’un meurtrier, inspiré du désormais célèbre livre de Patrick Süskind. Depuis l’enfance, j’ai été sensible au parfum à travers une approche sociale : celle du parfum populaire, abordable. Ayant grandi en Afrique du nord et en Aquitaine, mon amour pour les effluves s’est naturellement dirigé vers les essences les plus naturelles, campagnardes. Dans les années 1960, la violette de Toulouse était encore une senteur régionale puissante. Dernier d’une fratrie de quatre garçons, j’ai grandi dans une famille modeste, et ce sont les eaux de toilette que l’on trouvait dans les salles de bains qui me séduisaient, dans la catégorie nostalgique des « sent-bon ». Souvent, toute la famille utilisait le même flacon d’eau de Cologne Bien-Être. J’étais déjà attiré par les senteurs que l’on trouvait dans le jardin : la rose, la lavande, le lilas, l’iris, le géranium rosat et surtout les effluves venant des hangars où séchaient la prune d’Ente des vergers de la ferme, riche et sucrée. Pour moi, les parfums étaient forcément des émanations de la nature.
Avec les années 1970, les patchoulis ont enrichi la culture rock et je suis tombé amoureux des compositions puissantes, où les résines et l’ambre évoquaient des voyages lointains et impossibles. La couleur des essences s’est assombrie, brune, minérale. Mais c’est en arrivant à Paris en 1977, à 19 ans, que mon intérêt pour les fragrances a vraiment débuté. Avec mes frères, nous visitions les rayons des Galeries Lafayette ou du Printemps où se trouvaient les parfums démodés, ou sur le point de disparaître. Et donc moins chers. C’est à ce moment-là que nous avons découvert les eaux de toilette de Robert Piguet, avec leurs noms si passéistes : Fracas , Bandit, Cravache, dont les flacons avaient encore ce look vintage très simple. Au lieu de me diriger vers les flacons nouveaux et chers, je me suis orienté vers le passé de la parfumerie, celle des années 1930, 1940 et 1950. Aux Puces, nous cherchions tout ce qui évoquait une frivolité ancienne, typiquement française et haute-couture.
C’est ainsi qu’au milieu des années 1980, j’ai développé une fixation pour les maisons dont les produits étaient alors sur le déclin : Royal Bain de Champagne (désormais Royal Bain) de Caron, Bal à Versailles de Jean Desprez ou encore Soir d’Italie de Molinard. Leurs noms désuets me séduisaient, mais, surtout, je commençais à considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle, pour un homme, à porter des parfums de femme. Un garçon qui portait de la violette était pour moi irrésistible, alors que j’avais déjà une aversion envers Pour un homme de Caron, Eau sauvage de Dior ou n’importe quel Fabergé. Et l’exotisme était parfois renversé, comme lorsque j’ai commencé à porter Old Spice, si populaire chez les hommes Américains.
À la fin des années 1980, lors de mes premiers voyages aux États-Unis, j’explorais les boutiques duty-free des aéroports où l’on trouvait encore, comme aux Galeries Lafayette, des parfums en déshérence. À l’époque, Dior était une marque vieillissante et les Miss Dior, Diorella, Dioressence, avec leurs flacons au design pied-de-poule, étaient ceux que j’arrivais à subtiliser car ils n’étaient pas surveillés. À New York, j’ai été très marqué par les patchoulis que vendaient certains Afro-américains sur les trottoirs de l’East Village. Ce fut une révélation pour moi, il y en avait tellement ! Et puis c’était la grande mode du White Musk (musc blanc) qui inondait les boutiques The Body Shop. J’y voyais une attraction vaudou et je lui attribuais même une signification tribale, des pouvoirs mystérieux, érotiques. Ces parfums étaient ceux des clubs de house où les hommes Noirs et Latinos étaient majoritaires. Je me rappellerai toujours, aussi, un jour d’hiver anticyclonique à New York, la première fois que j’ai senti cet effluve qui suivait une femme dans la rue : CK One. Ce fut une gifle d’émerveillement.
La découverte de ma séropositivité, en 1986, m’a définitivement orienté vers des créations presque thérapeutiques, comme les nombreuses eaux de toilette à base de lavande, originaires de différents pays. Cette période, marquée par le peu de traitements disponibles pour les personnes séropositives, était influencée par la culture holistique. Il fallait aider le mental pour affronter le physique. L’incertitude était grande face à la survie, qui était de l’ordre de 5 ans après l’annonce d’un test positif au VIH. Pour moi, le parfum constituait alors un soutien psychologique, tout autant qu’une marque identitaire, comme j’en évoque le souvenir douloureux dans mon livre Act Up, une histoire (ed. Denoël, 2000) :
« Les origines polonaises de Jim et son enfance au Texas en avaient fait un parfait spécimen d’Américain blond type Wasp à la peau incroyablement blanche, aux cheveux ras, avec des pectoraux et des épaules dessinés pour porter n’importe quoi tout en ayant toujours l’air de sortir de sa salle de gym (Chelsea Gym, bien sûr). Et puis, il avait un sourire incroyable et une odeur de peau unique, comme s’il vivait à l’intérieur d’une bulle de savon Ivory. De sa salle de bains, par exemple, émanait un parfum que je recherche toujours, un mélange de désinfectant mystérieux dans lequel on trouvait une pointe pétillante de Listerine agrémentée d’une douceur caramélisée qui ressemblait au Cocoa Butter & Vitamine E de la mousse à raser Noxzema. Dans son appartement qui donnait sur un jardin abandonné que nous avions aménagé ensemble, j’ai vécu les plus beaux jours de ma vie.
[…] À chacune de mes visites à New York, l’état de Jim se détériorait. Un jour, alors que je lui confirmais au téléphone mon arrivée, il me dit simplement ces mots : “Didier tu ne vas pas me reconnaître.” Je savais que je devais m’attendre au pire puisque, dans sa bouche, cette description était sûrement une façon timide de sous-estimer la vérité. Je lui avais acheté au duty-free d’Orly un de ces parfums français démodés : Je reviens de Worth. Ce cadeau prit une dimension dramatique quand je découvris que l’homme que j’aimais n’était plus que l’ombre de lui-même. »
Cela a renforcé mon idée que le parfum avait un rôle social. Je suis persuadé que ces compagnons olfactifs m’ont réellement aidés, comme un soutien amical face à la dureté de mon statut sérologique.
C’est dans les années 1990 que j’ai découvert la marque qui allait devenir ma référence pour toujours. À quoi bon chercher un parfum moderne quand (presque) tout a été inventé il y a déjà longtemps ? Dans la boutique à Saint Germain-des-Prés qui distribuait Santa Maria Novella, je ne savais tout simplement pas quoi choisir. La beauté des flacons d’eau de toilette, tous identiques, l’histoire multi-centenaire de la marque, l’utilisation des matières naturelles traditionnelles, tout me séduisait. C’était le parfait équilibre du parfum oublié et pourtant préservé, protégé. Une fois par an, je parvenais à rassembler ce qui était pour moi un prix élevé (de l’ordre de 500 francs à l’époque, soit 80 euros) pour acquérir Acqua di Cuba, Melograno, Patchouli, Opoponax. Grâce à Santa Maria Novella, j’ai ensuite également découvert Colonia d’Acqua di Parma, avec son flacon parfait, à la typographie indémodable. Par ailleurs, au même moment, j’ai traversé une longue période Féminité du Bois, alors de Shiseido, ce qui m’a naturellement dirigé vers Serge Lutens, qui est pour moi le degré ultime du sex-appeal en flacon. Je n’osais même pas entrer dans sa boutique du Palais Royal. Les parfums étaient parfois une passion frustrée, impossible car trop chère.
C’est avec les années 2000 que je me suis mis à détester les créations modernes. Le basculement vers des senteurs plus chimiques, les nouveaux flacons trop commerciaux, l’enjeu plus que jamais financier de ce segment de la mode et la surabondance d’eaux de toilettes atroces qui ont fini par créer un mouvement de rejet, notamment visible sur les applications de rencontre, avec le critère « no perfume ». Depuis 2002, je suis parti vivre à la campagne, ma vie est dirigée par la décroissance, et les prix démesurés des parfums me font un peu honte.
Mais je suis toujours curieux. C’est ainsi que j’ai découvert il y a quelques mois, lors d’un voyage à La Réunion, deux eaux de toilette dans un magasin d’artisanat local. Entre les chapeaux en paille qui ont inspiré Chanel, les bijoux et les drapeaux de l’île, j’ai débusqué la lotion Pompeia et l’Eau de Cologne des Princes de L.T. Piver, parfois utilisées lors des cérémonies traditionnelles créoles. Ce fut un autre coup de foudre, alimenté par un prix très abordable. Qui peut aujourd’hui se vanter de trouver une eau de toilette classique à 10 euros ? Le lendemain, mes amis et amies Réunionnais ont remarqué l’ancienneté des senteurs. « Tu sens le tonton ! » se sont-ils exclamés, comme une moquerie gentille qui leur rappelait les personnes âgées de leur enfance. La boucle était bouclée. À 64 ans, j’avais retrouvé le confort et le plaisir d’un sillage léger, démodé, et pourtant délicieusement moderne, surtout si on aime revisiter l’idée de parfum de mouchoir pour gentleman. Avec ses flacons tout simples et ses bouchons aux allures de bakélite, ses étiquettes du siècle dernier, j’avais trouvé un équivalent français à Santa Maria Novella. En beaucoup moins cher.
Visuel : Didier Lestrade enfant, à Chiffa, Algérie © Archives Didier Lestrade






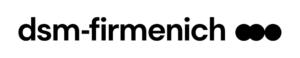

Commentaires