Cette publication est également disponible en :
English
Fumet appétissant ou effluves dérangeants : comme la chair animale elle-même, son odeur suscite le désir aussi bien que le dégoût. À l’occasion de la Journée internationale sans viande ce lundi 20 mars 2023, nous vous proposons, à défaut d’en consommer, d’en humer les exhalaisons à travers cet article de Guillaume Tesson, originellement publié dans Nez, la revue olfactive #07 – Sens animal.
Sous-sol du magasin Lafayette Gourmet, à quelques mètres de l’Opéra de Paris. La boucherie-restaurant d’Yves-Marie Le Bourdonnec, avec son alignement de trains de côtes de bœuf, de joues, de T-bones et de rumstecks, c’est d’abord cinquante nuances de rouge. Très vite, le lieu se démarque aussi par l’odeur qui en émane. Difficile à définir, elle évoque un mélange corsé de foin et de fauve. Et les étals de charcuterie et de fromage alentour n’y sont pour rien. « Ce que vous sentez, c’est la viande maturée », sourit Le Bourdonnec, l’un des bouchers les plus médiatiques de France – et le plus cher. Sa côte de bœuf Salangus de chez l’éleveur Samuel Fouillard, maturée quatre-vingt-dix jours, est affichée à 150 euros le kilo. La wagyu « The Big Boy » s’envole à 240 euros.
L’artisan nous a donné rendez-vous un vendredi à 13 heures, pour le déjeuner. Lorsque la planche de charcuterie de bœuf arrive, mes narines sont soudain saturées par le puissant bouquet d’étable provenant du salaté, une spécialité de macreuse frottée à l’ail et couverte de sel, puis placée dans un sarcophage d’herbes. Les papilles confirment, en écho, ce côté « écurie » : c’est gras, fort, presque dérangeant mais étrangement addictif. Sur le même registre, l’entre côte grillée exhale des accents de foin et de thym. Le goût, prononcé, rustique, révèle des notes de noisette et presque de… fromage. « C’est une pièce maturée soixante jours, explique notre boucher. À titre de comparaison, la viande de supermarché est vendue au bout de dix jours, tout au plus. La maturation accentue les arômes et apporte de la tendreté. Elle se pratique uniquement sur les carcasses les plus grasses. Toutes les races ne sont pas éligibles. »
Suspendus en chambre froide, ces grands morceaux de bœuf appelés aloyaux – constitués de la partie lombaire de la bête, entre la dernière côte et le sacrum, et compre nant les parties les plus nobles comme le filet, le fauxfilet et le rumsteck – s’affinent dans une atmosphère ventilée à l’hygrométrie très surveillée. La structure des muscles se modifie sous l’effet des enzymes ; les tissus perdent beaucoup d’eau, jusqu’à 50 %.
Thym et foin
Pour Jean-Martial Lefranc, rédacteur en chef du magazine Beef !, qui a classé l’une des pièces travaillées par Le Bourdonnec parmi les « dix meilleurs steaks du monde », « la maturation est une esthétique qu’on peut comparer à l’affinage des fromages ou au vieillissement du vin. Ce n’est ni meilleur ni moins bon, c’est avant tout intéressant. Et cela nous ramène à notre rapport aux bactéries et à la fermentation. Le retour à ces pratiques est aujourd’hui fondamental dans la recherche de nouveaux goûts. Et l’odeur fait partie de la dégustation ».
Chez Yves-Marie Le Bourdonnec, la catégorie Classique intègre des viandes maturées soixante jours et la Premium jusqu’à cent vingt jours. « Je me sers de mon nez pour estimer le potentiel de vieillissement des aloyaux. Chaque lundi midi, dans mes ateliers de la Villette, je réchauffe mes mains en les frottant, puis je masse le gras qui recouvre le dos des carcasses. Si mes paumes sentent bon le thym et le foin, c’est le signe d’un excellent potentiel de maturation », explique l’artisan.
Tout au long de la maturation, le nez traque tout relent acide, qui alerterait que « le pourrissement puis la putréfaction ne sont pas loin ». Les émanations accompagnant ce processus sont dues aux bactéries qui dégradent les protéines et le glycogène contenus dans les tissus. Il se dégage alors du dioxyde de carbone, de l’ammoniac et du sulfure d’hydrogène… Des effluves particulièrement repoussants, fétides et soufrés, proche de ceux que l’on peut percevoir en ouvrant le film protecteur d’une barquette de volaille crue dont la date limite de consommation aurait été atteinte ou dépassée.
Au bout du fil, Arthur Le Caisne, auteur du Manuel du garçon boucher (éd. Marabout, 2017), est formel : la viande fraîche ne sent presque pas. C’est le gras qui conduit les odeurs. « Celui d’un bœuf élevé dans un champ aura une teinte un peu jaune, grâce au carotène contenu dans l’herbe. » L’alimentation joue en effet un rôle essentiel. L’herbe grasse du printemps confère à la viande des saveurs florales et herbacées ; le goût du foin de l’hiver se retrouve dans celle des bovins abattus à cette période, aux côtés de notes plus corsées, plus animales. Quant au parfum alléchant du morceau en train de griller ou de rôtir, il est dû aux fameuses réactions de Maillard, du nom du médecin français qui les a étudiées. « À la cuisson, les sucres et les acides aminés [que l’aliment contient] se lient entre eux, créant des molécules très odorantes et qui ont beaucoup de goût. Plus la température augmente, plus l’odeur est forte et délicieuse », résume Le Caisne.
Les yeux fermés
Ce fumet appétissant, je le retrouve quelques jours plus tard en poussant la porte du Beefbar Paris, rue Marbeuf – cela ne s’invente pas. Il reste cependant discret, à l’image du décor et de l’éclairage, tamisé. « Je préférerais devenir aveugle qu’anosmique », avoue le chef exécutif, Thierry Paludetto, qui sert des pièces de grande qualité et de provenance variée : Black Angus du Kansas, wagyu australien, bœuf de Kobe certifié, veau de lait des Pays-Bas… Ses restaurants (le concept existe également à Budapest, Cannes, Dubaï, Hongkong – qui affiche une étoile au guide Michelin –, Luxembourg, Mexico, Monaco et Mykonos) ne proposent pas de morceaux maturés. N’empêche, il reconnaît les yeux fermés son bœuf de Kobe, « qui sent le beurre et la noisette », et les viandes d’Argentine nourries à l’herbe de la pampa : celle-ci leur donne « un parfum proche du gibier, celui du sang prononcé, avec des notes herbacées, de persil, de romarin et de thym ». Intarissable, Thierry Paludetto l’est tout autant sur ses souvenirs de cuisine avec le chef Alain Senderens, dont il connaît encore par cœur la recette du lièvre à la royale. Les saveurs et le fumet redoutablement corsé de ce monument de la gastronomie française, servi en roulade ou compoté selon les versions, sont inoubliables pour qui l’a goûté un jour… Les arômes de gibier, de foie gras et de cognac sont si puissants que l’haleine de celui qui s’en régale peut vite incommoder son entourage ! « Senderens n’achetait que des lièvres femelles d’Alsace qui se nourrissaient de baies de genièvre, dont le parfum imprégnait la chair. Le sang, le cœur et les poumons étaient intégrés à la recette. Le lièvre dépecé dans la cuisine dégageait une odeur puissante pendant des heures », se rappelle le chef. Au Beefbar, en cuisinant du bœuf de Kobe, il rend hommage à un plat plus simple, associé pour lui à des souvenirs plus intimes : le ragoût de bœuf arrosé de vin que préparait son père, italien, pour en farcir de savoureux raviolis. « Une senteur inoubliable, celle de mon enfance. »
L’enfance – passée, en ce qui le concerne, dans les séchoirs à saucisson aux effluves fauves –, a également déterminé la vocation du charcutier Gilles Verot, vice-champion du monde 2011 de pâté en croûte. « J’ai voulu faire ce métier pour l’odeur de la viande en salaison qui reste sur les mains. » Chez lui, la chair sait se montrer riche en goût, mais plus discrète pour le nez. « Toutes nos recettes sont réalisées dans une atmosphère réfrigérée à 6 °C, ça ne sent pas grand-chose », s’excuserait-il presque, en ouvrant la porte de ses ateliers d’Ivry-sur-Seine, où il s’apprête à préparer un oreiller de la belle Aurore, le roi des pâtés en croûte. Ce monument, théorisé par le gastronome Brillat-Savarin, pèse 15 kg et se compose de couches de farce, de truffe ainsi que de dix viandes différentes : faisan, biche, cochon, ris de veau, colvert, perdreau, pintade, foie gras de canard… Celles-ci révéleront leur fumet, subtilement truffé, une fois la tranche servie tiède. Mais pendant la cuisson c’est surtout le parfum de la pâte qui envahit la pièce. Gilles Verot ne réalise cette recette, qui nécessite six heures d’élaboration et trois à quatre heures de cuisson, que quatre fois par an. Contrairement aux boucheries d’Yves-Marie Le Bourdonnec, ses boutiques, où sont exposés pâtés et terrines, conservent une odeur « neutre ». « L’appel à la gourmandise, avant tout visuel, passe par les narines quand on apporte du boudin chaud, des rillons ou des tourtes au fromage sortant du four », nuance le charcutier.
Coulisses et polémiques
Avec ce travail de sublimation de la matière première, qui s’apparente pour certains à de l’art, on semble loin, très loin, des effluves pourtant indissociables du travail de la viande en amont. La mort et les exhalaisons qui l’accompagnent, Yves-Marie Le Bourdonnec les connaît bien, lui qui a donné un coup de main dès la classe de troisième à l’abattoir municipal, en Bretagne. « J’y allais le mercredi et pendant les vacances, se souvient-il. Je ne dirais pas que les odeurs y sont dégoûtantes. Elles sont marquantes. Il y a celle des animaux qui arrivent mouillés et suants, les excréments, le sang, très ferreux… Quand j’épilais les cochons, j’aimais bien le parfum du crin grillé. Je visite encore des abattoirs aujourd’hui : ce sont devenus des cliniques, ça a perdu de son charme. L’odeur du sang a disparu. Mais ils n’ont pas réussi à enlever celle de la panse quand on l’ouvre. C’est épouvantable, ça. Un remugle gastrique très fort. Un abattoir, maintenant, ça sent l’andouillette chaude, à l’extrême. »
Ces coulisses, auxquelles on préfère ne pas penser lorsqu’on découpe son steak, alimentent depuis quelques années les polémiques autour de l’industrie agroalimentaire et de la question du bien-être animal. En témoignent les vidéos clandestines régulièrement divulguées par l’association antispéciste L214, qui milite pour l’abolition de l’élevage.
C’est justement pour recontextualiser ces débats que Bruno Laurioux, professeur d’histoire du Moyen Âge et de l’alimentation, a codirigé avec l’archéologue Marie-Pierre Horard l’ouvrage Pour une histoire de la viande (éd. Presses universitaires de Rennes, 2017). On y apprend notamment que le flexitarisme, qui consiste à manger moins souvent des protéines animales, a déjà été la norme par le passé. Ou que la maturation des pièces de bœuf, avant de régaler des amateurs CSP+ urbains et éclairés, était pratiquée au Moyen Âge et s’est perfectionnée avec l’apparition de la réfrigération à la fin du XIXe siècle. « L’une des raisons pour lesquelles la viande pose problème, c’est que les gens ne savent pas très bien ce que c’est, explique l’historien. Depuis que l’homme a éloigné la mort – les cimetières et les abattoirs – des villes, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe , tout se déroule à l’extérieur, on a détourné les yeux de tous ces procédés. Quand on ne sait pas ce qui se passe, l’angoisse s’installe. En outre, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’industrialisation a généralisé la viande toute rouge, pleine de sang et d’eau – sans odeur. »
Pour Bruno Laurioux, « il est fondamental que les gens se réapproprient leur alimentation, en posant des questions à leur boucher, en sentant les produits qu’il propose. L’expertise et la connaissance passent par les sens, comme l’odorat ». Jean-Martial Lefranc, de Beef !, assure qu’« on crée de la proximité et de la complicité avec les autres quand on partage un savoir ou une technologie ». Pour lui, « au-delà de la part de prédation qui pourrait subsister en nous dans ce goût pour la viande, le sens olfactif, qui lie les amateurs autour d’un beau morceau cuisiné, reste un phénomène culturel et social fondamental ».
Cet article est originellement paru dans Nez, la revue olfactive #07 – Sens animal.
Visuel principal : Tomás Yepes, Still Life with Birds and Hares (détail), XVIIe siècle. Source : Wikimedia Commons






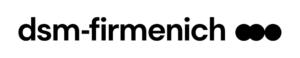

Commentaires