Le lien qui unit la mère et son nouveau-né passe essentiellement par l’odorat, comme le rappellait Eléonore de Bonneval dans un précédent article. Mais il n’a pourtant parfois rien d’une évidence : si l’odeur du bébé attendrit et fascine, elle peut aussi mettre un certain temps à prendre sa place. À l’occasion de la fête des mères, la compositrice de parfums Céline Ellena partage dans un texte émouvant son expérience olfactive de la maternité, entre odeur primaire et nuits apaisées.
Des mois d’attente. Des heures de travail.
Jambes en l’air et mollets entravés hors des étriers par des sangles de fortunes, car je suis bien trop grande pour cette table, j’attends sa venue.
Lors des moments de répit, ma tête, en équilibre sur le bord du matelas, bascule un peu en arrière et, le regard vide, le souffle court, je contemple le plafond fané, jaune pipi délavé. Je deviens oreilles : babil du personnel médical qui veille et vaque à son affaire, sorte de mélopée lounge sécurisante. Et narines : remugle confus des corps, des fluides et des antiseptiques, sorte de court-bouillon rassurant. Une émanation moite, douce-amère comme la fleur des troènes au printemps. Un peu cra-cra, comme un immense doudou usé jusqu’au kapok. Sang. Sueur. Salive. Les trois senteurs de l’animal. Comme moi, à cet instant de l’ultime poussée. Respiration bloquée, cabrée dents serrées, j’éprouve purement l’effort de mes veines tendues à claquer. Geste récompense, le nouveau-né est déposé délicatement sur mon ventre mou, son minuscule visage contre ma poitrine. Mon nez affleure le sommet de son crâne humide. On se renifle. Il me reconnaît. Moi, pas. Je suis vidée, et son odeur me dérange. Pourtant, je suis heureuse qu’il soit enfin sur ma peau. Auparavant, il a barboté au sein de mon odeur cachée : un bouquet visqueux, ancien et sucré, composé de fibres et sédiments, de globules et molécules, qu’il connaît comme sa poche. Son odeur, vierge et salée qui prend vie sous mon blair, est une étrangère. Je suis indisposée par cet arôme chaud qui soudain m’envahit et m’étourdit de fatigue. Je souhaite disparaître sous ma propre chair. Aucune personne présente dans cette pièce ne peut imaginer que machinalement, j’analyse le relent familier et réconfortant des fluides qui accompagne la naissance, et le sépare de celui, neuf et déroutant, de mon enfant. Lorsque je détourne la tête, la sage-femme se méprend sur mon geste et emporte le tout petit avec des mots rassurants, tout en m’expliquant qu’il va sentir bien « meilleur » après son premier bain, lorsqu’on lui aura retiré tous ces fichus résidus issus de ma matrice.
Une heure plus tard, le bébé nu a disparu. Bonnet et body lessivés aux muscs macro, peau savonnée au petit grain et antiseptique à la sauge ont définitivement ordonné mon enfant dans la case petit humain en bonne santé. Mon rejeton sent le propre et tout le monde est content. Sauf moi. Car sous le vernis, je sens son odeur primaire. Celle du liquide amniotique et la sienne en devenir. La trace invisible surligne de manière tangible ma responsabilité. Je ne suis plus seule. Je deviens son odeur…
La peau de mes amants n’a jamais été un problème. Nos effluves, étroitement enlacées, frottées et chauffées jusqu’à créer un nouveau composant, m’étourdissaient, m’imprégnaient et pénétraient mes narines jusqu’au fin fond de mon cortex. Cependant, la vague refluait toujours et, repue, je redevenais moi-même… plus quelques souvenirs.
De retour à la maison, rien n’y fait. Même lorsque le bébé est loin de moi, dans la pièce d’à côté ou dans les bras de la famille, quand je cuisine ou me douche vigoureusement, le tatouage odorant ne me quitte plus. Inscrit sur mon corps et dans mon cerveau, l’effluve du nourrisson me dévore et je recule, déstabilisée. Cordon ombilical invisible et exigeant, je m’agace de ce remugle accaparant. Les premiers jours après la naissance, je me sens coupable de ne pas accepter l’odeur. Déni d’amour et d’attachement ? Alors, plutôt que d’escamoter ta signature olfactive sous une cloche forgée des diverses lotions et lessives parfumées, j’ai mis à nue nos peaux et accueilli ta senteur nuit après nuit, lorsque, comme seuls au monde, je t’allaitais dans un demi-sommeil sillonné de brume. Je me laissais balloter par mes émotions en vrac et, le nez abandonné sur ton minuscule crâne chauve, je tentais de conserver le cap, ancrée sur cette nouvelle senteur que je tenais au cœur de mes bras. Paumée, perdue dans mon rôle d’apprentie maman le jour, je trouvais enfin la paix et la sécurité au creux de la nuit, ton odeur crochetée à mes pensées vagabondes. En cherchant bien dans ma mémoire, j’ai encore, dissimulé dans un tiroir, sous la pile d’odeurs utiles à mon métier, un reliquat de ta sueur exsudée pendant l’effort de l’allaitement. Un accord qu’aucune formule ne peut illustrer.
Céline Ellena, Spéracèdes, le 30 mai 2023
Visuel principal : Elizabeth Nourse, La Mère, 1888. Source : Wikimédia commons






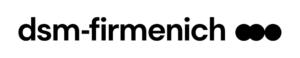

Commentaires