Au menu de cette revue de presse, des artistes au service des marques, la parfumerie au musée, de la propagande arôme vanille, des fragrances pour résister aux normes genrées, un coup de nez aux paysages olfactifs et une initiative de déminage sur les terres somaliennes de l’encens.
Depuis les flacons dessinés par Dali pour Schiaparelli jusqu’aux campagnes publicitaires de Chanel signées Jean-Paul Goude, les maisons de parfum se sont depuis bien longtemps associées les services d’artistes dans le but de promouvoir leurs créations. Aujourd’hui, les collaborations entre marques et créateurs visuels ou musiciens continuent de proliférer, donnant naissance à des propositions à la frontière entre l’art et le marketing, répondant à un besoin croissant de singularisation sur un marché de plus en plus encombré. Et cela semble fonctionner puisque la presse se fait, nous allons le voir, le relais de ces associations créatives aux tonalités diverses. Nous apprenons ainsi dans 10 Magazine que Bvlgari a récemment fait appel à l’artiste et pionnier de l’art numérique généré par intelligence artificielle Refik Anadol pour réinterpréter visuellement Tygar (2016), l’un des parfums de la collection Le Gemme. Comme le note l’article, il s’agit d’une seconde collaboration entre la marque et l’artiste d’origine turque, trois ans après l’expérience immersive Serpenti Metamorphosis présentée à la Saatchi Gallery. Grâce à des algorithmes génératifs, Anadol a cette fois-ci transposé la formule du parfum en données numériques puis en visualisations mouvantes, hypnotiques et colorées. Cette « peinture de données » – selon l’expression de l’artiste – vient orner le flacon du parfum lui-même, comme une manière de rendre visible l’invisibilité de son contenu avant même la première pulvérisation.
Selon Hypebae et Xmag, la maison Loewe Perfumes s’est quant à elle tournée vers Ignasi Monreal, artiste espagnol connu pour sa fusion de techniques picturales classiques et numériques, afin de créer une série de visuels inspirés par les notes de cinq bougies de la marque aux senteurs végétales : Ivy, Tomato, Marijuana, Beetroot et Oregano. À travers des natures mortes surréalistes, l’artiste compose un univers onirique où le motif du feu se mêle à des couleurs riches et texturées. Plutôt que de représenter littéralement les ingrédients, ses œuvres « cherchent à exprimer la sensation ressentie par chaque parfum, créant ainsi un récit visuel immersif. » Le processus de création de chacune de ces peintures numériques est par ailleurs accessible sur la page Instagram de la marque, sous forme de timelapses autorisant un autre regard sur le travail de l’artiste.
Pour sa part, Comme des Garçons embrasse une autre approche en s’associant au compositeur germano-britannique Max Richter pour une création olfactive évoquant l’atmosphère de son studio et son univers sonore, comme le détaillent Crash Magazine et Le Monde. Cette eau de toilette intitulée Max Richter 01 serait née d’un dialogue entre le musicien et sa partenaire et collaboratrice, la plasticienne Yulia Mahr. Créée en collaboration avec le parfumeur Guillaume Flavigny et le directeur de la création de la marque, Christian Astuguevieille, la fragrance se compose de notes de cade, de cumin, d’ylang ylang, de poivre noir, de baies de piment, de tagète, de cèdre, de vétiver et de patchouli pour évoquer à la fois la table d’harmonie d’un piano, la colophane d’un archet de violon et les bandes magnétiques employées pour les enregistrements.
Si les marques redoublent d’inventivité pour associer leurs sorties au monde de l’art, c’est aussi au sein des musées que s’orchestre le rapprochement entre création artistique et parfumerie. À Paris, le parfumeur Francis Kurkdjian sera bientôt au centre d’une rétrospective d’envergure au Palais de Tokyo, « Parfum, sculpture de l’invisible », à découvrir du 29 octobre au 23 novembre 2025. Harper’s Bazaar annonce ainsi un parcours multi-sensoriel et immersif jalonné de parfums, de vidéos d’archives, de « dispositifs futuristes », d’une reconstitution du bureau du parfumeur et de diverses collaborations artistiques, anciennes (comme celle avec Sophie Calle) ou plus récentes (notamment avec l’artiste Yann Toma). Les visiteurs seront guidés dans cet ensemble par « une allée semée de pétales de roses en porcelaine, subtilement parfumés » et réalisés en partenariat avec la Manufacture de Sèvres. En mettant à l’honneur la parfumerie à travers certaines des créations les plus emblématiques du parfumeur – comme Baccarat Rouge 540 – mais également d’autres formes de créations olfactives pensées hors de l’industrie, l’exposition devrait permettre d’envisager les multiples manières dont peuvent aujourd’hui se rencontrer, voire fusionner, l’art et le parfum, mais aussi peut-être de s’interroger sur l’entremêlement croissant entre art, divertissement et… marketing.
Une autre proposition muséale de grande ampleur occupe également l’actualité de cet été : à Guangzhou, vient d’ouvrir le Xuelei Fragrance Museum Selon les sources officielles de la ville, le bâtiment de six étages et plus de 7000 mètres carrés abrite à la fois des espaces d’exposition, un jardin aromatique, des commerces, une école de parfumerie, un institut de recherche, des bureaux de l’entreprise Xuelei Cosmetic et est « appelé à devenir un nouveau repère pour la culture et le tourisme olfactifs ». Les visiteurs y découvriront un parcours historique, un segment dédié aux techniques et aux matières premières, une salle entière consacrée aux synesthésies (ou plutôt aux correspondances transmodales !) ainsi que des ateliers de création, le tout ponctué de nombreux dispositifs olfactifs interactifs. Comme le rapporte Perfumer and Flavorist, le projet a aussi été pensé par l’entreprise chinoise pour devenir « un catalyseur d’innovation pour le secteur » et offrir « une plateforme pour le développement des talents, l’innovation technologique et les échanges universitaires ».
Si certains parfums entrent au musée, d’autres, en revanche, semblent plutôt destinés à une vitrine du kitsch… politique. C’est notamment le cas des dernières créations de Donald Trump, qui a fait les choux gras de la presse internationale avec le lancement de Victory 45-47, référence directe à ses deux mandats présidentiels. Le flacon, surmonté d’une statuette dorée à son effigie (d’un goût pour le moins discutable), est proposé au prix de 249 $ (environ 211 €), en version fougère pour homme et gourmande pour femme. Le mot d’ordre ? « Victoire, force et succès. » Comme le souligne Vanity Fair, plus qu’un simple parfum, « l’objet est pensé comme un symbole, une relique, un totem MAGA ». Trump n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai, puisqu’il avait déjà commercialisé un parfum nommé Fight, fight, fight après la tentative d’assassinat à son encontre en 2024. Ses nouvelles créations cependant sont loin de faire l’unanimité : certains jugent les parfums mauvais, peu mémorables, trop chers et bling bling, tandis que d’autres se désolent de la démarche même. Et quand la critique de parfum rencontre la politique, fusent forcément quelques formules bien senties : « Aussi décevant que son mandat, incapable de tenir une seule promesse » lit-on par exemple sur Fragrantica.
En Russie également, l’ultra-patriotisme s’exprime et se promeut à travers des produits parfumés. D’après le site Euronews, une entreprise russe propose désormais sur le site de vente en ligne Wildberries des bougies parfumées « made in Russia » à l’effigie de Vladimir Poutine, sobrement nommées Arôme Poutine Black Vanilla et Arôme Poutine Dark Amber. Le même fabricant propose d’autres créations aux noms plus évocateurs encore, tel que Symbole de l’Empire Russe, Soutenons les nôtres ! ou encore Arôme de Patriotisme, vendues environ 546 roubles (soit environ 6 €). Ces bougies – dont la mèche de bois est supposée imiter le crépitement d’un feu de cheminée – promettent de diffuser leur parfum en une trentaine de minutes afin de créer une atmosphère « relaxante » ou « romantique ». Ce qui amène le journal The New Voice of Ukraine à ironiser : « rien n’exprime mieux le romantisme que de commémorer une invasion dans une ambiance chaleureuse. » Entre cette propagande façon bougie à la vanille et le marketing de soi dopé aux bois ambrés du président américain, le culte de la personnalité a encore de beaux jours devant lui…
Si la propagande passe par le nez, et puisque pouvoir et parfum ont depuis longtemps partie liée, la lutte peut, elle aussi, s’incarner dans des formes olfactives. C’est ce qu’analyse Lottie Winter pour l’édition britannique de Marie Claire dans un article intitulé : « The Rise of Unlikeable Fragrance: How Women Are Reclaiming Perfume as Power ». Longtemps cantonné à la séduction et dicté par des normes genrées, le parfum féminin connaîtrait aujourd’hui un tournant avec l’essor d’une nouvelle catégorie de fragrances dites « difficile à aimer », brutes, étranges, voire dérangeantes, adoptées par une génération de femmes en quête de puissance et d’affirmation de soi plutôt que d’érotisme et de conformité. Exit les vanilles sucrées, les bouquets floraux et les parfums de peau proprets, place aux « parfums fumés, nauséabonds, suintants et, oui, un peu dégoûtants ». Comme le souligne le parfumeur Christophe Laudamiel cité dans l’article, « la parfumerie traditionnelle oublie le bizarre et le laid » au profit de normes dépassées. Mais une autre parfumerie est en train de voir le jour, plus artistique et plus libérée, une parfumerie qui serait, selon la journaliste, une manière de déstabiliser, de provoquer, de résister. Plus qu’une tendance, « une réappropriation. »
Résister, c’est peut-être aussi un peu ce à quoi nous invite Juliette Krier, « cueilleuse d’arômes » installée dans la Gâtine tourangelle dont Socialter fait le portrait dans son 70e numéro. Cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales, la jeune femme fait partie de « ces personnes pour qui connaître, c’est sentir ». Or il suffit selon elle d’avoir le nez bien disposé pour se rendre compte des mutations des paysages olfactifs « naturels » qui s’opèrent sous l’effet du changement climatique. Les plantes dont elle prend soin et qui composent ses tisanes et mélanges culinaires tendent en effet à gagner en puissance odorante, « à cause du stress hydrique ». Les chaleurs croissantes, le manque d’eau et la raréfaction des épisodes de gel bouleversent le métabolisme des végétaux dont les émissions se modifient. Or ces altérations, nous rappelle l’article, ne sont pas sans conséquences sur les innombrables communications olfactives intra et inter-espèces qui trament les écosystèmes. C’est pourquoi la biologie de la conservation – mais aussi d’autres disciplines – s’empare désormais des questions de pollutions olfactives, de mutations et d’appauvrissement des paysages olfactifs afin de mieux comprendre l’influence des activités humaines sur les échanges volatils essentiels à la survie de nombreux êtres vivants et auxquels nous pourrions certainement, à la manière de Juliette Krier, prêter une attention plus consciente.
Le média en ligne EntrepreNerd nous apprend d’ailleurs comment la compréhension du langage chimique des insectes pourrait révolutionner les pratiques agricoles. Ricardo Ceballos, chercheur en écologie chimique à l’INIA Quilamapu au Chili, y rappelle que le système olfactif des insectes est extrêmement sophistiqué et essentiel à leur survie. Or le changement climatique, mais également l’agriculture moderne, en homogénéisant les paysages (notamment olfactifs), en introduisant des espèces exotiques et en multipliant pesticides et fertilisants, perturbent les milieux chimiques dans lesquels les insectes évoluent. Les écosystèmes s’appauvrissent, les « ravageurs » prolifèrent, entrainant un usage encore plus grand de produits « phytosanitaires » et le cercle vicieux se poursuit. L’écologie chimique ouvre alors de nouvelles pistes, comme l’utilisation de composés aromatiques végétaux ou de phéromones pour attirer les pollinisateurs ou au contraire contrôler les populations considérées comme nuisibles. « Au Chili, nous utilisons déjà cette méthode pour lutter contre la teigne de la vigne (Lobesia botrana), en saturant l’air de phéromones qui désorientent les mâles et les empêchent de trouver les femelles pour l’accouplement » explique le chercheur.
Si ce type d’approches peut évidemment s’avérer particulièrement bénéfique pour l’avenir de l’agriculture, s’intéresser aux émanations odorantes propres à certaines espèces mais aussi aux « assemblages » de diverses espèces ne devrait pas être l’apanage des cultivateurs et cultivatrices. Cette attention sensible au vivant est justement ce qu’encouragent les projets du studio français Baudequinmaldes, mis à l’honneur cet été par le site Design Boom. Parmi la série d’installations imaginées par Anne-Charlotte Baudequin et Mathieu Maldes sur le site du Petit musée des plantes sauvages comestibles de Berrac, dans le sud de la France, plusieurs mettent en valeur les parfums du paysage local. Le Moulin à Senteurs, par exemple, est un dispositif composé d’un tube en plexiglas et d’une hélice en argile rouge conçu pour faire remonter jusqu’au nez des promeneurs un échantillon olfactif du site. Une manière d’inciter à porter attention aux êtres dont les odeurs s’épanouissent au ras du sol : bactéries telluriques, mélisse, ache des marais, etc. La Cabane Sensorielle quant à elle, réalisée en pin Douglas et installée sur une étendue de menthe sauvage, invite à un moment de contemplation multi-sensorielle lorsque, les jours de pluie, le chant des gouttes s’écoulant dans la vasque en laiton centrale se mêle aux arômes verts et humides du paysage. « Cette approche conduit les concepteurs à considérer le paysage vécu, imprégné de significations et de sensations qui façonnent notre expérience et notre relation sensible, » explique l’article qui évoque également la Fontaine Végétale pensée par le duo comme une jardinière verticale permettant « d’apprécier pleinement le parfum des herbes cultivées ».
Dans d’autres régions du monde, apprécier les senteurs de la végétation s’avère plus compliqué, voire franchement dangereux. C’est le cas en Somalie où les arbres à encens, au parfum si prisé, poussent en grande partie dans des zones jonchées de mines terrestres depuis les guerres qui ont ravagé le pays. Or d’après le site écossais STV News, un accord vient d’être signé entre Halo Trust, la plus grande organisation mondiale de déminage, et le Royal Botanic Garden d’Edimbourg (RBGE) afin de nettoyer ces terrains minés. Ceci permettra de mener des projets de recherche au sujet des Boswellias somaliens, en évaluant notamment la santé des arbres, en développant des pratiques de gemmage durables sur les populations d’arbres sauvages et en soutenant des initiatives de replantation. Cette collaboration symbolise un double engagement, écologique et humanitaire, en redonnant aux communautés locales la possibilité de tirer leur subsistance de leur milieu naturel tout en retrouvant un environnement plus sûr. Comme l’explique James Cowan, directeur du Halo Trust, il s’agit de bâtir « un avenir enraciné dans la paix, où la terre et ses habitants pourront à nouveau prospérer. »
Visuel principal : © Morgane Fadanelli
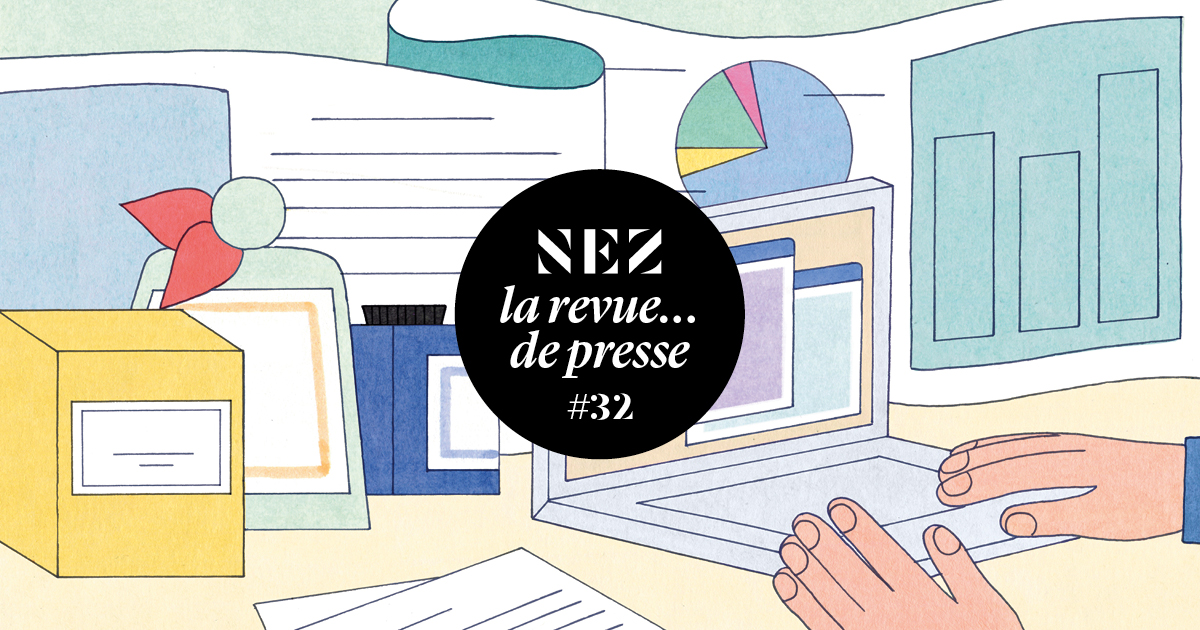





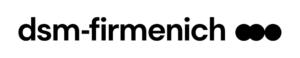

Commentaires