Désireux d’offrir à chacun des éléments de compréhension, les chercheurs Moustafa Bensafi et Catherine Rouby ont publié Cerveau et odorat, comment (ré)éduquer son aux éditions EDP Sciences, qui aborde les questions de l’éducation du nez, de son entraînement, ou encore de la méthodologie scientifique. Un propos dense et passionnant, que nous avons souhaité prolonger.
Est-ce la pandémie de Covid-19 qui a fait émerger l’idée du livre, co-écrit avec votre collègue au CNRL Catherine Rouby ?
Non : l’idée de ce travail date d’il y a trois ans. Catherine Rouby et moi-même recevions de nombreux messages et lettres de patients désespérés, qui souffraient de déficiences olfactives et ne trouvaient aucune information sur leur problème. C’est ce qui a orienté notre travail ; la pandémie a donné une impulsion pour le terminer et le publier.
Nous voulions mettre à disposition de tous des informations pratiques essentielles : montrer comment ce sens fonctionne, et comment les scientifiques abordent les questions non seulement de diagnostic, mais aussi de récupération de l’odorat. Nous avons également publié des fiches pratiques sur le site web, gratuites, qui sont complémentaires au livre.
La recherche semble sur ce sujet à ses débuts. La pandémie a-t-elle été son principal moteur ?
Il y a deux tournants dans la recherche sur l’odorat. Le premier est le Prix Nobel obtenu en 2004 par Linda B. Buck et Richard Axel, pour l’identification des gènes correspondant aux récepteurs olfactifs. Outre l’importance de leurs résultats, l’éclairage que ce prix a apporté au domaine a permis l’émergence de nouveaux laboratoires et une publication plus large.
Le deuxième tournant est l’épidémie actuelle qui, au-delà de la recherche fondamentale, a mis en lumière l’expérience vécue du déficit olfactif. Celui-ci existait bien sûr avant – mais le nombre de personnes touchées a significativement augmenté.
Vous notez que « des mesures aussi simples que l’intensité olfactive, si elles sont obtenues sur un échantillon important et représentatif, pourrait servir d’indicateur de la maladie Covid-19 dans la population générale » : pensez-vous que l’auto-évaluation des individus devrait constituer une forme d‘habitude en temps de pandémie ?
L’auto-diagnostic ne doit pas consister à se poser la question : « ai-je perdu l’odorat ou le goût ? », car l’appréciation est trop subjective. Il faudrait cependant, en effet, prendre l’habitude de se demander : « ce que je mange a-t-il changé de goût, ce que je sens a-t-il changé d’odeur ? ». Une telle évaluation est beaucoup plus précise.
Dans quelle mesure l’industrie du parfum est-elle intéressée et financièrement investie dans la recherche ?
La principale source de financement est publique – nationale comme l’Agence Nationale de la Recherche, régionale, ou européenne – ou privée, mais par l’intermédiaire de fondations. Pour le reste, tout dépend de l’objectif visé. Il faut en amont se poser la question de l’impact que va avoir la recherche, et qui peut être divers : industriel, sociétal, économique… La coopération passera ensuite notamment par les Conventions Industrielles de Formation par la Recherche, qui mettent en lien les doctorants et l’industrie.
Reste que l’industrie et les milieux académiques ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde : si certains parfumeurs s’intéressent au fonctionnement de l’odorat – et c’est admirable – ce n’est pas la règle générale, l’industrie du parfum se positionne surtout sur la question de la performance.
Peut-on imaginer qu’accroître, par l’éducation, la sensibilité olfactive de la population, puisse permettre de diminuer les risques de dépression ou de problèmes alimentaires ?
La question de l’éducation est essentielle. Les associations et les laboratoires mettent déjà en place des ateliers olfactifs dans les écoles maternelles, mais manquent de temps et de moyens. La promotion de ces actions est primordiale. Notre rapport aux odeurs est paradoxal : soit on parfume, soit on camoufle ; on est donc constamment dans des situations d’hypo- ou d’hyper-exposition, mais on n’entretient finalement pas assez la normalité, ce que l’on sent dans la vie de tous les jours.
Concernant les bénéfices d’une telle éducation, même si nous ne pouvons pas affirmer qu’il y en ait un sur le bien-être, cela semble être une évidence empirique : sentir le parfum des fleurs au printemps, cela fait du bien. Mais les bénéfices sont encore plus probants dans le domaine alimentaire. Si les enfants arrivaient à parler de ce qu’ils perçoivent lorsqu’ils mangent, ils auraient plus de facilité à assimiler de nouveaux goûts. Car le langage catégorise : parler c’est pouvoir mettre dans une case ; or, en ayant un vocabulaire plus précis, les mets pourraient être rangés ailleurs que dans les cases « j’aime » ou « j’aime pas », permettant d’ouvrir le répertoire alimentaire, ce qui est essentiel pour la santé.
Justement, le rapport entre l’odorat et le langage semble problématique. Ce sens se heurte-t-il à des obstacles physiologiques en particulier, qui en rendent la maîtrise plus complexe, ou est-ce seulement un problème culturel ?
Il faut insister sur un point central : notre cerveau est très plastique. Partant de là, on ne saurait en rester à l’hypothèse selon laquelle l’olfaction présente des difficultés intrinsèques qui l’empêchent d’être objet du langage. En effet, pour parler des odeurs, on évoque notamment la source odorante (odeur de banane), l’effet (appétissant), voire les noms chimiques (acétate d’isoamyle). De ce point de vue, le langage des odeurs peut sembler assez faible.
Mais les descriptions peuvent être bien plus complètes et complexes, comme le montrent les travaux en cours de Marylou Mantel. Il faut accompagner les personnes dans leur description olfactive, à travers une approche dite « neuro-phénoménologique » : non pas décrire l’odeur elle-même, mais ce qu’elle évoque : les souvenirs, les émotions. Par exemple, lorsque l’on fait sentir une note boisée à un enfant, il faut le pousser à développer ses souvenirs : c’est l’odeur du crayon que l’on taille, des meubles du salon…
Le langage olfactif, ainsi relié à la mémoire et aux émotions, sera-t-il nécessairement subjectif ?
Oui, puisqu’il est lié au développement mental de chacun, à son vécu ; mais il y a du subjectif partagé, soit culturellement – pour les Français, le fromage sent bon alors qu’il est difficilement supportable pour les cultures asiatiques – soit universellement : certaines odeurs sont ancrées dans la biologie du système, comme celle du soufre. Celui-ci, dangereux pour l’organisme car pouvant provoquer l’asphyxie ou émanant de corps en décomposition, provoque un signal neurologique qui a un caractère universel.
Vos recherches ont permis de mettre en avant le fait que l’entraînement régulier de l’odorat, pour les personnes atteintes du coronavirus souffrant d’anosmie ou d’hyposmie, améliore la possibilité d’un retour à la normale. Avez-vous des pistes pour expliquer ce phénomène ?
Je voudrais d’abord souligner ce point : l’entraînement améliore les performances, il faut en informer les patients ; mais cela n’aboutit pas toujours.
Pour ce qui est du fonctionnement, on a plusieurs réponses. Car l’entraînement implique trois types de processus : sensoriel, en stimulant le système olfactif ; moteur, reflété par le comportement de flairage qui mobilise différents muscles ; et enfin cognitif, car il fait appel à des ressources attentionnelles et mnésiques. L’hypothèse principale se centre sur ce dernier processus, puisque l’on sait que la mémoire gagne en efficacité avec l’entraînement. Mais cette réponse n’est pas exclusive d’autres pistes, notamment celle concernant les cellules qui permettent la régénération des neurones, lesquelles entrent dans le mécanisme de l’olfaction.
Vous montrez dans votre ouvrage des problèmes de méthodologie dans la recherche, lesquels fragilisent les données, et notamment la détermination d’une variabilité culturelle. Un dispositif de recherche plus international est-il envisagé ?
En passant par la seule auto-évaluation (les questions), les données sont biaisées car l’appréciation est trop subjective. Les tests psycho-physiques (impliquant des mesures de l’activité neuronale) démontrent que la variabilité perceptive est moins importante qu’il n’y paraît.
Mais, même si ce serait souhaitable, il n’y a pas encore de dispositif standard universel, résultant d’un consensus de la communauté de chercheurs, probablement parce que la discipline est encore jeune, et parce qu’une telle entreprise demande davantage de temps et de financement.
Vous évoquez la perspective d’une « prothèse olfactive » : où en est la recherche sur ce point ?
On sait actuellement détecter des odeurs avec des nez artificiels. L’étape actuelle concerne le problème de l’application : comment les intégrer dans la vie des personnes qui ont des déficiences, sous quelle forme, etc. Il n’y a pas de projet de recherche en tant que tel financé pour l’instant, car cela demande de gros moyens ; mais ça ne saurait tarder. On peut imaginer qu’il aboutira dans cinq à dix ans.
Quelle question encore en suspens vous intéresse particulièrement ?
La question de la différence de perception olfactive individuelle, parce qu’elle serait un excellent modèle pour questionner le domaine de la perception en général. En effet, l’olfaction est soumise à une grande variabilité, à la fois individuelle, psychologique, biologique… et mieux cerner l’impact de ces paramètres permettrait de construire un modèle de la perception qui dépasserait le seul champ de l’odorat.






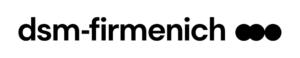

Commentaires