Au menu de cette revue de presse, des odeurs qui font peur, des villes au patrimoine parfumé, des églises à respirer, des artistes et critiques au nez fin, ainsi qu’une multitude d’initiatives traduisant l’heureuse vitalité de la culture olfactive !
Il semble loin le temps où les odeurs ne s’immisçaient que rarement et discrètement dans les pages des journaux. Certaines font aujourd’hui les gros titres… de la presse culturelle ! France Culture nous emmène par exemple dans l’atelier de la designer olfactive Carole Calvez, au Jardin des métiers d’Art et du Design, à Sèvres. Cette dernière, formée à la composition olfactive en 2017, travaille depuis lors avec des artistes et des institutions culturelles, composant « des odeurs » qui n’ont pas vocation à devenir des « parfums » mais plutôt des évocations, des ambiances ou des récits, en somme des moyens d’ouvrir les imaginaires par le prisme de la sensorialité. Ces dernières années, elle a notamment cherché à évoquer l’haleine d’un dinosaure pour l’œuvre Ceci est ton souffle (2023) de l’artiste Anaïs Tondeur ou encore soigneusement associé odeurs et couleurs pour créer, en binôme avec la designer Marta Bakowski, la lampe olfactive Halo (2024). Ses collaborations institutionnelles l’ont également amenée à reconstituer le parfum d’un baume utilisé pour la momification des pharaons, ou encore à imaginer des senteurs pour des lieux historiques comme le Prieuré Saint-Cosme, dernière demeure de Ronsard, ou la villa Savoye, chef-d’œuvre du Corbusier. Au milieu des quelques « 7000 flacons » qui habitent son atelier, Carole Calvez revient ainsi, au micro de Pierre Ropert, sur quelques-unes de ces expériences passées mais aussi sur sa sensibilité de longue date pour le monde des odeurs. Elle évoque également son dernier projet : « donner à sentir le lien entre l’homme et le cheval » pour l’exposition « Des Chevaux et des Hommes » au musée de la Grande Guerre de Meaux.
En ce mois d’avril, Ouest France est également revenu sur plusieurs projets olfactifs dans les champs de l’art et du patrimoine. À Nantes notamment, « Retenir ton odeur », l’exposition personnelle de la plasticienne Julie C. Fortier fait sensation. Depuis le 3 avril ses installations emplissent en effet l’air du Passage Saint-Croix de leurs singuliers effluves. Formée à la composition de parfums il y a une dizaine d’années, l’artiste déploie dans sa pratique une inventivité plastique et olfactive remarquable — d’ailleurs mise en avant dans la monographie publiée par Nez en 2020 — qui parle à la sensibilité des petits et des grands. Depuis les capsules olfactives « givrées » de Le jour où les fleurs ont gelé (2018) jusqu’à l’hypnotique tapis en laine tuftée de Attendu Tendue (2022) en passant par les milliers de touches à parfums noires qui composent Les Intouchables (2018), les œuvres réunies ce printemps à Nantes, tout en évoquant souvenirs, liens et paysages, nous parlent aussi des matériaux odorants eux-mêmes, comme l’explique l’artiste dans l’entretien vidéo publié par le journal. En écho à l’approche multisensorielle de Julie C. Fortier, une seconde exposition, « Nantes, terre de parfums », sera également à découvrir entre le 2 mai et le 7 juin au Passage Saint-Croix. Arnaud Biette et Patrick Sarradin, « descendants de grandes familles de savonniers parfumeurs nantais », ont en effet œuvré à la mise en valeur de ce patrimoine industriel méconnu de la cité des ducs. Quatre parfumeurs nantais des XVIIIe, XIXe et XXe siècles — Sarradin, Biette, Bertin et Roux — seront ainsi mis à l’honneur dans cette exposition organisée en partenariat avec le musée d’histoire de Nantes.
Dans la Sarthe, nous apprend encore Ouest France, une visite olfactive de l’église Saint-Colombe de La Flèche semble avoir été particulièrement appréciée. Organisée par dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire et menée par la guide conférencière Sofia Mazelie, cette expérience visait à faire découvrir différemment le patrimoine local. Les senteurs proposées durant la visite orientaient le regard des visiteurs et visiteuses en fonction des souvenirs et associations propres à chacun et chacune. Pour l’une des participantes, le parfum de la lavande évoquait par exemple la couleur bleue, attirant son attention vers l’azur étoilé de la voûte. Pour une autre, cette même essence suggérait « le soleil » et « quelque chose de joyeux », dirigeant son regard vers les vitraux, en particulier celui représentant la Libération, réalisé par l’atelier angevin Bordereau juste après la Deuxième Guerre mondiale.
Le journal nous emmène également à Courseulles-sur-Mer dans le Calvados, où les ateliers Expolfactive proposent quant à eux d’approcher la création contemporaine par le prisme de l’olfaction. Organisées tout au long des mois d’avril et de mai (puis à nouveau en octobre) par Johan Vitrey-Tardif et Charlène Robin-Maire, co-fondateurs de la parfumerie Poppy récemment ouverte dans le village normand, ces animations invitent participants et participantes de tous âges à découvrir les coulisses de la parfumerie à travers une sélection de compositions olfactives avant d’associer celles-ci aux œuvres picturales et photographiques exposées dans l’espace. Enfin, à Laval, en Mayenne, le Musée d’art naïf et des arts singuliers (MANAS) propose au public en situation de handicap (moteur, mental, visuel ou auditif) de découvrir les œuvres exposées grâce à l’odorat, au toucher et à l’ouïe. Ces visites multi-sensorielles, qui s’inscrivent, nous explique Ouest France, dans le cadre du mois de l’accessibilité, illustrent encore une fois le « tournant sensible » de la médiation culturelle ainsi que l’intérêt grandissant pour l’olfaction au sein des espaces muséaux et patrimoniaux français. Dans le cadre de l’exposition « Aube d’un Eden » visible au MANAS jusqu’en juillet, une œuvre de la peintre Jacqueline Benoit, La Rêveuse (2000), est d’ailleurs également associée à un parfum, créé en partenariat avec Les Jardins de Carbey Hills.
À l’étranger aussi les expositions olfactives trouvent de nombreux échos dans la presse. Artsy revient ainsi sur la dernière exposition d’Otobong Nkanga au Nasher Sculpture Center de Dallas. L’artiste nigériane, qui s’est notamment fait connaître ces dernières années pour ses œuvres monumentales aux effluves d’épices, de terre ou encore de savon, présente ce mois-ci l’installation Each Seed a Body créée dans le cadre du prix Nasher 2025 dont elle est lauréate et qui donne son nom à l’exposition. Amarante, chicorée, cacao, café, genièvre, pamplemousse aubépine, orange, salsepareille, sorgho, yucca et sassafras, la liste des matériaux évoquent, selon l’article, « un garde-manger bien garni ou les ingrédients d’une savoureuse préparation ». C’est cependant par le nez et non par la bouche que les visiteurs et visiteuses, s’agenouillant devant la sculpture serpentine de 16 mètres de long, incorporent la dimension volatile de l’œuvre. Ce « volume sculptural qui s’incruste dans les poumons, dans la mémoire », évoque des histoires de migration et de liens aux territoires. Une autre installation de l’artiste, également olfactive, Carved to Flow, se compose de savons solides — 08 Salt Rock et 08 Red Bond — créés en collaboration avec des savonniers texans. Composés d’argile rouge, de miel vanillé, de sel, de pierre ponce et de graines de pavot, ces pains de savon retracent là-encore une certaine histoire des routes commerciales et des usages de la terre. Comme l’écrit la journaliste : les émanations odorantes des œuvres d’Otobong Nkanga sont avant tout « une invitation à prêter attention » à des récits, des systèmes ou des phénomènes enfouis, oubliés ou négligés et qui, pourtant, témoignent des entrelacs du monde.
En Nouvelle-Zélande (Aotearoa), The Post met en lumière l’exposition collective « The Brood », présentée au Dowse Art Museum à Lower Hutt dans la région de Wellington. L’odeur poignante s’échappant de l’installation Olfactory Ghost (2025) de l’artiste, musicien et parfumeur autodidacte Nathan Taarre semble avoir particulièrement remué le journaliste. Dans une pièce obscure, une dizaine de petites amulettes en céramique sont suspendues en cercle autour d’une unique ampoule, « mais la présence principale dans cette pièce est le parfum » qui « vous enveloppe et vous suit lorsque vous partez. » Ce parfum, perçu comme l’élément le plus angoissant de l’installation, est ainsi décrit : « La fin des temps. L’assèchement. Un corps enfermé dans un sac. Des choses désagréables. » Rien d’étonnant quand on sait que l’exposition tout entière prétend explorer la relation entre le cinéma d’épouvante et l’art contemporain au travers d’une multitude de médiums, tangibles et intangibles. Nathan Taare est en outre habitué des compositions olfactives pour le moins déroutantes, notamment pour sa marque de parfums Of Body qui propose par exemple une fleur martienne, une rose sanglante ou encore une amulette parfumée inspirée par les roussettes à tête-grise d’Australie…
Comme le rapporte la radio RNZ, le lien entre odeur et film d’horreur sera également bientôt au cœur d’un autre événement néo-zélandais : une projection en odorama — ou « smell-o-vision » — de l’iconique Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau. « Les cinéphiles de Wellington ressentiront l’effroi non seulement avec leurs yeux mais aussi avec leur nez » annonce l’article qui revient également sur certaines expérimentations dans le champ du cinéma odorant depuis les années 1920. Cette nouvelle tentative, initiée par Tammy Burnstock, fondatrice de Scented Storytelling et habituée de l’exercice, proposera des cartes en scratch-and-sniff permettant de découvrir dix compositions — signées par l’artiste américain Jas Brooks — associées à divers moments du film de Murnau. Intitulée Nosferatu: A Symphony of Horror – Scent & Sound, la projection sera également accompagnée en live par le pianiste Peter Dasent.
Retour en Europe avec l’exposition « Sensing the Ways: On Touch, Story, Movement, and Song » au Casco Art Institute d’Utrecht (Pays-Bas) qui a attiré l’attention du magazine Metropolis en raison de l’odeur « familière et pourtant étrangère » qui accueille les visiteurs et visiteuses. Celle-ci, envahissant les différents espaces du centre d’art, émane d’une installation de l’artiste AZ OOR, Issaffen n Irifi (Rivers of Thirsts) (2023-2025), « une accumulation d’éléments culturels berbères, africains et arabes » dont une fresque murale réalisée à partir de pigments telluriques (fortement odorants) et des fragments de cire parfumée consumés à la manière d’un encens. Comme dans le cas du compte-rendu de l’exposition « The Brood », le sillage de cette œuvre sert d’ouverture et de fil conducteur à l’article montrant combien la dimension olfactive, autrefois largement ignorée par les critiques d’art, concentre désormais l’attention au point de devenir un élément central de l’expérience.
En Ecosse, le Herald Scotland et The National s’intéressent à l’exposition « Not to Be Sniffed At: An Aromatic History of Sauchiehall Street » qui vient de s’ouvrir à la Edward House de Glasgow. Cette collaboration entre le Glasgow Building Preservation Trust et la parfumeuse Clara Weale — fondatrice de la Library of Olfactive Material — met en valeur l’histoire de cette rue « connue pour sa richesse culturelle et sa vie nocturne animée, à travers ses effluves passés et présents ». Ateliers, conférences, promenades olfactives et autres « sniffaris » (visites guidées par le nez) permettront d’approcher autrement l’héritage culturel de cette rue iconique mais également de s’initier à la chimie des odorants et à la neurobiologie de l’olfaction grâce à l’intervention de chercheurs de l’université de Glasgow.
En Italie, enfin, plusieurs événements récents ont aussi attiré l’attention de la presse pour leur dimension olfactive. Media Key nous apprend que le festival PARMA 360 accueille cette année une exposition d’œuvres à respirer signées par l’artiste Francesca Casale Sensu. « Pianeti Olfattivi » entraîne le public dans un labyrinthe odorant installé au sein la Tour Visconti, un édifice médiéval iconique de la ville de Parme. Dans l’installation principale, divers parfums imprègnent des disques colorés suspendus dans l’espace, évoquant tout à la fois « des corps célestes et des structures moléculaires. » Au niveau inférieur, une seconde installation, Roots pipeline_violet (2025), composée d’un réseau de tuyaux à travers lequel circule une composition olfactive, s’inspire du système racinaire et du parfum délicat de la violette, héritage culturel olfactif de la ville, tandis qu’au deuxième étage, « une table dressée invite le spectateur à reconnaître les arômes et les parfums des aliments et des denrées typiques de la culture gastronomique et vinicole de Parme. » L’artiste présente en outre simultanément un autre série d’œuvres au Parco Sculture Del Chianti, à Castelnuovo Berardenga, en Toscane, sous le titre « Olfactus Loci ». Cette exposition, « inaugurée à l’occasion de la Journée du Parfum promue par l’Accademia del Profumo », comme le précise The Way Magazine, évoque plus particulièrement la palette aromatique des vins de la région du Chianti.
La Design Week de Milan 2025 s’est également distinguée pour la multiplicité des projets olfactifs présentés. Le Journal du luxe rapporte que le couturier-parfumeur Marc-Antoine Barrois y a notamment remporté le prix de la meilleure installation pour Mission Aldebaran, un dispositif immersif et olfactif imaginé avec l’artiste Antoine Bouillot : « une forêt de cordes noires qui débouche sur un champ de tubéreuses blanches en origami », paysage contrasté au milieu duquel flottait le dernier parfum de la marque, signé par Quentin Bisch et nommé d’après Aldébaran, « la 13e étoile la plus brillante du ciel nocturne ». Etapes, saluant « une édition sous le signe du sensoriel », revient en outre sur plusieurs autres projets présentés lors du Salone del Mobile mêlant design et senteurs. L’installation The Second Skin de la marque Aesop dans la sacristie de la Chiesa del Carmine, une église du XVe siècle, utilisait le baume aromatique pour les mains Eleos comme mortier parfumé, créant ce que l’article nomme un véritable « sanctuaire olfactif ». The Oman Collection, issue de la collaboration entre Amouage et — feu — Gaetano Pesce, est également citée par Etapes comme un mélange entre « design olfactif et art totémique ». Présentée dans l’exposition monographique « Una festa per l’architettura: modelli, pensieri e disegni » à la galerie Antonia Jannone, la collection comprend trois sièges sculpturaux — ou « trônes sensoriels » — en résine colorée et aux formes inspirées par la ramification si singulière des arbres à encens que le designer a pu admirer au Wadi Dawkah quelques mois avant sa mort. Comme l’explique le quotidien omanais Muscat Daily, qui est également revenu sur l’étroite collaboration entre Renaud Salmon, directeur artistique d’Amouage, et Gaetano Pesce, l’un des fauteuils de la collection, Oman Chair with Frankincense, mêle au polyuréthane « une autre résine, naturelle cette fois : l’encens », de sorte que « le matériau lui-même porte l’âme résineuse de Wadi Dawkah » et diffuse ses effluves millénaires.
Visuel principal : © Morgane Fadanelli
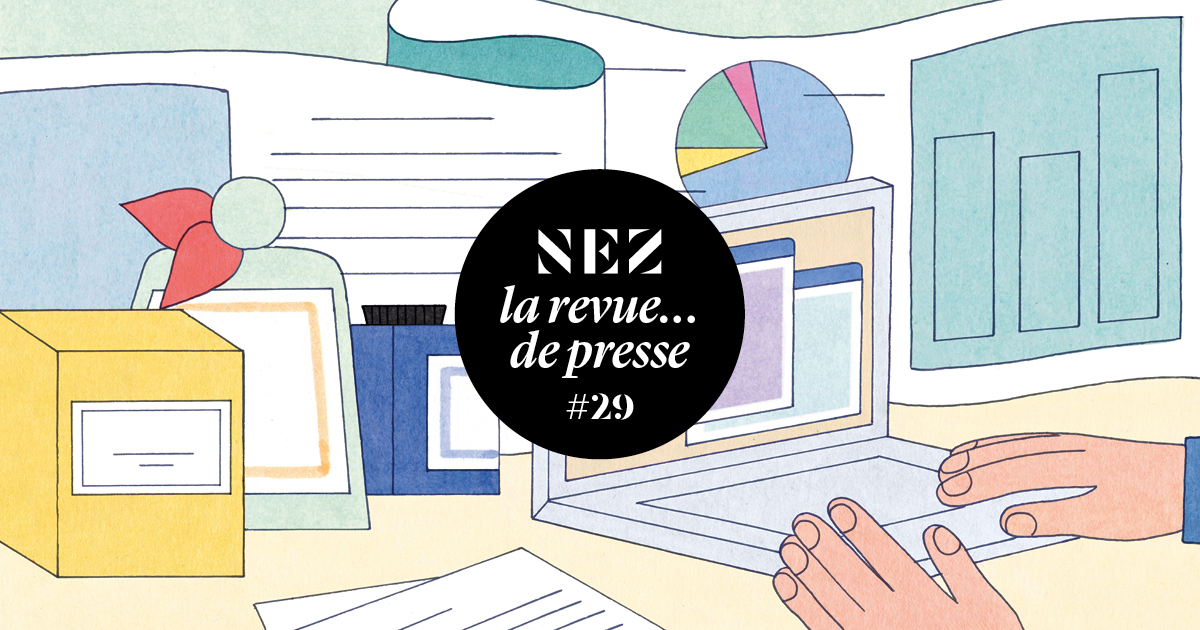





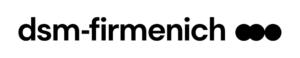

Commentaires