Au menu de cette revue de presse, un microbiote nasal qui fait le lien entre déclin olfactif et cognitif, un gène responsable de l’hyposmie chez les patients atteints de mucoviscidose, et diverses méthodes de test, de développement et d’entretien de notre précieuse capacité à sentir.
Depuis quelques semaines, la presse scientifique et médicale fait la part belle à l’actualité de la recherche en matière de santé et d’odorat. Le 3 mai, le magazine santé 36,9° de la RTS diffusait par exemple un reportage de 45 minutes intitulé Odorat : la santé passe aussi par le nez revenant sur le rôle essentiel de l’odorat chez Homo sapiens et sur les enjeux liés à la perte de ce sens qui demeure « le moins investi par la science bio-médicale ». Le reportage, signé Quentin Bohlen et Jochen Bechler, repose sur des témoignages d’experts pour évoquer le fonctionnement du système olfactif mais surtout en rappeler l’importance tout au long de l’existence, depuis la vie in utero jusqu’à la vieillesse. Le magazine s’interroge : comment notre odorat peut-il être cultivé et que peut-il cultiver en nous ? Nous découvrons ainsi tour à tour à l’écran des ateliers d’éveil olfactifs destinés aux jeunes enfants, les méthodes d’entraînement à la mémorisation des odeurs en école d’œnologie, un protocole de rééducation olfactive pour les personnes souffrant d’anosmie ou de parosmie, ainsi que des ateliers d’olfactothérapie à destination de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.
Le potentiel de l’odorat dans le diagnostic et l’accompagnement de pathologies neuro-dégénératives a d’ailleurs été largement relayé dans la presse ce mois-ci. D’après Science Daily, un jeu-vidéo en réalité virtuelle olfactive a notamment été développé par une équipe de l’institut des sciences de Tokyo pour contrer le déclin cognitif. Les participants sont invités à mémoriser un odorant semblant émaner d’une statue virtuelle puis à suivre des indices olfactifs disséminés dans le paysage jusqu’à en localiser la source. Une fois arrivés à destination, les joueurs doivent comparer plusieurs odeurs afin d’identifier celle mémorisée à l’origine. « En combinant des tâches ciblées avec un retour d’information en temps réel, notre approche d’entraînement olfactif basée sur la réalité virtuelle peut accroître l’engagement cognitif et maximiser son impact thérapeutique », explique le professeur Takamichi Nakamoto, à l’origine de l’étude publiée dans Scientific Reports. Des améliorations ont d’ailleurs été notées chez 30 personnes âgées de 63 à 90 ans testées au moyen de différentes tâches cognitives avant et après 20 minutes de jeu.
Nous avons récemment relayé les recherches qui ambitionnent de mettre à profit le flair canin pour le dépistage de certaines maladies, mais d’autres méthodes semblent également efficaces. Futura Sciences nous apprend qu’une nouvelle série de tests olfactifs non-invasifs réunis sous le nom AROMHA Bain Health Test (ABHT) a été développée par une équipe de recherche nord-américaine afin d’évaluer la santé cérébrale des personnes vieillissantes. En effet, le dysfonctionnement du système olfactif, notamment la baisse des capacités d’identification, de discrimination et de mémorisation des odorants, est un symptôme particulièrement précoce de plusieurs pathologies comme Alzheimer ou Parkinson. Jusqu’à présent, deux tests sont couramment utilisés pour évaluer les fonctions olfactives : l’un développé par l’Université de Pennsylvanie (UPSIT), l’autre consistant en une batterie de trois tests nommée Sniffin’ Sticks (SST). Si de nouveaux types de tests sont actuellement expérimentés par plusieurs équipes de recherche, AROMHA semble particulièrement prometteur car il peut être auto-administré à domicile. Le protocole repose en effet sur un questionnaire en ligne et une vingtaine d’étiquettes olfactives – faciles à envoyer par la poste – et permettrait donc d’identifier plus facilement les personnes à risque de développer une démence. Peut-être pourrait-on, dès lors, les soumettre à l’entraînement olfactif en réalité virtuelle développé par l’équipe du Pr. Nakamoto !
De manière générale, au-delà des troubles neurodégénératifs, la diminution de la fonction olfactive semble associée à un risque de mortalité accrue chez les personnes âgées. Le Quotidien du médecin rappelle ainsi les liens entre les déficits olfactifs et plusieurs maladies chroniques (hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires…). L’article cite notamment une étude suédoise menée grâce à un autre test olfactif appliqué en gériatrie et associé à un suivi du taux de mortalité (toutes causes confondues) des personnes testées après 6 puis 12 ans ainsi qu’à une analyse des causes de ces décès. Or, comme le résume Pourquoi docteur ?, « les participants classés comme anosmiques présentaient un risque relatif de mortalité près de 70% plus élevé que les volontaires classés comme normosmiques. » Si les résultats de cette étude soulignent donc l’importance de la fonction olfactive comme marqueur de risque de mortalité chez les personnes âgées, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour évaluer l’utilité clinique des évaluations olfactives dans l’identification des personnes susceptibles de fragilités cognitives et/ou physiologiques.
Une étude chinoise parue dans Translation Psychiatry et relayée par Santé Magazine semble par ailleurs montrer que le déclin conjoint des capacités cognitives et olfactives « pourrait découler de particularités au niveau du microbiote du nez. » L’analyse des communautés microbiennes présentes dans les cavités nasales de 510 personnes âgées dont l’état de santé cognitive avait été préalablement évalué a permis à l’équipe de déterminer que les dysfonctionnements olfactifs de type hyposmie étaient associés à une plus grande richesse bactérienne. En outre, « les participants dont le biotype nasal était dominé par les bacilles Corynebacterium présentaient une prévalence plus faible de troubles cognitifs légers que ceux dominés par les bactéries Dolosigranulum ou Moraxella. » L’analyse du microbiote nasal pourrait donc également contribuer à l’identification des personnes à risque et peut-être mener un jour « à la mise en place de traitements basés sur la modification du microbiote nasal pour réduire le risque de démence. »
Des études antérieures suggéraient déjà que la flore pathogène du nez pouvait pénétrer dans le cerveau par la voie olfactive, endommageant potentiellement les neurones et contribuant aux maladies neurodégénératives. Récemment, Futura Sciences se faisait d’ailleurs le relai d’une étude de 2022 qui montrait que les lésions de la muqueuse olfactive facilitent l’entrée dans le cerveau de Chlamydia pneumoniae, une bactérie qui s’attaque au système nerveux central. Cette étude avait alors été utilisée par certains pour suggérer que les personnes ayant l’habitude de se mettre les doigts dans le nez pourraient s’exposer à des risques accrus de développer la maladie d’Alzheimer. L’article rassure cependant : « la maladie d’Alzheimer résulte d’une combinaison complexe de facteurs génétiques et environnementaux » et « il n’y a aucune preuve formelle que se curer le nez puisse entraîner la maladie d’Alzheimer. » Mais de conclure : « Cependant, il est recommandé de pratiquer ce geste avec douceur afin de ne pas endommager la muqueuse nasale. »
Une autre maladie a également intéressé la presse ce mois-ci, la fibrose kystique (mucoviscidose), dont l’un des symptômes est également l’altération de l’odorat. La raison de cette déficience, explique Medscape, semble être d’ordre génétique et non une conséquence de l’inflammation des sinus, comme cela était précédemment supposé. Une étude pilotée par l’INRAE portant sur 10 patients dont 80% présentaient un dysfonctionnement olfactif a permis de constater une distribution anormale des récepteurs olfactifs ainsi qu’une « faible abondance de cellules basales globuleuses, essentielles à la régénération des tissus olfactifs ». Une seconde batterie de tests, menée cette fois sur des cochons atteints de mucoviscidose, semble suggérer que les mutations du gène CFTR, responsables de la maladie, affectent aussi directement le système olfactif. Bien que ces recherches n’offrent pas encore de solutions thérapeutiques, elles ouvrent du moins la voie à une prise en charge plus complète de la maladie, en incluant les symptômes sensoriels.
Suite à cette revue de presse scientifique, Nez vous invite à contribuer à l’étude en ligne sur l’olfaction chez l’adulte menée par le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon en cliquant ici.
Visuel principal : © Morgane Fadanelli
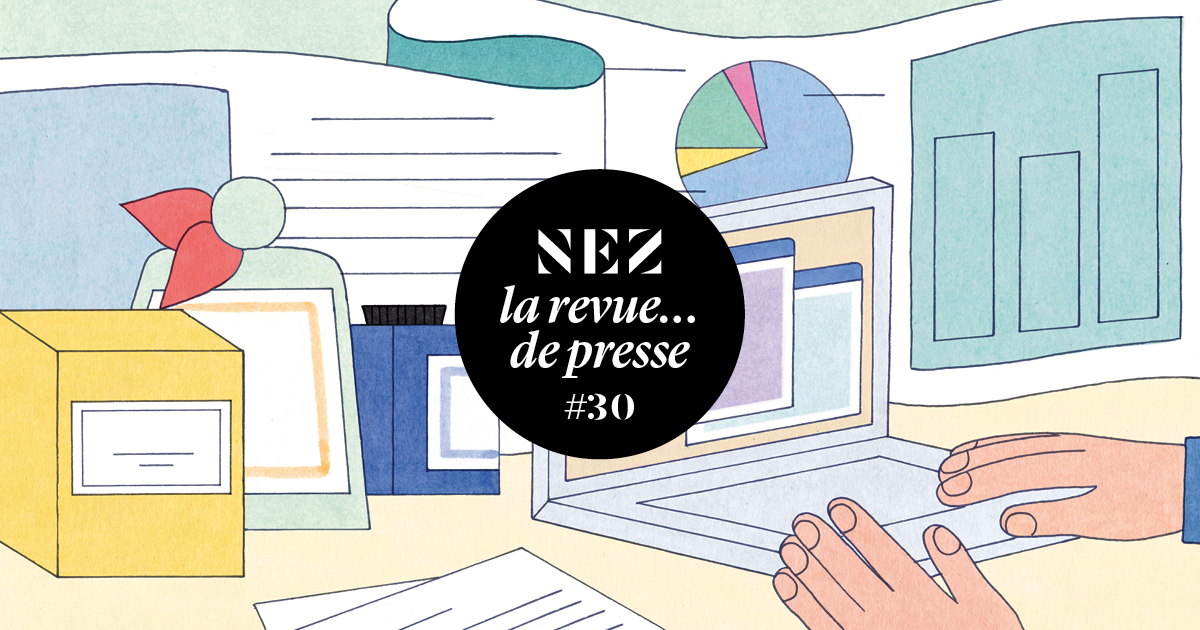





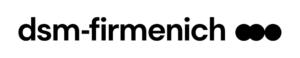

Commentaires