Au menu de cette revue de presse, des chiens médecins, enquêteurs, sauveteurs ou naturalistes, des rats sommeliers et des loups menés par le bout du nez. Ce printemps, l’odorat des autres mammifères est à l’honneur !
Avec plus de 100 à 300 millions de récepteurs olfactifs — selon les races — les chiens sont, nous le savons, des flaireurs d’exception. Or les résultats d’une étude publiée en mars et relayée depuis par plusieurs médias internationaux nous promettent une connaissance bientôt plus approfondie de ce système sensoriel ultra-développé. Une équipe de l’Université Bar-Ilan de Tel-Aviv a en effet récemment mis au point un système permettant de mesurer à distance l’activité cérébrale des chiens dans le bulbe olfactif, l’hippocampe et l’amygdale. Grâce à un laser et une caméra numérique, les chercheurs et chercheuses ont pu mettre en lumière des « motifs de mouchetures » spécifiques liés à l’activation de ces régions clés au moment de l’olfaction. Cette méthode non-invasive et moins contraignante que l’IRM ou l’EEG (qui réclament la sédation et/ou le confinement de l’animal) ouvre donc de nouvelles perspectives pour étudier le traitement de l’information olfactive chez les mammifères. Les auteurs et autrices imaginent en outre des applications pratiques : examiner en temps réel les réponses cérébrales des chiens permettrait par exemple d’utiliser leur système olfactif « comme capteur olfactif naturel, connecté à distance à un ordinateur, permettant ainsi de comprendre une odeur particulière détectée ». Il ne s’agirait donc plus d’observer seulement les réactions de l’animal face à divers odorants appris — notamment émis par des drogues, des explosifs ou des maladies —, mais d’observer également celles de son cerveau !
Les êtres humains n’ont cependant pas attendu de tels dispositifs pour mettre à profit la sensibilité olfactive des chiens. Dans le domaine médical notamment, celle-ci est de plus en plus exploitée, permettant de détecter efficacement un nombre croissant de maladies. Comme le rapporte le New York Post, l’organisation britannique Medical Detection Dogs forme actuellement des chiens à détecter le cancer colorectal à un stade précoce en analysant des échantillons d’urine. Trois labradors, trois cockers spaniel anglais et un retriever à poil plat ont pour l’instant été soumis à divers exercices et les premiers résultats semblent prometteurs. Les mêmes chiens sont également formés à reconnaître d’autres signatures olfactives, comme celle la maladie de Parkinson, de la maladie d’Addison, ou de la Covid-19. D’après The Guardian, des chercheurs de l’Imperial College School of Medecine de Londres ont également découvert que les chiens peuvent identifier à la truffe certaines bactéries spécifiques telles que Pseudomonas aeruginosa, à l’origine de nombreuses pathologies et très résistante aux antibiotiques. Jodie, un labrador doré de l’équipe canine de Medical Detection Dogs, est ainsi l’un des premiers chiens à être entrainé pour détecter cette bactérie à partir de vêtements portés par les patients. Alors qu’environ un million de décès sont causés annuellement par des bactéries multirésistantes, la détection plus précise qu’autorise le flair canin permettrait de garantir l’usage du « bon antibiotique et ainsi limiter le problème croissant de la résistance aux antimicrobiens, qui s’aggravera si nous administrons aux patients le mauvais type d’antibiotiques, » explique la professeure Jane Davies.
La médecine n’est d’ailleurs pas le seul domaine dans lequel les chiens et leur odorat s’avèrent des alliés précieux. Dans un second article, The Guardian évoque les canidés qui ont récemment permis de repérer 13 « dragons sans oreilles », ou Tympanocryptis pinguicolla, dans les prairies de l’ouest de Melbourne, en Australie. Cette espèce de reptile endémique, la plus menacée du pays, n’avait plus été aperçue depuis 50 ans quand quelques spécimens avaient été redécouverts à la fin des années 2010. Les scientifiques, qui estiment qu’à peine 200 individus subsisteraient à l’état sauvage, ont cependant beaucoup de mal à recenser précisément ces minuscules sauriens, « difficile à repérer avec les techniques d’enquête traditionnelles ». Formés durant un an au zoo de Victoria, deux chiens ont néanmoins réussi à retrouver la piste de ces créatures et à identifier plusieurs terriers occupés. Comme l’explique l’écologue Emma Bennett – qui travaille depuis une vingtaine d’années avec des chiens sur des missions de préservation –, les agents de détection de la faune sauvage, en Australie comme ailleurs, s’allient de plus en plus souvent à ces animaux au nez fin car « si quelque chose est caché ou camouflé dans un terrier, ou simplement difficile à voir, il peut être facile de le sentir ».
En Belgique, c’est pour la police criminelle que nos amis à quatre pattes remuent ciel et terre, toujours du bout de la truffe. D’après Reuters et Science et Vie, un chercheur de Gembloux Agro-Bio Tech, le Dr. Clément Martin, aurait en effet développé un parfum reproduisant celui des os humains desséchés. Si certains chiens policiers étaient déjà formés à identifier l’odeur de chair en décomposition, celle des os, en revanche, singulièrement différente, ne faisait pas partie de leur entraînement. « Une fois que les tissus mous ont disparu, les molécules odorantes des os restants deviennent nettement moins nombreuses » a déclaré le jeune chercheur. En outre, « un os de 3 ans aura une odeur différente de celle d’un os de 10 ans ». C’est donc à un tout nouvel apprentissage que doivent se soumettre les chiens de la police belge pour assister sur les affaires les plus anciennes. Composé à partir d’analyses chromatographiques d’ossements fournis par un anthropologue, le premier parfum composé par le Dr. Martin a notamment été testé par Bones, le bien nommé Springer anglais de l’inspecteur Kristof Van Langenhove. Il devrait permettre à l’animal de localiser des restes humains anciens, facilitant ainsi la résolution d’affaires jusqu’à présent non élucidées.
En ce début de printemps, France Bleu célèbre pour sa part l’odorat de Max et Sia, deux Border Collies entrainés à secourir les victimes d’avalanche dans les Pyrénées-Orientales où cinq équipages de chiens sauveteurs ont été opérationnels tout l’hiver. Le reportage évoque la manière — ludique — dont ces alliés à quatre pattes sont formés « à détecter n’importe quelle odeur humaine », même à travers un épais manteau neigeux. D’une rapidité ingalée, ces chiens sont essentiels aux secouristes qui disposent d’à peine quinze minutes pour sauver une personne ensevelie. L’été, ces mêmes équipes cynophiles aident également à retrouver les randonneurs et randonneuses ayant perdu leur chemin ! De la médecine à la crimilogie en passant par l’écologie et le secourisme, le flair canin s’avère ainsi, en toute circonstance, d’une efficacité redoutable. Comme l’écrivait en 1900 le grand naturaliste Jean-Henri Fabre : « Nez de chien ne peut mentir. »
Peut-on en dire autant du nez des rats ? Il semble que oui. Une étude publiée en février dans Animal Cognition et intitulée « Les rats peuvent distinguer (et généraliser) deux variétés de vin blanc » a d’ailleurs fait largement parler d’elle en suggérant que les rongeurs seraient en passe de devenir sommeliers. Du moins est-ce ainsi que plusieurs journaux ont humoristiquement repris l’information. Une équipe de chercheuses australiennes a en effet montré que les rats étaient tout à fait capables, après un entraînement spécifique, de distinguer au nez deux cépages, le Riesling et le Sauvignon blanc. Leur taux de réussite de 94% dépasse même les performances habituelles des dégustateurs professionnels ! « Nos rats ont été entraînés à reconnaître un profil olfactif de Sauvignon blanc ou de Riesling, et la plupart d’entre eux ont pu projeter ces profils olfactifs appris sur de nouveaux vins issus de sauvignon blanc et de riesling » expliquent les scientifiques. Ces résultats « étayent clairement l’hypothèse selon laquelle les animaux non humains peuvent à la fois apprendre et généraliser des concepts olfactifs complexes. » Si les rats devront acquérir bien d’autres compétences avant de remplacer les sommeliers et œnologues, les autrices de cette première étude se proposent déjà « d’explorer la capacité des rats à apprendre perceptivement d’autres catégories moins évidentes liées à la dégustation de vin chez l’homme, comme le producteur ou la région d’origine. »
Pour finir cette revue de presse animalesque — qui vous donne peut-être envie de relire le septième numéro de la revue Nez et de plonger dans L’Odorat des animaux de Gérard Brand —, suivons France Bleu sur la piste du loup dans les Pyrénées-Atlantiques « Comment protéger les troupeaux contre les attaques de loups ? ».
Dans les régions où le prédateur a repris ses droits ces dernières années, la question est de première importance pour les éleveurs et les éleveuses. Avec l’idée de promouvoir une cohabitation apaisée, plusieurs entreprises ont imaginé des collier conçus pour être portés par les chèvres ou les moutons et diffusant des molécules volatiles connues pour être des phéromones lupines. Il s’agit ainsi de simuler l’occupation d’un territoire par d’autres loups afin de dissuader toute approche ou attaque du troupeau. « Les loups respectent scrupuleusement le territoire d’autres loups, » explique Johann Fournil de l’entreprise M2i, spécialiste du biocontrôle. « Donc l’idée consiste à reproduire une odeur dissuasive, une barrière olfactive. » Le dispositif a pour le moment été testé en Suisse, en Italie et en Grèce, avec des résultats encourageants. D’après La République des Pyrénées, de nouveaux tests devraient avoir lieux en France cette année.
Visuel principal : © Morgane Fadanelli
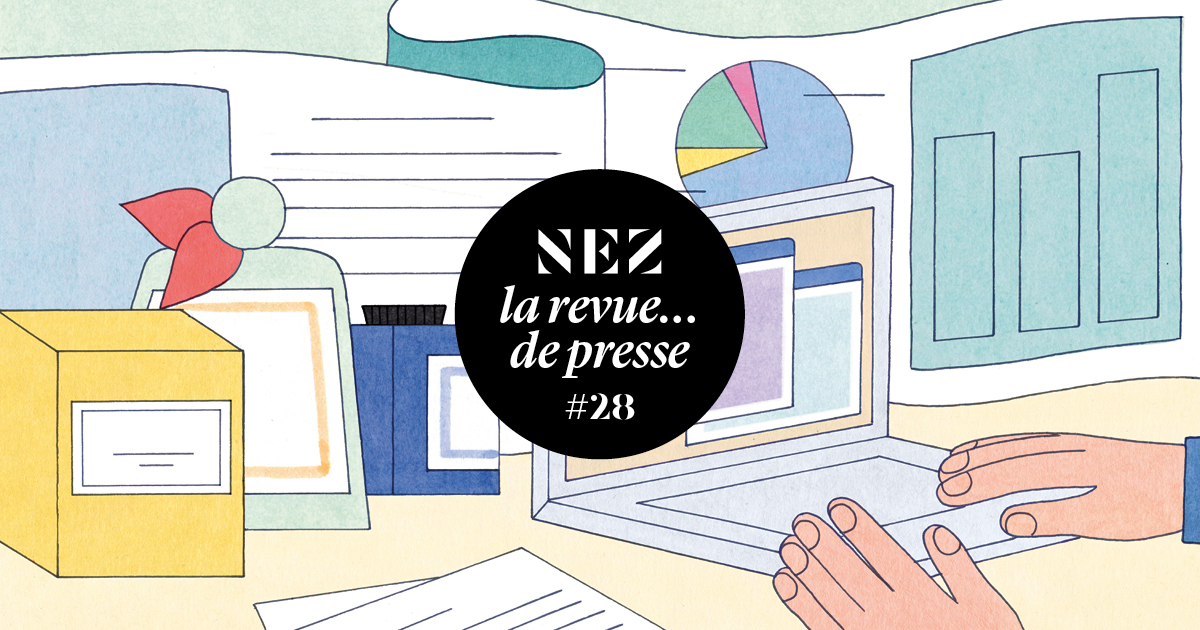





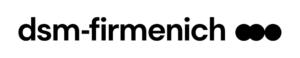

Commentaires